- L'Héroïsme des Jeunes
- par Marcel ANCIAUX
-
- Heureux sont qui sont morts dans une juste guerre.
- Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés.
Ch. PÉGUY
Publié originellement sur le site "The Great War
in a Different Light" (site malheureusement disparu)
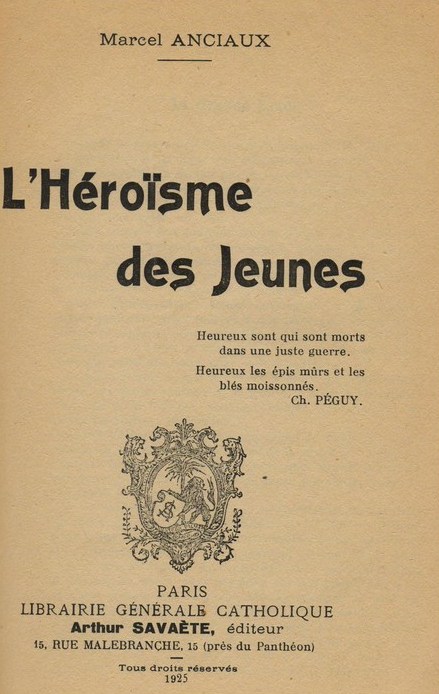
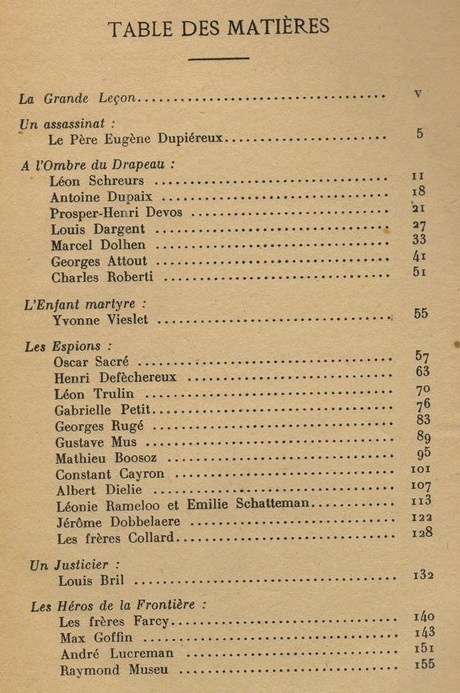
Préface
La Grande Leçon
Lorsque la guerre déferla sur la Belgique, S. M. Albert 1er eut une parole magnifique qui, concrétisant à miracle les sentiments patriotiques de son peuple, servit de devise à tous les citoyens pendant les années tragiques. « Les Belges lutteront jusqu'à la mort pour leur indépendance; et, s'il le faut, je prendrai moi-même un fusil. »
Belges, nous avons toujours été un peuple de travailleurs, artistes ou commerçants, de vie calme, heureux du bien-être conquis par un labeur tenace.
Peuple fort et loyal, un sentiment dominait toute notre activité nationale: l'amour de la liberté.
Férus d'indépendant, têtus, ombrageux, nous n'avons jamais prétendu qu'on touchât à nos franchises, qu'on troublât notre bonheur; nous étions libres, nous voulions le rester, et toujours - l'histoire l'atteste - il y eut du peuple chez nous qui versa son sang pour cette Liberté.
De plus, ce qui, de tout temps, fit la gloire du peuple belge, et qui aux heures sombres de la guerre le porta à l'héroïsme, c'est une vertu foncière, racique, l'unique vertu, motrice de toutes les autres : l'Honnêteté.
Quand l'Allemagne perpétra son crime de violer notre territoire, ce qui porta sur les routes de la résistance toutes les cohortes farouches de braves devant quoi durent s'incliner nos ennemis, ce fut la révolte de notre honnêteté contre la déloyauté, la félonie teutonne.
Notre sentiment national d'alors se synthétisait surtout dans ces deux grandes idées: l'Honneur et la Liberté. Celle-ci formée par tout un passé de luttes merveilleuses, que l'histoire donnera toujours comme exemple d'amour de la terre natale; celle-là déposée dans nos cerveaux, développée dans nos cœurs, soutenue dans nos actes par nos mères. Car si la Belgique compte tant de héros, tant de martyrs, ce sont ses femmes qui les ont créés. Fruit d'un travail quotidien, d'un amour perpétuel, l'âme de la jeunesse belge, elles l'ont formée avec tant de beauté que l'on se demande parfois ce qu'il faut admirer le plus: où la bravoure de nos soldats, et de tous nos héros civils, où l'abnégation obscure de leur mère.
Des milliers de morts dorment dans nos plaines de Flandres et de Wallonie; des centaines de jeunes gens reposent à l'ombre des clochers villageois de la frontière; tant d'espions ont versé leur sang sur les pelouses de notre Tir National! Dire l'histoire de chacun serait long et dépasserait notre but. Nous les confondons tous cependant dans un même sentiment d'ample admiration et de profonde gratitude; et pour la jeunesse de demain nous présentons, en exemple, quelques figures dont la lumineuse beauté inonda plus intensément notre cœur, afin que ceux qui nous liront, brûlés par ces flammes divines sentent leur amour se hausser, leur soif de dévouement grandir, s'agenouillent sur ces clairs tombeaux et puisent, dans une méditation profonde, des leçons de devoir et de courage civiques.
Qu'un peu de reconnaissance monte aussi vers les mères de ces glorieux martyrs!
Sous Frédéric 1er d'Autriche, vivait à Woluwé-lez-Bruxelles, Mme de Mesemacre, née vicomtesse de Hardinois-de-Ville, dont six fils furent soldats; cinq tombèrent glorieusement sur les champs de bataille.
A la mort de son fils Louis, cette courageuse femme se présenta à la tente de l'archiduc Charles, campé près de Neerwinden. Introduite, elle s'adressa à son Altesse en ces mots: « Prince, six de mes fils ont l'honneur de servir dans les armées impériales; l'aîné est mort glorieusement sous les yeux de Votre Altesse Impériale. Je viens vous offrir, pour le remplacer dans le régiment de Latour, Joseph, mon quatrième enfant, enseigne au régiment de Murray et qui a déjà donné des preuves de sa vaillance et de son dévouement à l'Empereur. »
Geste admirable, renouvelé chez nous pendant la guerre, lorsqu'à l'annonce de la mort d'un de ses fils, une mère belge, enlaçant passionnément son dernier enfant, et désignant la frontière, lui disait: « Va, mon enfant; va prendre sa place. »
En 1818, Mme de Mesemacre fut reçue en audience par l'Empereur Frédéric 1er. Lorsqu'elle arriva devant le monarque, eelui-ci la présenta à son entourage en ces termes :
« Messieurs, voici la mère des braves. »
Au seuil de ce pieux pèlerinage, que tous aient une pensée émue, affectueuse, reconnaissante, pour ces mères douloureuses, grandes dans leur deuil, que l'on pourrait présenter en ces mots : « Belges! voilà les mères des Braves! »
Les femmes furent admirables pendant la guerre. Les mères de nos morts ont, toutes, pensé ce qu'exprimait une maman en parlant de son fils: « Il est tombé en service commandé; ce qui apaise un peu ma douleur atroce, c'est de savoir que mon enfant est mort glorieusement. » En prononçant ces paroles, cette vaillante ne se doutait pas de ce qu'elle se haussait elle-même, élargissait son coeur, amplifiait son courage maternel.
La gloire qui dore le souvenir de nos chers disparus, illumine aussi un peu le front de leur maman. Car si l'idée, mue par le sentiment tend à s'extérioriser, à se traduire en actes sous la pression de la volonté, ces mères avaient jeté dès l'enfance, dans le cerveau de leurs fils, en même temps qu'elles enthousiasmaient leur cœur et forgeaient leur volonté, de si grandes idées de travail, de dévouement, d'honnêteté, que lorsque l'occasion se présenta de dévoiler au monde la beauté de leurs œuvres, leurs enfants furent des Héros splendides; lorsque la Belgique demanda leur vie, à ces jeunes gens, ils la donnèrent sans regret. L'histoire de chaque martyr serait à méditer; chaque fois, on concluerait avec le Cardinal Mercier qu'une telle vie nous apprend à bien mourir et qu'une telle mort nous apprend à bien vivre.
En suivant ces héros sur leur route brève, en lisant leurs écrits, nous sentons combien forte fut sur eux l'emprise de leur mère; aussi le dernier adieu à leur maman est-il souvent émouvant d'admiration, de reconnaissance, et de piété filiale. Nous sentons également qu'un souci grave les animait: parfaire leur âme pour que leurs vertus soient entièrement productives; et en répétant cette phrase, redite si souvent, que c'est les meilleurs qui tombèrent, nous devinons qu'ils eussent été, si la mort ne les avait pas pris, des chefs, des directeurs, des conquérants; nous affirmons encore cette profonde vérité que tout homme, à quelque rang social qu'il appartienne, a son rôle à remplir; qu'il peut être, qu'il doit être à l'égal de ces porteurs de flambeaux, un héros, mais que pour atteindre ce but, la préparation d'une heure, en général, ne suffit pas; c'est dès l'enfance que se forgent les grands cœurs.
Si minime soit la tâche assignée à chacun de nous, la bien remplir, tel est le devoir; aussi, chacun dans sa sphère, amplifiant la masse de biens, lumière formidable qui doit éteindre le mal, il deviendra un des grands artisans de la purification du monde.
Passionné de dévouement, de devoir, l'homme se sent grandir dans cette mission joyeusement acceptée.
Les cîmes sont hautes, la marche est rude; l'ambition des cœurs, qui dompte les obstacles, doit être forte, car l'ambition est une vertu qui enflamme toute âme bien née. Ces jeunes martyrs ont ouvert des routes, difficiles, abruptes, peut-être. Une clarté radieuse les illumine, cependant.
L'œuvre entreprise par nos morts pendant la guerre est à parfaire dans la paix. La tâche est grande; nul ne faiblira; pour ardue qu'elle soit personne ne désespérera.
La voix des Morts se lève:
« Désespérer des enfants des héros de Cassel en 1328? Des « enfants des fiers Gantois de Roosebeke en 1382? Des enfants des sept cents Brabançons? Des six cents Franc-keinoutois? Des fiers soldats de Liège, d'Anvers, de l'Yser? « Des sublimes martyrs de l'occupation allemande? Désespérer de ceux-là qui illustrèrent notre vie nationale?
« Quand il possède un passé aussi riche, un peuple ne désespère jamais.
« Qu'ont-ils fait ceux de Liège et de l'Yser, qui, portant sur l'autel de la Patrie, l'offrande spontanée de tout leur être, d'aucuns achevant par l'immolation la plus sublime, leur amour du pays?
« Ils n'ont pas désespéré. C'est cette confiance en l'avenir qui rendit nos armes victorieuses.
« Pourquoi désespérer d'un peuple qui fut martyr pendant la Tourmente? de toute une jeunesse qui s'immola pendant les années tragiques?
« Non! Non! Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui, et celle de demain, nourries par ce passé glorieux et sacré, conservent intact le patrimoine précieux qui leur fut légué et portent toujours plus haut l'étendard de la Patrie. »
Les Morts montrent la voie...
C'est dans un amour élevé du pays, par une volonté farouche du devoir, un travail tenace, une âme ample et forte, et des vertus civiques forgées aux mâles exemples des glands martyrs, que la jeunesse doit combattre pour une Belgique meilleure, plus grande et plus prospère, afin que se réalise encore cette phrase du journal italien, La Tribuna, citée déjà par Franz Nève: « A tous les peuples de l'Europe, la Belgique peut servir de modèle. »
Le Père Eugène DUPIEREUX
Le 4 août 1914, comme la foudre sur un clocher, la guerre s'abat sur la Belgique: au mépris des traités, l'Allemagne violait notre neutralité et lançait sur nos cités heureuses ses troupes déchaînées qui, par le feu et le sang, y jetèrent la désolation et l'horreur.
Nous avons souvenance d'une instruction conduite pendant la guerre par un juge d'instruction prussien de la police secrète du Gross Brüssel au cours de laquelle, faisant allusion au chiffon de papier et aux cruautés allemandes, nous défendions témérairement peut-être, mais en Belge, le point de vue de notre pays dans la guerre mondiale.
Au milieu de la discussion .un peu méchante, nous eûmes le malheur - si malheur il y avait? - de froisser le limier, en lui faisant remarquer que l'Histoire jetterait sur le peuple allemand un discrédit et un opprobre perpétuels...
A ces paroles, le juge d'instruction, qui, visiblement, s'énervait de notre attitude, sentencieusement, laissa tomber ces mots avec emphase:
- C'est nous qui ferons l'Histoire, Monsieur.
- Vous croyez?
- Nous (il accentuait ce mot) nous serons les maîtres. Il coupa court en suspendant l'instruction.
Nous nous rappellerons toujours leur hautaine arrogance, avec quoi « ils » traitaient leurs prisonniers, leur dur mépris et leur superbe !
« C'est nous qui ferons l'Histoire. » Ce fut la mentalité de tous leurs chefs - ces mots furent répétés souvent par eux, en Belgique - de tous leurs savants, de tous leurs officiers, de presque tous leurs soldats; et l'on comprend alors que, poussés par l'idée de triomphe universel, et dans leur instinct barbare, ils aient conduit leur guerre avec une cruauté inouïe, semant la dévastation et la mort partout où ils passaient.
Deux meurtres, entre mille, accusent l'horreur de l'âme allemande, l'un commis par un simple soldat de l'armée impériale - la mort de la petite Yvonne Vieslet, à Marchienne-au-Pont, - l'autre, sur ordre d'un chef, - l'exécution du Père Dupiéreux, à Tervueren.
L'assassinat - le crime n'était-il pas prémédité? - de ce jeune Père jésuite, survenu au début des hostilités, souleva d'indignation la Belgique tout entière. Nous étions jeunes, nous nous le rappelons encore.
Voici les faits, très brefs, tels que nous les a relatés un témoin oculaire :
Louvain, le Père- Eugène Dupiéreux, jeune étudiant en philosophie au séminaire des Jésuites de Louvain, se rendit avec quelques confrères à la recherche de soldats. Lorsque, le 19 août 1914, les Allemands investirent belges qui gisaient, disait-on, dans les fossés de la route de Tirlemort. On lui montra que le danger était grand; on craignait que les bataillons allemands échelonnés sur la chaussée n'abattissent quiconque s'y hasardait.
Brûlé par la charité, le jeune Père n'hésita pas.
- Si les Allemands tirent, c'est leur affaire. Pour nous, notre devoir est de ramener nos blessés.
Plusieurs fois, au péril de sa vie, il ramena en civière des blessés à l'hôpital militaire, où il se dépensa sans compter au soin des soldats.
Bientôt, Louvain flamba; les Allemands, par haine, avaient jeté le feu aux quatre coins de la ville et à la célèbre bibliothèque de l'Université. L'exode douloureux de la population, échappée aux flammes et aux fusils, commença. Les Pères Jésuites, sous la direction de leur supérieur, partirent vers Bruxelles.
La route était longue où s'échelonnaient à perte de vue des groupes compacts de fuyards, caravanes éplorées sous ce ciel d'août. Il faisait chaud, d'une chaleur déprimante, suffocante. Dans la campagne, brûlée par le soleil, pas une âme. Tout était mort. Et dans cet air lourd, nous avancions péniblement... Derrière nous, les flammes rouges rongeaient le ciel, assombri, au loin, par ces morsures; de sinistres nappée noires de fumée se gondolaient dans l'horizon...
Nous voulions fuir, fuir toujours, mais la fatigue et la douleur appesantissaient nos pas...
Des âmes fortes s'assombrissaient; des courages élevés tombaient. Nous priions; beaucoup parmi le peuple aussi. Au milieu de nous, le jeune Père Eugène Dupiéreux était des plus vaillants, encourageant le« uns, soutenant les autres; empressé auprès des vieillards, il les aidait avec amour dans ce douloureux exode.
Lorsque son Supérieur, ému devant tant de fatigues qui l'accablaient, lui offrait un remplaçant pour soutenir une civière où gisait une pauvre infirme, il répondit simplement:
- Merci, Père, je puis encore continuer... Il fut admirable de charité.
Nous marchions ainsi depuis de longues heures déjà, quand nous arrivâmes en vue de Tervueren. Nous nous croyions au bout du supplice; mais le plus cruel n'était pas encore franchi.
Tout à coup, des soldats allemands commandés par un officier nous arrêtèrent. Les laïques purent continuer leur route. Puis, sur un ordre, on nous fouilla; on nous prit nos papiers et, au fur et à mesure qu'un des nôtres avait passé à l'inspection, on le conduisait dans une prairie voisine, bistrée par le soleil, et qui s'étend derrière les bois de Tervueren.
Tout à coup, un des soudards apporta au rittmeister un carnet trouvé sur la route: c'était un petit agenda où le Père Dupiéreux annotait journellement ses impressions. Le malheur voulut que le reître prussien le lût.
- A qui ce carnet? hurla-t-il.
Courageusement, Je Père Dupiéreux s'avança :
- A moi.
L'incendie de Louvain et de la bibliothèque nous avait tous soulevés de révolte. L'Allemagne tout entière se faisait juger par ce crime incendiaire, commandé par l'état-major.
Le Père Dupérieux, ému et animé d'une indignation frémissante, avait écrit dans son carnet:
« Jusqu'à ce jour, je 'm'étais refusé à croire ce que disaient les journaux des atrocités commises par les Allemands; mais, à Louvain, j'ai vu ce qu'est leur Kultur. Plus sauvages que les Arabes du calife Omar qui brûlèrent la bibliothèque d'Alexandrie, on les voit, au XXe siècle, mettre le feu à la célèbre bibliothèque de l'Université. Il faut avouer qu'ils se conduisent comme des barbares. Ces incendies et ces meurtres, commis en grand, ne peuvent être uniquement le fait du soldat; des ordres doivent venir de haut. »
Ces lignes tombèrent sous les yeux de l'officier qui, blessé par les allusions évidentes, entra dans une colère tapageuse, affirmant qu'il venait de découvrir là le schéma d'un sermon excitateur du peuple et un insulte honteuse à l'empereur. Sans autre forme de procès, il condamna le jeune religieux à la peine capitale.
Soudain, de la plaine où nous étions massés, nous vîmes arriver le Père Dupiéreux sous bonne escorte.
Il était pâle. Son crucifix pressé sur sa poitrine, il s'avança vers nous, le regard clair, droit, les lèvres couvertes d'un sourire triste. Dans le dos, une croix blanche tracée à la craie barrait la soutane noire.
Nous avions compris, Atterrés, nous ne pouvions dire un mot; parmi nous, se trouvait un autre religieux, le frère de celui qui allait tomber sous les balles assassines, le Père Robert Dupiéreux. Il dut assister, impuissant, au supplice de son frère.
Hurlant, gesticulant, le rittmeister nous menaça tous; puis, devant les soldats rassemblés, il força un Père luxembourgeois à traduire le texte en allemand; il voulait exciter cette soldatesque pour la « Guerre sainte ».
Grand-ducal, connaissant bien la langue allemande, le religieux, en traduisant, éduleorait le sens des mots acerbes et durs; mais, chaque fois, tourné vers ses hommes, l'officier rectifiait avec une joie brutale la traduction et cherchait à relever par des expressions fortes la pensée écrite par le Père Dupiéreux.
Les soldats exultaient de passion mauvaise; le rittmeister répéta la sentence prononcée et donna ordre de l'exécuter.
Dans un élan fougueux, tous les soldats se présentèrent. Il en choisit six.
Nous étions épouvantés; le Prussien ne nous laissa pas le temps de prendre la défense de notre jeune confrère.
Rien n'ébranla sa férocité.
La proie était trop belle; l'insulte trop grande; le religieux doit mourir. A présent, là haine noire bout dans le cœur de l'Allemand; une joie cynique contracte ses lèvres; une flamme mauvaise passe dans ses yeux.
Debout, le Père Dupiéreux se confessa au R. P. Wil-laert, nommé depuis lors provincial de la Compagnie de Jésus. L'absolution reçue à genoux:
- Merci, Père, dit le Père Dupiéreux. Je me recommande aux prières de tous.
- Vous irez droit au ciel. Vous mourez parce que vous portez les livrées de Notre- Seigneur.
Alors, devant son frère et nous, le Père Dupiéreux est massacré.
Il demande où il doit se mettre. Vers l'extrémité du champ. II! avance, serrant son crucifix sur sa poitrine, portant la croix blanche sur sa soutane noire.
Il fait quelques pas.
- Est-ce assez loin? demande-t-il.
- Non, crie la voix rogue du chef. Quelques pas.
- Est-ce assez loin?
- Non, hurle le Prussien.
Quelques pas. Nous tremblions d'angoisse. Forcés par le rittmeister de regarder ce meurtre, les larmes nous brûlaient les yeux.
Le Père Dupiéreux avançait, le pas ferme, le front levé vers le ciel... Il s'arrêta... A cet instant, une salve formidable l'écrasa sur le sol; lé sang gicla et le baigna tout entier.
Recueilies, nos âmes montaient vers Dieu avec celle du saint martyr; la stupeur passée, la douleur lentement pénétra dans nos cœurs...
On fit une fosse et on y enfouit le jeune religieux dans sa soutane de sang, là où la mort Tarait pris.
Un monument, d'une grande pensée chrétienne, se dresse sur la route de Louvain, au-dessus de Tervueren.
Vous qui passez, arrêtez-vous à l'ombre de cette croix. C'est un calvaire. Celui qui l'a gravi fut un Belge et un Saint.
...
Léon SCHREURS
Le 19 août de l'an de grâce 1921, je m'en suis allé à Louvain, où l'anniversaire de l'invasion prussienne devait réveiller dans les cœurs de bien douloureux souvenirs. Mais avant que de descendre dans la cité, j'ai gravi le boulevard Léon-Schreurs, qui, sur la gauche, longe la gare, pour retrouver les lieux où tombait, victime du devoir, le dernier défenseur de Louvain.
Les souvenirs montent dans mon esprit: c'était le 18 août 1914; l'armée belge, harcelée par les flots ennemis, devaient succomber. Ordre avait été donné par le Roi de se replier sur la place forte d'Anvers, dernier refuge de nos régiments. La 1re et la 2e division d'armée, notre aile gauche, opérèrent donc leur retraite protégée par la brigade mixte du colonel Guffens qui, par un combat terrible où tombèrent 50 % de ses braves, évita aux deux divisions d'armée l'anéantissement total.
Ce fut avec rage, mêlée de dépit, que von Klück, le vaincu de l'Yser, constata au lever du jour l'éviction de son plan: l'armée lui échappait. Hélas! les héros de la Hauteur-Sainte-Marguerite l'avaient payé dur.
Louvain, anxieux, suivait avec angoisse ces tragiques événements.
Sur la chaussée de Tirlemont, je frappe à une maison où je sais que demeure une humble femme que je connus du temps où j'habitais Louvain; elle-même m'ouvre la porte; je lui parle: les souvenirs foisonnent... Je lui montre la borne-poste dressée à peu près en face de sa demeure.
- Alors, c'est là qu'il est mort le petit Schreurs?
Elle blêmit : l'émotion l'agite; et la petite vieille, toute menue, courbée sous le poids des ans, essuie, du revers de son tablier de cotonnade quelques larmes qui lui montent du cœur:
- Oui, Monsieur; et j'ai vu cela...
Elle parle:
- Ils ont passé ici, ces longs convois de fuyards, chassés par les coquins d'Allemands; ils étaient sales, les malheureux ! et cassés sous le fardeau des bagages. Il y en avaient qui traînaient des charrettes où dormaient de petits enfants; les hommes surtout faisaient pitié: les femmes avaient plus de courage.
Tout ce monde parlait dans des sanglots; il ne disait pourtant pas grand'chose: « Partez!... les Boches sont là!... ils ont tout brûlé chez nous!... » Des bébés pleuraient; des vieillards se lamentaient; je vois encore un vieux prêtre, aux cheveux blancs, soutenant .un pauvre estropié... C'était effrayant!
La bonne vieille passe la main devant ses yeux, comme pour chasser la vision...
- Nous étions confiants, nous; on ne peut jamais croire au malheur que lorsqu'il s'abat sur vous. Quand nous demandions à ces malheureux d'entrer chez nous, il eût fallu voir avec quel entêtement tragique, mêlé de frayeur, il nous répondaient: « Nous partons... vous aurez les Boches... »
Vers le soir, le ciel rougi par le feu trouble nos espoirs; la crainte commença à nous faire mal... Tirlemont flambait.
Le lendemain, ce fut tragique: c'était la panique. Là-bas, au-dessus de Louvain, les canons tonnaient; nos vitres tremblaient, nos maisons aussi; même une madone en plâtre est tombée de ma cheminée et s'est cassée...
Puis, ce fut nos soldats qui passèrent. Ah! ce qu'ils étaient malheureux, et fatigués, et tristes! La défaite, quoi!
- Alors, c'est vrai, me disais-je, « ils » sont chez nous? Je ne pouvais pas croire cela, Monsieur.
Les gens fuyaient avec un peu de linge et un peu de manger. Ils pleuraient, mais de colère. Pensez-donc! Quilte-t-on, comme ça, sans douleur, sa maison et sa petite ville, pour l'inconnu, avec, devant soi, la vision terrible de la faim, de la mort?...
Je n'ai pas voulu partir; je suis restée toute seule, ici... Vous connaissez ce qui est arrivé à Louvaip quand ces barbares sont entrés!...
La bonne vieille, courbée et chenue, tremble; elle s'arrête un brin, puis:
- Vers une heure de l'après-midi, comme quand ils faisaient la manœuvre sur la grande plaine que vous voyez là-bas, beaucoup de cavaliers dégringolèrent la chaussée, au grand galop, tète baissée.
Eux aussi fuyaient. C'est donc qu'on était fort, là-bas, puisqu'on partait !
Puis, ce fut de nouveau le canon qui craquait plus fort que le tonnerre: je pensai mourir. Cela dura deux heures, deux terribles heures où je crus la fin du monde arrivée... Je me cachai dans un coin de la cave où il faisait bien noir...
Tout à coup, un roulement lugubre sur la chaussée; j'eus froid au cœur: les artilleurs belges partaient. Puis, plus rien. Le silence. Je restai ainsi une demi-heure environ; quand je crus le danger écarté, je remontai craintivement. Il faisait mort; l'implacable chaleur brûlait la chaussée où sonnait sourdement parfois l'écho d'un bourdonnement voisin. On sentait l'ennemi approcher. J'avais peur... Quelques habitants restés, comme moi, à leur logis, se hasardaient de temps à autre à leur fenêtre. Tout à coup, je vis un de mes voisins, sur le seuil de sa porte, gesticuler, crier... je pensai tomber: là-bas, derrière cette borne-poste, debout, son képi sur l'oreille, un petit soldat, un lignard, attendait, impassible...
Qu'attendait-il?
- Partez! F... le camp, hurlait mon voisin, ils vont arriver...
Lui, calme et souriant, levait le front, observait l'horizon qui bouge, posait lentement son fusil sur le chapiteau de la borne, et attendait...
On insiste. Il fait signe qu'il ne bouge pas. On supplie; on lui montre le danger:
- Il me reste encore huit cartouches; je veux « descendre » huit de ces Boches... fait le petit soldat.
On lui dit que c'est folie, qu'il va à la mort; alors, cet ange - car c'était un ange, jeune et beau et si brave... comme un saint Georges - répond simplement:
- D'ailleurs, je suis de garde ici; on m'a peut-être oublié; ça m'est égal. J'obéis..
Il resta...
La bonne vieille continue... l'émotion la secoue; elle parle par saccades: l'héroïsme et le tragique de ce qu'elle essaye de raconter la trouble... et je reconstitue le drame.
Au bout de la chaussée, une petite niasse grise se profile: c'est une patrouille d'avant-garde. Lorsqu'ils se sont avancés de quelques centaines de mètres, les loups se déploient en tirailleurs. L'air inquiet, flairant le danger, ils se portent en avant. Un silence écrasant pèse sur les choses...
Soudain, un coup sec casse le silence; comme un épouvantait sous le vent, un Allemand tournoie et s'écroule.
La troupe hésite; puis, sous la menace d'un oberst, elle se hasarde craintivement, longe les maisons, rampe comme une hyène.
Le petit Mchreurs, collé derrière la borne-poste, l'attend; un deuxième coup craque: un Allemand tombe... A ce crime de « franc-tireur » (!), une fusillade nourrie répond; exaspérés, les Allemands balaient de balles la chaussée... suspendent le feu et reprennent leur marche en avant; et le petit lignard, tel un chevalier de légende, accomplit, loin du regard de tous, son calme héroïsme. Il épaule lentement (les balles sont comptées), décharge son fusil: un autre Allemand mord la poussière...
Il en abattit encore deux.
Avant de remplir le magasin de son mauser vide (il lui reste encore trois cartouches), Schreurs veut juger de l'effet produit; ill hasarde la tête de derrière son rempart... A cet instant, une balle lui casse le front. Le petit soldat était mort.
Qu'espérait-il, dans ce combat de Lilliput à Gulliver? La Gloire? Il n'y songeait même pas; les chefs et ses compagnons étaient loin; lui, il était seul dans cette solitude, encouragé par aucun regard.
Il obéissait à la consigne, humblement. La simplicité de ce geste relève la beauté de cette âme qui, répétons-le, une fois de plus, concrétisait l'âme de chez nous, simple, calme, tenace et férue du Devoir...
Ce jeune héros avait vingt-quatre ans...
Les Allemands jetèrent son cadavre sur le bord de la chaussée, où il resta encore longtemps.
C'était le 19 août 1914. La grandeur émouvante de ce soir d'été déploya sur le petit Schreurs son manteau d'or; le Génie de la Patrie le nimba de l'auréole des martyrs, et le présenta à la Belgique en le nommant: le Dernier Défenseur de Louvain.
Antoine DUPAIX
Dans la légende, sous la fleur de lis qui orne, au côté, le chapeau de nos Boy- Scouts, on lit deux mots anglais: Be Prepared, Sois prêt!
Lorsque M. l'abbé Petit, le promoteur des Baden Powell belges, et M. Jean Corbisier, chief scout général de Belgique, organisèrent si brillamment, dans tous les pays, le scouting, ils adoptèrent logiquement les règles que Sir Baden Powell avait imposées, en Angleterre, à son institution. De plus, cherchant dans les résultats magnifiques obtenus par le chef anglais, des leçons sérieuses, ils imprimèrent à leur mouvement un caractère moral nettement accentué. La formation du cœur des jeunes gens les préoccupa tout autant, si pas plus, que la formation physique, qui n'est, en somme, qu'un accessoire, nécessaire, sans doute, dans la formation générale de l'homme.
Les résultats dépassèrent les espérances. Ces deux grandes figures du scouting belge sont connues de tous; des phalanges de scouts existent partout. Les jeunes gens soumis volontairement à une règle de formation physique et morale s'y préparent à devenir des hommes, des viri inter viros, comme disaient les Romains; en entrant dans cette association, ils jurent, sur leur honneur, de faire en toute circonstance leur devoir; aussi, afin de pouvoir répondre toujours à cette voix quand elle se ferait entendre, afin d'être toujours munis d'énergies suffisantes pour s'y soumettre, inscrivent-ils, en tête de leurs règles, ces mots: Be Prepared, à quoi répondent des obligations quotidiennes et sérieuses.
Loyalement observé, le programe de vie synthétisé dans ces deux mots doit former des héros.
La guerre le prouva péremptoirement.
Le scouting s'enorgueillit légitimement de tous les serviteurs, de tous les héros, de tous les martyrs donnés à la Patrie.
Dès le début de la tourmente, nous vîmes ces vaillants petits scouts aider les autorités militaires comme estafettes, brancardiers, télégraphistes, etc., puis, dans la merveilleuse retraite sur l'Yser, d'aucuns de ces braves suivirent les régiments comme enfants de troupe, comme soldats même...
Il en est parmi eux qui trouvèrent une mort si belle que la Renommée les a emportés sur ses ailes claires. Des noms, des noms, peuvent être alignés; et si je m'arrête avec plus de piété à Antoine Dupaix, c'est que ce nom est devenu populaire dans la grande famille du scouting, et qu'il synthétise l'admirable abnégation de toute la jeunesse scout pendant la guerre.
L'histoire de cet enfant est brève: II avait seize ans et demi à peine lorsqu'il s'engagea au service de l'Armée; on s'efforce de distraire son projet enthousiaste, étant donné son jeune âge; il répond éner-giquement:
- Si tout le monde agissait comme vous me le conseillez, la patrie serait bien défendue!
A la Croix-Rouge où on l'a commis, il se dévoue avec une ardeur juvénile qui émerveille tous ses chefs; estafette, s'il y a des ordres urgents et compromettants à transmettre, c'est à lui qu'on les confie, certain qu'ils seront méticuleusement remis. Déchaîné de devoir, il sert son pays avec une fougue toute patriotique et ne se sent heureux que lorsqu'il a pu se rendre utile, et contribuer ainsi à la victoire finale dont il n'a jamais douté.
Un jour, il est envoyé au 6e Régiment de ligne; mais, à l'instant qu'il eut pria contact avec les glorieux soldats de ce régiment, il devina toute la beauté de pareille servitude; et poussé vers les cimes les plus élevées de l'abnégation, il résolut de devenir soldat dans ce régiment. Après de multiples et ferventes prières, on l'accepta.
Soldat, il se bat, s'offre, à toutes les missions périlleuses, recherche les postes dangereux et ne craint pas la mort. Rien ne le trouble. Pourtant, après lies quelques semaines de séparation d'avec les siens, il éprouve le lancinant désir de revoir ceux- là qu'il a si brusquement quittés. La séparation le fait souffrir. Peut-il espérer un retour prochain? Bruxelles occupée par lès Allemands est sévèrement encerclée. Personne ne peut pénétrer dans la ville ni en sortir. Il voudrait cependant tant revoir ses bons parents!...
Un soir, il arrive chez lui, à Bruxelles, sous un déguisement de paysan, pour chercher un baiser, un seul et repartir aussitôt. Mais la douleur de sa famille, écrasée déjà sous le deuil de l'occupation allemande, s'aiguise à cette heure où, pour une seconde fois, il faut le laisser partir, sans espoir de retour peut-être, pour longtemps, à coup sûr!
Mais l'enfant répond avec simplicité et conviction:
- Je dois rejoindre mon régiment. On m'attend. Mes chefs ont confiance en moi. Mes compagnons, s'ils ne me voyaient pas revenir, me prendraient pour un lâche.
A cet appel du devoir, les parents se résignent. Antoine repart...
Anvers, le 9 septembre 1914. L'Etat-Major belge, décidé à ralentir la marche sur la France des armées impériales, a ordonné une vigoureuse sortie vers Louvain: l'ennemi, dix fois supérieur en nombre, ignore le projet d'incursion; l'armée belge pourrait peut-être causer de cruels ravages, contrarier les places de l'adversaire et mériter ainsi, une fois de plus, l'admiration des Alliés.
Les régiments désignés, parmi lesquels le 6e de ligne, se portent donc en avant et prennent position. Dans les tranchées hâtivement creusées par les avant-postes, les « lignards » attendent l'heure de l'assaut décisif pour prendre en flanc l'adversaire.
Et l'attente est longue, qui ronge les troupiers, les angoisse, verse dans leur cœur une certaine appréhension, une hésitation...
Ils n'ont pas peur. Mais les heures mornes et froides égrènent les visions des luttes passées, de leurs horreurs; instinctivement, ils ont arrêté en leurs yeux le trouble et la lassitude. C'était à Wilsele, le 12 septembre. Près d'eux, le commandant, accompagné d'un jeune soldat qu'il estime entre tous, Antoine Dupaix.
Ce chef, habitué à sonder les regards, à deviner les états d âme de ses hommes, a compris...
Il n'a, hélas! plus le temps de leur parler, de les encourager...
Près de lui, le petit scout, l'œil perdu dans l'horizon qui bouge, observe l'ennemi; la joie passe sur ses lèvres; la fierté agite son corps; le courage dore son front.
Son chef l'observe à la dérobée... Soudain, mû par la voix de la Patrie, désignant à ses troupiers cet enfant chétif et si jeune, d'une voix chaude et fraternelle, il s'écrie:
- Prenez exemple sur lui, mes amis !
Un frisson secoue la tranchée. Les hommes se redressent; ils sont prêts, ils iront!
Tout à coup, le clairon sonne l'assaut...
Le petit Dupaix surgit. Brandissant dans son poing fébrile son revolver, le premier sur le parapet, il paraît; et, le sourire aux lèvres, les yeux tournés vers ses camarades, il bondit en clamant: « En avant! »
Une balle au cœur le renversa dans la tranchée.
La charge est loin... Rien ne l'arrête. Elle taille farouchement les bataillons prussiens; il est un mort qu'il faut qu'on venge!
L'âme de ce petit martyr avait créé des héros.
Prosper Henri DE VOS
Parmi les héros de la grande guerre que le bataillon des artistes et écrivains belges offrit sur l'autel de la Patrie, une figure se détache avec tant de clarté que la jeunesse littéraire et tous les artistes de la Belgique ont décidé de buriner dans le bronze et le 'marbre les traits de cet héroïque enfant de notre beau pays: Prosper- Henri Devos!
Idée merveilleuse! Alors que la gratitude belge dressera dans sa lumière l'héroïsme d'un Trésignies, personnification de la résistance militaire, et l'abnégation d'un Philippe Baucq, synthèse de la bravoure civile, on ne peut qu'applaudir l'initiative de ceux-là qui veulent immortaliser la révolte de l'intelligence contre la force, l'offrande généreuse des artistes représentés en P.-H. Devos.
Il naquit à Bruxelles, le 28 janvier 1889, et les débuts de sa vie littéraire datent de 1908, à la publication de la Revue Française, dont il prit la direction; puis il devint secrétaire de la Revue de Belgique. En 1910, paraît son Jacobin de l'an CVIIII, roman couronné par la province de Brabant. Ce fut un coup de maître!! II avait 21 ans. L'année suivante, il publia Monna Lisa, œuvre toute empreinte de sensibilité et de couleur. On connaît le bel hommage que le critique M. M. Wilmotte écrivait dans la préface du Jacobin de- l'an CVIII:
« Je souhaite à ce livre des lecteurs dignes de lui. Il nous relève, écrivains belges, à nos propres yeux. Il m'enchante, moi qui signe ces lignes, par l'espèce de démenti qu'il donne à un parcage rigoureux de nos romanciers et de nos poètes de langue française en ima-contemporaine, ou serait fondé de soutenir que nous possédons, enfin, une littérature décrassée de son régionalisme et mûre pour des destins unitaires. »
Pas mal de ses œuvres sont inédites ou dispersées dans des revues.
Il avait servi en bon chevalier des Lettres; grand patriote, il servira sa Patrie...
Quand la guerre éclate sur la Belgique, Devos est garde-civique à Anderlecht; et, le 20 août 1914, il part vers Termonde; licencié par l'autorité, il s'engage comme volontaire au 5e de ligne. Il y gagna ses galons de sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine...
Ame optimiste, ardente au combat, dévouée pour ses soldats, Devos fut un vrai chef, admirable de courage et de confiance.
« Patience et confiance et tout finira bien », écrit-il à ses parents.
Et, le 12 octobre, dans un billet laconique, qu'il communiquait à ses parents et à sa fiancée:
« Nous nous portons toujours très bien. Nous coopérons à d'importants mouvements de troupes avec les Anglais et les Français. Le siège d'Anvers est ccmmencé, mais tout permet d'espérer la victoire. Les Anglais qui sont ici viennent de l'Afrique du Sud, et les Canadiens sont en route. Les Hindous ont déjà débarqué à Marseille.
« J'ai reçu votre lettre et celle de Renée. Je suis heu-heureux, très heureux. La guerre durera peut-être encore des semaines, mais jamais le moral et le physique n'ont été meilleurs que chez nous tous. Nous sommes à présent de vrais soldats. Je vous embrasse tous. Vive la Belgique! »
Le 15 octobre, son régiment veillait à Lombartzijde; et, deux jours plus tard, les artilleurs du prince de Wurtenberg bombardèrent nos fantassins.
Les Belges tapis dans le fossé de la chaussée, le lieutenant Devos circulait parmi eux, des paroles d'encouragement aux lèvres; et quant on lui montrait le danger de rester ainsi, debout, il souriait...
La bataille crachait sa colère; et pour calmer l'esprit apeuré de ses hommes, Devos chantait. Il chantait des chansons de chez nous, ou des chansons espagnoles; il disait des vers.
Insouciant du danger, intrépide au combat, jovial dans l'adversité, il garda toujours une âme fière de héros, admiré de ses soldais.
« Voilà un officier comme nous n'en connaissons pas encore, fit le sergent, ému par tant de bravoure.
- Je vois encore notre lieutenant, note un survivant de sa compagnie, marchant sur la route derrière nous, le corps entier exposé. Les balles des mitrailleuses sifflaient sans cesse, et il marchait enclinant la tête sur le côté, comme on fait lorsque le vent vous fouette la pluie sur le visage.
Les Belges avaient progressé sur Ramscapelle. Après deux jours de repos, le 5e de ligne prit position de la route d'Ostende à Pervyse, à la gare même du légendaire village de Ramscapelle. A découvert, les compagnies, repérées par les artilleurs allemands, furent disloquées en quelques heures. Carnage effrayant! Blessé, hébété, courant à même la campagne, on n'écoutait plus les chefs. Seul, le lieutenant Devos, par son énergie et sa volonté suborneuse, arrêta sa troupe, et, face à l'ennemi, il résista quand même...
Les Belges gagnèrent deux kilomètres, Ramscapelle était reconquis. Le lieutenant Devos reçut les félicitations de ses chefs.
Les combats se succèdent, de plus en plus meurtriers, pour les nôtres surtout, les mitrailleuses allemandes semant la mort au refrain de leur tic-tac lugubre.
Et c'est dans cet enfer que Devos tint tête et progressa malgré tout, grâce à sa tactique de combat; ses hommes l'admiraient.
Le lieutenant fut promu capitaine.
Hélas! les soldats épuisés, le terrain impraticable, les munitions faisant défaut, les braves reçurent l'ordre de se replier.
Le 28 octobre, une nuit de repos à un kilomètre en arrière. Veille de l'issue tragique! Veillée mélancolique! H. Devos parla des siens, de sa fiancée, des choses du pays... On était sombre; il faisait si triste!...
Le lendemain, vers 19 heures, les braves de la compagnie partirent pour la relève du 7e de ligne. Serrés les uns contre les autres, ils avançaient lentement, l'arme à la bretelle, lourds de lassitude, mais l'âme forte. Il faisait soir; il faisait froid; la troupe marchait toujours. Cheminement lugubre! Mais vers quel trépas! La rude marche du sacrifice les conduisait vers la gloire.
Ils se terrèrent dans lès talus du chemin de fer qui court de Nieuport à Dixmude où, leur disait-on, l'Allemand ne menacerait pas, vu qu'il cédait la place à l'inondation. La défense serait facile; pourtant, chaque homme caché à demi par le parapet du chemin de fer ne pouvait compter que sur cent cartouches!
Nuit noire. Un épais brouillard écrasait la plaine. Le silence étouffait les choses. La mort courait dans l'ombre... On la devinait sans la voir... Tout à coup une balle siffla, puis une autre... et lentement, les mausers allemands claquèrent.
Les fusils belges se turent. Soudain, un ordre sec:
- Baïonnette au canon!
Puis, le capitaine, campé au milieu de ses hommes, lança:
- Tir à volonté!
L'ennemi, en riposte, accéléra la fusillade. Ce fut la boucherie! Les Allemands, dix fois supérieurs en nombre, harcelaient les nôtres; leurs mitrailleuses fauchaient... à bout portant presque, et lès balles claquaient dans la troupe, crevant des crânes, cassant des bras, perforant des poitrines... Et, debout dans la tourmente, donnant ses ordres, le revolver au poing, Devos encourageait ses hommes.
Du canon. Du feu. Du sang. La mort se saoulait; et tout à coup le cri rauque des loups prussiens glaçant d'horreur nos fantassins. En rangs serrés, ils s'effondrèrent sur les lignes belges, sciant la chair avec leurs lames rouges. Des cris. Des hurlements. Des râles. Combat sauvage en corps à corps. Couverts de sang, enduits de boue, trompés de pluie, nos héros luttaient farouchement; et, malgré la mitraille, et malgré l'ouragan, ils ont tenu quand même.
Qu'ils étaient beaux! car, suivant l'expression des écrivains militaires, les frères Tasnier, pour faire ce qu'ils ont fait, nos fantassins n'étaient plus des hommes: ils étaient des dieux!
Cinq fois la charge allemande secoua les nôtres. Cinq fois, elle se brisa. Nos soldats tiraient toujours; l'arme leur brûlait les doigts. Face a leur ligne, une mitrailleuse boche était juchée sur le toit d'une maison; elle surplombait lé talus où les nôtres étaient rivés.
Hélas! dans cette lutte inégale, l'aile droite belge rompue, les Allemands franchirent le parapet. Ce fut un massacre. Pris en flanc par une mitrailleuse, les lignards tombaient sans répit... Et tout à coup, le capitaine, comprenant le danger, s'élança vers la section qui perdait pied; l'épée haute, il cria :
- Tirez. Tapez dessus...
Ironie du sort! Une balle vengeresse le frappa à l'aine; il tomba. Prisonnier avec une quarantaine des siens, sommairement pansé, le capitaine Devos fut déposé sur le bord du chemin, où il demanda de prendre note de l'adresse de ses parents pour leur communiquer ce qui venait d'arriver. Transporté au lazaret allemand, il y mourut quelque temps après...
La Patrie comptait un martyr de plus.
Il dort dans le modeste cimetière de Zevecote, où les ennemis l'ont inhumé sans cercueil. Là-bas, dans cette terre nourrie et fécondée diu sang généreux de nos frères, il repose, gardien immortel de notre patrimoine national, champion merveilleux de l'intelligence et des arts qui se sont offerts en holocauste, avec tant d'amour, sur les autels de la Patrie; et quand son régiment rentra victorieux chez nous, dans les plis de ses drapeaux, lourds de gloire, l'âme du jeune héros palpitait encore...
Louis DARGENT
Du temps que j'allais au collège, j'avais un ami que j'estimais beaucoup. Il était mon aîné de trois ans. Musardant comme des pinsons, devisant comme des fillettes, nous revenions ensemble, la classe finie.
C'était un beau jeune homme de dix-sept ans, né à Rognée, le 30 juillet 1897, aux cheveux noirs, aux yeux infiniment doux comme l'âme qu'ils reflétaient. Il riait à blanches dents, d'un rire franc, qui éclatait, vibrait comme du cristal; et une intelligence ardente animait sa volonté inébranlable. Doué d'une force d'assimilation extraordinaire, nourri d'une érudition vigoureuse, cet éphèbe était né pour-de grandes choses!...
Je l'aimais, l'a mort l'a pris. Je le vénère à présent.
Quand surgit la guerre, Louis Dargent terminait ses humanités gréco-latines; esprit méthodique et puissant, attiré par les sciences positives, il commença ses études d'ingénieur à l'Ecole des Arts et Métiers de Bruxelles, où, successivement, il passa brillamment ses deux premiers examens.
II travaillait... Mais son esprit tourmenté par des rêves téntaculaires frémissait aux échos des grandes luttes de l'Yser! Servir! Ah! Ce que ça devait, être beau!
Pour goûter ce bonheur-là, il fallait payer cher. Fils unique, il restait pour ses bons parents l'enfant cajolé, choyé, adoré. Sa mère aimait tant sentir sa tête enfantine reposer sur sa poitrine chaude, à la veillée, près des chenets, tandis que son père évoquait les temps révolus et parlait de l'avenir de son fils. C'est entre le cœur de son père et les lèvres maternelles que l'enfant grandit. Dans cet être si simple, ces deux honnêtes gens avaient forgé un héros; l'âme était forte, et prête au combat.
Heureux parents, qui avaient réalisé oe chef-d'œuvre après vingt ans de labeur!
Depuis le 1er août 1914, l'enfant avait demandé l'autorisation de s'enrôler. Le cœur paternel ne put s'y résigner. Les prières dui fils devinrent pressantes:
- Ah! Rester ici, vois-tu, quand d'autres se battent!
- Lorsque tu auras dix-neuf ans, tu feras ce que tu voudras...
Et le jeune homme travaillait en silence. Quand ses dix-neuf ans eurent sonné, il partit, son énergie décuplée. Sept fois, il tenta le passage de la frontière hollandaise: sept fois il échoua.
Pas mal se fussent retranchés derrière cet argument après pareilles tentatives. Lui, jamais!
Le Père Van Bambeke, lui montrant les dangers multiples d'une évasion à cette époque, avait donné des détails atroces sur la fin de certains collégiens électrocutés à la frontière. Lui faisant observer qu'il avait fait plus que son devoir en tentant si souvent le passage en Hollande, ce religieux lui déconseillait une nouvelle entreprise; et, pour vaincre toute opposition, il lui avait donné le pourcentage énorme des jeunes gens tombés à la frontière, environ 25 % vers le mois d'octobre 1917.
L'enfant hésita; puis, doucement, mais la voix ferme, il répondit:
- J'ai fait le sacrifice de ma vie.
Je me rappellerai toujours ce soir d'août 1917 où il me parlait de ses projets... Ses yeux brillaient; son large front était droit; et ses prunelles fixaient par-delà les plaines un objet invisible:
- C'est là-bas que je dois être! me dit-il.
Il faisait doux ce soir-là; de la mélancolie flottait dans l'espace... Je promis de l'aider si je le pouvais. Il me serra vigoureusement la main; cette étreinte fut la dernière; elle me serre parfois encore les doigts, quand j'y songe.
Quelque temps après, c'était le grand drame!
Attendant l'heure propice pour un nouveau départ, en secret, il distribuait à ses amis des fausses pièces d'identité pour rejoindre l'armée. Le 17 octobre 1917, il était prêt; une nouvelle tentative serait faite: tout était favorable; l'entreprise devait réussir.
Hélas! A l'annonce de cette décision, il hésita: il devait partir sans dire adieu à ses parents qui étaient en province. Réflexe d'un sentiment d'amour, qu'il détruisit aussitôt. La voix du devoir l'appelait; il la suivrait. Il était heureux! Ceux de ses proches qui l'ont vu partir n'ont pas oublié l'enthousiasme débordant qui palpitait dans cette jeune âme quand l'heure du départ sonna.
Pour les parents aimés, il laissa ce seul billet laconique, que j'ai sous les yeux, tracé d'une écriture nerveuse et nette, sans hésitation, et qui devait aussi expliquer, à la Kommandatur de Bruxelles, son absence:
« Mes chers Parents,
Je regrette beaucoup la peine que je vous fais; mais une occasion unique de passer la frontière se présente. Vous me pardonnerez cette désobéisssance, car je ne peux plus rester ici; la vie me devient insupportable.
Un gros baiser de votre Loulou. Il faut bien que je parte pendant votre absence, puisque vous me le défendez. Encore une fois, pardon.
Votre Loulou. »
Parti le 14 au soir, il gagna Moll; et, le lendemain, avec 31 compagnons, il s'achemine vers la frontière. Troupe vaillante, agitée par l'angoisse du doute et par le danger des patrouilles.
La nuit est noire. Ils glissent dans la venelle d'un village:
- C'est Lommel, murmure le guide.
Ils passent devant l'église. A cet instant, le clocher égrène les douze coups de minuit. Douze coups froids qui semblent un glas...
Ils vont nu-pieds vers leur tragique destinée, ces beaux jeunes gens qui n'ont pour toute armure que leur courage et leur amour patriotique. Cela suffit.
Ils marchent depuis trois heures. Soudain, des coups de feu claquent. Un gars s'écroule. La troupe s'éparpille. Robert de Smet gît, la jambe atrocement déchirée. Ne pouvant emporter leur compagnon, blessé par des gendarmes allemands, les jeunes gens se replient en deçà de Lommel.
Ils repassent devant le cimetière communal... Le vent agite doucement les médaillons funéraires suspendus aux croix. Les ifs se tordent en de grands gestes désespérés. La tour de l'église, estompée de nuit, se dresse comme un moulin à vent.
Les trente-et-un jeunes gens se glissent furtivement et cherchent un gîte...
Comme il fait triste ce soir!...
- Demain, un des nôtres sera peut-être couché dans ce cimetière, murmure Louis.
Son compagnon lui réplique, en haussant les épaules:
- Si tu as de ces idées, fallait pas venir!
Louis sentit qu'on doutait de son courage. Il répondit froidement, avec conviction:
- Je n'ai pas peur de mourir!
De quoi était donc faite l'âme de tous ces héros de vingt ans, dont l'avenir brillait à leurs yeux et qui, jetant loin d'eux tout souci de leur vie, marchaient vers la mort avec ce calme serein, étonnement de nos ennemis mêmes?
Un enfant qui les connut vous répond: ils aimaient leur pays plus qu'ils ne s'aimaient eux-mêmes, d'un amour simple mais foncier, sans éclat mais tenace. Ils étaient patriotes; et la mort ne les effrayait pas; car!ls savaient que le sang de leur sacrifice ferait d'eux des martyrs.
Cachés dans des auberges, terrés dans des granges, les jeunes gens se dissimulèrent comme ils le purent aux perquisitions des patrouilles.
Trois jours, ils restèrent là, inquiets de leur sort. La nuit, les gendarmes passaient... Les ruelles pleuraient sous le coup de leur sabre; le pavé geignait sous les sabots des chevaux; et l'écho des rues répétait un grand hoquet de mort...
J'ai devant les yeux la lettre écrite aux parents du jeune héros par les aubergistes qui hospitalisèrent Louis dans ce tragique voyage. Elle est écrite en flamand; elle est simple, mais d'une simplicité troublante. Que de drames n'ont-il's pas vus, ces hôteliers de la frontière! Pourtant, ils furent émus par l'attitude énergique et farouche de ce jeune héros qui dépensa une somme de courage si grande qu'ils en gardent un souvenir pieux. En des mots et en un style rustiques, ils ont dit qu'ils étaient fiers d'avoir pu rendre un petit service à ce héros. Cette hospitalité, ils l'ont d'ailleurs payée d'une dure captivité dans les geôles allemandes.
En quelques heures, ils étaient devenus pour le jeune homme des amis, des confidents:
- Je suis heureux de partir et de prendre part aux combats pour notre chère patrie!...
Il parlait, riait, devisait... Soudain, ses yeux s'assombrirent; des larmes roulèrent sur ses lèvres, l'amer du sacrifice lui mordit le coeur:
- Mon seul regret est de quitter, sans les avoir vus, Mes bons parents, et sans avoir pu leur donner le baiser d'adieu...
Le lendemain, au soir du 21 octobre 1917, une nouvelle tentative de passage est décidée, pour minuit. Des trente-et-un jeunes gens, huit seulement répondent à l'appel, dont Louis Dargent, Remy Kesteleyn et les deux frères Delplanque, soldats français.
Sélection des meilleurs qui donna quatre martyrs...
Ils partent. Il fait noir. Il fait doux. La lune s'étale au-dessous des arbres. La brise chantonne dans les roseaux.
Ils marchent silencieux, le cœur tendu vers l'horizon mystérieux; d'aucuns égrènent des prières; tous évitent le moindre bruit.
Ils marchent...Ils marchent toujours: la frontière court devant eux, tendue de fils meurtriers. Le passeur pose l'isolateur, franchit rapidement la mort. Louis Dargent et un des Français le suivent avec succès; l'autre se présente, courbe le torse, heurte le fil assassin, et s'écroule.
A cette horreur, son frère se retourne et, fou de désespoir devant le cadavre de son aîné, accroché dans les fils, ne pouvant survivre à cette catastrophe, il se précipite sur le réseau électrisé, pour mourir avec son frère.
Louis, qui a deviné le drame, se jette résolument sur son compagnon désespéré, veut le retenir... et s'effondra avec lui sur les fils meurtriers. Un cri! L'enfant n'est plus.
Coeur généreux, il vaulait sauver son compagnon d'héroïsme. Dans ce dévouement, il trouva la mort. Son sacrifice est double.
Avec des héros pareils, la Belgique est immortelle!...
On l'inhuma dans un petit cimetière de village. Quelques mois après, deux voyageurs, - un homme et une femme - en grand deuil, descendaient à la gare de Lommel. Ils portaient la tête droite; leurs yeux voilés de douleur s'enfonçaient dans le silence des venelles. Ils s'acheminèrent vers le cimetière où ils déposèrent, sur une tombe fraîche, des fleurs et des prières, leur souffrance et leur foi.
Les villageois qui passèrent derrière le champ des morts aperçurent, par-dessus la haie, deux pèlerins agenouillés dans l'herbe, qui pleuraient amèrement...
Marcel DOLHEN
«... Je ne regrette pas ces bons jours de gâterie; je suis content et je suis fier; fier d'avoir pu me prouver à moi-même que je n'étais pas cet enfant efféminé qu'une enfance trop choyée aurait annihilé; fier, parce que je sens que je remplis un devoir, un grand devoir, que dans cette moisson de sacrifices et de dévouement j'ai une part à fournir aussi large, aussi grande que je le veux; et si belle est ma part!... »
Le 15 août 1914, de Louvain, au milieu de la bourrasque qui secouait la Belgique, Marcel Dolhen, jeune médecin au 8e de ligne, écrivait ces pensées à ses parents.
Tout de suite on se sent garndir à la lecture de si nobles idées. C'est que, traduisant de généreux sentiments et concrétisant la grande loi morale qui nous meut, elles exaltent la bravoure et le devoir avec tant de sincérité!
Celui qui les écrivait était un jeune Belge, né à Rhisnes-lez-Namur dans une famille où les préceptes chrétiens pieusement observés, quelque rudes qu'ils soient parfois, versaient dans les âmes une force vivifiante et un bonheur austère.
M. Dolhen, régent d'école moyenne, érudit doué d'un sens artistique élevé, tendait à forger dans son fils une âme d'élite, forte et frémissante, tandis que l'épouse, Cornélie de la Borne ancienne, celle que l'enfant à vingt ans appelait encore mamelle, diminutif exquis de maman, inondait ce cœur de tendresse affectueuse et cordiale.
L'enfant répondit à leurs labeurs.
Les succès académiques, la médaille d'or en rhétorique, et les brillants examens universitaires se passent de commentaires.
Ame virile, pénétrée d'idéalisme, auréolée de douceur, de sensibilté et de fraîcheur, comprenant que la vie de l'homme n'est pas un droit mais une fonction, il fixa au seuil de son existence le but de l'Idéal et y tendit toutes ses énergies: « Voilà donc ce que représente une vie, une brève échappée dans la ligne des ans et combien brève, combien infinie vis-à-vis de ces siècles qui l'ont précédée, et déjà, pour beaucoup, l'ont suivie. Pour moi aussi il en sera de la sorte. Deux dates marqueront mon passage; lesquelles?... Et c'est l'espace entre ces deux moments que je dois combler.
C'est à cela décidément que je m'attache maintenant. De quoi vais-je le remplir?... M'acharnerai-je à la poursuite de l'or, comme le font la presque totalité des hommes qui m'entourent? Et après? quand sera passé ce terme, qu'en retirerai-je?
Rechercherai-je avant tout mon bien-être pendant ce court passage?
Ce serait stupide, il faut l'avouer. Donc je ne dois considérer qu'une chose: Accumuler le plus possible de biens que je puisse emporter, qui me restent de cette vie dans l'autre, celle qui ne finira plus.
On devine qu'une âme aussi noble était prête pour la grande servitude. Quand les ailes noires de la guerre s'étendirent sur la Belgique, Dolhen obéit à l'appel de la Patrie; et dès l'instant qu'il fut sous les plis de ses drapeaux, il la servit généreusement.
A Fleurus, un poste de grand'garde en action près des forts manquait de médecin. Un volontaire se présente: c'est un père de famille; Dolhen l'apprend, et le remplace. Plus tard, au milieu de la bataille, il veut se trouver dans les premières lignes pour secourir les mourants; il vécut la vie des troupiers: alertes, combats, repos sur la dure, retraites, marches, fatigues. « Les genoux fléchissent; mes pieds s'alourdissent; mais il faut marcher, marcher toujours. Je me raidis contre la fatigue. »
Puis ce fut l'horrible hiver de 1914 passé à l'Yser, dans les tranchées gelées.
Mais dans le souvenir des siens et l'évocation de la vie familiale il cherchait le réconfort. Il notait d'une plume habile, et sans heptologie la vie et les incidents des tranchées:
« Nuit noire. Ciel couvert. Il pleuvine. On ne voit pas à deux pas devant soi. Et dans ce noir, et dans cette pluie les hommes travaillent, construisent des abris. On entend le charroi sur les routes pavées. On devine partout le mouvement, à cette heure où tout devrait reposer. C'est l'heure où le monde des travailleurs s'éveille, se répand sur les routes et dans lés champs bouleversés par les obus. »
Dolhen veillait sur ces hommes; et quand les canons crachaient la douleur, doux et généreux. Il calmait les cœurs et lénifiait les blessures: « Je suis heureux, résigné à tout, décidé à tout, pourvu que je sois utile ».
Dans la tourmente, il ne perdait cependant pas sa gaîté:
« Vous allez me trouver bien changé! Vous ne vous figurez pas ce que cinq mois ont opéré de transformations dans ma petite personne. D'abord une barbe! Oh, ma barbe! Parlons-en. De gentils petits poils soyeux d'une couleur indéfinissable, à la fois châtain et roux. Mais c'est qu'elle se présente bien depuis que le lieutenant V... s'est chargé de la tailler! Puis, il y a mon teint que le hàle a mordu. Mais ce qui est encore plus changé ce sont mes habitudes: le lit est devenu pour nous du superflu, du raffinement; par principe et par goût, nous dormons sur la paille. Il faudrait nous voir tous les cinq sortir de notre chambre à coucher le matin, les yeux lourds de sommeil, la tête ébouriffée, les vêtements et les cheveux tous chamarrés de fétus de paille qui s'éparpillent à tous nos mouvements. Tenez, un de ces jours, je me ferai photographier dans cette pose; cela en vaut la peine; je vous enverrai le portrait.
« Ah! j'allais oublier un gros défaut que m'a valu la guerre: Je suis devenu fumeur - mais un vrai - je fume la pipe! Voilà, n'est-ce pas, le tableau fini du vieux grognard. Me reconnaissez-vous? »
Il voulait obéir et servir:
« Deux attitudes s'offrent à moi: ou bien l'indépendance, m'occuper uniquement de ce qui peut être utile aux soldats, négliger le reste, les prescriptions que je juge tracassières, inutiles ou inopportunes; ou bien me soumettre à la discipline militaire - en vrai militaire - dans toutes ses minuties, l'accepter même avec ses petits côtés... Tout compte fait, j'accepte la deuxième ligne de conduite. »
Hélas une entérite mucro-membraneuse l'obligea au repos, à Calais; puis sur la demande du professeur Wechers (raconte un de ses amis, qui nota la vie héroïque de ce brave) qui avait besoin d'un assistant à son service d'ophtalmologie. Marcel fut affecté à l'hôpital de la Panne, On crut à une demande de sa part, on alla jusqu'à suspecter sa générosité: Marcel en fut sur le moment très affecté; mais se dominant aussitôt, fort de sa conscience nette et droite, il dédaigna les attaques mielleuses et se rendit à son nouveau service.
Il soigna les soldats; il soigna les habitants pauvres; et là, dans cette léproserie de la douleur et des misères, il rencontra une femme admirable, joyau précieux et rare, une modeste infirmière dont l'âme pareille à la sienne, était mue par des sentiments si élevés de noblesse, de spontanéité et d'abnégation que son cœur se troubla; il entrevit le bonheur, lumière filtrant dans un ciel lourd; par un matin rose, ils entrèrent tous deux dans la chapelle de l'hôpital de Calais, et, devant l'autel, ils s'unirent l'un à l'autre; le baiser des fiançailles scella leur promesse.
Idylle touchante, sur des ruines tragiques, sous le souffle de la tourmente.
Les doigts veloutés du bonheur posaient sur le front de ces deux jeunes gens une caresse douce; leur affection décuplait l'ardeur de leur dévouement, et dans l'âme esseulée des grands héros obscurs de la guerre, ils versaient si càlinement la rosée de la béatitude que ces blessés revivaient au souffle de fraîcheur nouvelle, au soleil de cet amour; ils étaient tous deux, selon le mot d'Alphonse Daudet, de véritables marchands de bonheur.
Un de ses amis raconte qu'un jour on apporte au service des yeux un pauvre bébé portant la tare du vice de ses auteurs: conjonctivite blennorragique. La vue est presque totalement perdue. Le maître, après avoir examiné le malade, déclare qu'il reste bien peu d'espoir de le guérir: une chance sur cent. Le jeune assistant n'a rien dit; mais au dedans de lui-même sa résolution est prise. Il y a une chance sur cent, il tentera cette chance, les lavages doivent être dosés très soigneusement, appliqués très délicatement, répétés jour et nuit, toutes les heures. II prendra cela sur lui, sans en rien dire à personne. D'habitude c'est là la tâche des infirmières; mais il ne veut s'en remettre qu'à lui-même. Et puis le mal est contagieux.
« Le jour, il se fait aider par sa fiancée; la nuit, il se fait éveiller toutes les heures; les nuits de garde il les passe de la salle de réception au pavillon des yeux. Et ce traitement dura des semaines, mais l'enfant ne fut pas aveugle. Quand on le présenta à nouveau au chef de service, ce fut un étonnement profond devant cette cure merveilleuse. »
Passionné de dévouement, il veut servir aux tranchées:
« Je ne veux pas m'embusquer, dit-il. Mon seul vœu est de me trouver dans la situation où je puis être le plus utile. Plutôt que de me vouer au service d'une compagnie de travailleurs, je préfère attendre à l'arrière, dans un service d'hôpital, d'être tout à fait rétabli pour retourner au front dans la place qu'on voudra bien me confier. »
Vers décembre 1916, lors du dédoublement des régiments, Dolhen fut désigné comme médecin de bataillon au 18e de ligne; et tandis que des amis le pressaient de conserver son poste à l'hôpital, que d'autres lui offraient une place à l'artillerie, la voix du Devoir, impérieuse et grave, parlait en lui: Dolhen obéit à l'ordre, et malgré la douleur que lui causait l'éloignement de celle pour qui il voulait vivre, il partit.
« Le but que je me propose est celui-ci: devenir l'ami, le compagnon du soldat, manger avec lui, fréquenter les cantonnements, les endroits où il s'amuse, vivre sa vie. »
Il tint parole. Au cœur de l'hiver, il écrivait à sa fiancée: « Je suis heureux: J'ai obtenu une amélioration du sort des hommes aux avancées. »
Ici se passe le drame: un soir qu'il venait de monter aux tranchées, une communication téléphonique lui annonça qu'aux avant-postes, une sentinelle est frappée par une balle.
Dolhen n'hésite pas. Il part. Un froid aigu fouette les visages; la neige gelée, éclaboussée par la lune, alourdit la marche, et dresse sur son plateau la silhouette noire des brancardiers.
L'ennemi, qui devine cependant le mobile de la marche à découvert de cette cohorte audacieuse, répond par une fusillade nourrie. Déjà deux troupiers, qui s'offraient à sauver leur camarade blessé dont les gémissements sourdent lugubrement de dessous la neige, s'écroulent...
L'aumônier, parvenu à lui jeter une corde autour des reins le hâle péniblement vers la tranchée; soudain la corde casse... Alors entre Dolhen et l'aumônier, qui tous deux s'offrent au tragique sauvetage, se livre un sublime combat d'abnégation... Mais l'aumônier s'incline, vaincu par l'héroïsme...
Et Dolhen, après s'être confessé rapidement, part; il rampe péniblement... accroche le blessé... revient lentement... et tout à coup, à l'instant où sa générosité allait être couronnée de succès, une balle l'étend sur la neige. - « Aumônier, vite l'absolution », dit-il.
On le ramène dans la tranchée; il récite tout haut le chapelet; une automobile le transporte à l'hôpital; pas une plainte ne monta de son cœur, pas un cri; et tandis que ses lèvres égrenaient la mélodie des prières, il agonisait dans un petit lit d'ambulance.
Lorsque sa fiancée accourut, éperdue, à son chevet, Marcel était dans le coma.
0! douleurs des choses humaines! Tant de bonheur brisé en un instant!
A l'heure où la lumière grise de l'aube hivernale jetait dans la chambrette sa caresse mélancolique, appuvé sur le cœur de la petite infirmière, enlacé dans son étrein chaude et désespérée, Marcel mourut...
Chrétien, il mourut comme un saint; et sa mort pareille à celle du grand Psichari, le héros de Rossignol, qui tomba, le chapelet à la main, Dolhen portait aux pieds de Dieu la moisson de ses vertus...
Ici-bas, un pauvre petit cœur déchiré pleure amèrement son ami. A la table d'or du bonheur entrevu elle n'a pu prendre place; sa douleur est tragique. Le calice de la souffrance est parfois amer pour les âmes pures!
Mais chrétiennement, la petite infirmière supporte le fardeau de son sacrifice et cherche dans le souvenir de son aimé des motifs de vaillance, de résignation, des mobiles d'action et de dévouement, toujours.
Avant de partir pour les tranchées, Marcel avait demandé à cet ange de la Bonté, de ne pas abandonner, s'il mourait, ses vieux parents dont il était l'enfant unique et de vivre près d'eux pour les consoler.
Sacrifice sublime qu'elle accepta!
Maintenant que l'horrible tourmente est calmée, dans une petite ville de Wallonie, au foyer sombre de deux parents, abîmés dans leur chagrin, une jeune fille achevant l'holocauste, endort câlinement leur douleur; et parfois, lorsque trop de mélancolie alourdit leur front, elle secoue doucement les cendres mauves du souvenir, et sur les ailes blanches du rêve, trois cœurs ulcérés communient avec leur cher disparu...
Georges ATTOUT
Dans l'aube douce d'un jour d'avril de l'année 1921, les collines mosanes exultaient; de fraîches senteurs printanières et des chansons tissées de fière mélancolie ruisselaient de leurs flancs. Une émotion intense agitait les choses et de la beauté les animait. Un bonheur orgueilleux et recueilli vibrait dans l'espace; et tandis qu'un hymne d'amour montait vers la lumière, en bas, sur les rives de la Meuse, une foule attendrie s'agenouillait pieusement au passage d'un cortège triomphal qui ramenait la glorieuse dépouille d'un petit Namurois tombé a l'Yser.
Il s'appelait Georges Attout. Dès le jour où l'Allemagne viola la terre belge, il résolut de s'enrôler dans l'armée active, et lorsqu'il en demanda l'autorisation, son frère lui posa cette question:
- Es-tu prêt à faire le sacrifice de ta vie?
A quoi Georges qui n'avait que seize ans répondit aussitôt d'un ton ferme:
- Oui.
Il partit. II fut un héros.
Parce que l'on tarde à l'envoyer au front, il écrit à ses parents:
- « J'espère qu'on va bientôt nous envoyer au feu, ce pourquoi d'ailleurs je me suis uniquement engagé. »
L'amour de la bataille grandit encore dans la tourmente; s'il aspire à servir dans les tranchées de première ligne, c'est qu'en signant son engagement il avait conscience de la responsabilité de sa mission.
- « J'avais trop la notion de mon devoir pour hésiter un seul instant à m'engager. Malgré le poids du sacrifice, je suis content de servir mon pays et fier de porter le plus noble uniforme qui soit. Jamais une parole de regret n'est venue à mes lèvres, ni une pensée de rancune à mon esprit. Si jamais je suis frappé, ce sera par devant et Là-Haut, où j'espère bien aller, je prierai pour tous ceux qui me sont chers... Verser son sang pour le Pays est un peu le verser pour le bon Dieu, quand la cause que l'on défend est juste. La mort à venir ne me fait pas peur. Je ferai mon devoir comme tous les braves... Je ferai mon devoir jusqu'au bout, mais si jamais j'étais blessé, je n'oublierais pas qu' « en faisant son devoir la première blessure est douce à recevoir », comme je le disais autrefois dans « la fille de Roland ». Et si même je ne devais plus revenir, ne vous attristez pas. Si je tombe au champ d'honneur, cette gloire ne sera pas seulement pour moi, mais elle rejaillira sur vous tous; sur toi, mon cher papa, à qui je dois le cœur que je mets à combattre, sur toi, ma toute chère maman, qui m'a si gentiment et fièrement permis de m'engager. Sachez que la balle que j'aurai reçue m'aura atteint en face et le fusil à la main. Mais laissons là ces idées noires... J'ai confiance. Ne vous inquiétez pas. Notre-Dame du Rempart m'a protégé jusqu'à maintenant. Elle me continuera sa protection. »
Georges Attout, par ses brillantes qualités de douceur, de bonté, de modestie et de bravoure conquit rapidement l'estime de ses chefs et de ses camarades.
« Admirable partout et toujours, Georges sur le champ de bataille était le plus ardent des défenseurs de la Belgique. Missions périlleuses, corvées, besognes dédaignées, rien ne coûtait à cette âme magnifique dès qu'elle y apercevait un devoir ou une occasion de se sacrifier. Que de fois, ses chefs ne durent-ils pas contenir la fougue de Georges et modérer son ardeur à solliciter les postes que d'autres redoutaient. »
Face à la mort, Attout vivait heureux, dans la satis faction vivifiante du devoir accompli.
« Jamais je ne me sentis l'âme aussi paisible, aussi heureuse, qu'en ce moment. Je ne me plains pas de mon sort; il est digne d'envie... Je n'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment, tant j'ai conscience de faire ce que je dois... Je ne suis pas imprudent, mais je ferai mon devoir jusqu'au bout, je le jure. Si j'y reste, et bien, vous vous direz que la balle que j'ai reçue m'a frappé en face de l'ennemi... »
Plus tard, quand il sera sergent, il écrit:
« Il faut beaucoup prier pour moi; pas tant pour que je sois préservé, mais pour que je sois à la hauteur de ma tâche du grand devoir qui m'incombe, et que dans le fracas des tirs de barrage, je reste calme, maître de moi-même et des hommes dont je suis responsable. »
Dans la tourmente il garda toujours bonne humeur, et parfois sa joie éclatait, fusait, réconfortante pour ses compagnons.
Un jour, dans une escarmouche, Georges fut blessé; dès que la chose fut-connue dans sa famille, ses trois petites sœurs, en cachette, lui écrivirent pour lui demander la vérité sur son état, promettant bien de garder le secret le plus absolu.
Voici la réponse adressée aux trois petites sœurs en même temps:
« Chacune de vous, Gaby, Mariette et Laure aussi, je crois, me dit ceci: Mon cher Georges, dis-moi la vérité; si tu ne veux pas que je le dise aux deux autres, je garderai le secret pour moi; mais dis-moi sincèrement quelle est la gravité de la blessure; si tu peux me le dire (Mariette dit: vous pouvez); je veux savoir...
« Et bien, je peux vous le dire. C'est beaucoup plus grave que vous ne le croyez. N'avez-vous pas remarqué sur la photographie que je vous ai envoyée? La tête qui a l'air si souriante, n'est pas la mienne. Le docteur d'ici me l'a amputée, voyant que c'était d'une si mauvaise qualité; et il m'en a remis une autre, provisoire, en celluloïd.
« C'est depuis lors que j'ai attrapé le fameux rhume dont je vous parlais et que j'éternue comme ça. Je crois que je vais profiter de mon séjour ici pour me faire enlever les polypes du nez. L'opération sera beaucoup plus facile à faire, ma véritable tête étant conservée dans un bocal d'alcool... »
Mais la guerre durait, plus longue qu'on ne l'avait espérée, guerre monotone, qui ronge les cœurs, aiguise '«s ennuis, creuse les cerveaux, énerve les volontés.
Georges puisant dans sa religion et dans les leçons d'une éducation saine et virile la force d'une résistance formidable, ne fut jamais désemparé.
Cœur d'élite, ému au spectacle des misères de ses compagnons d'armes, il s'efforce de calmer leurs angoisses, de verser en eux un cordial et de la lumière.
« La plupart (de mes hommes) sont des paysans, des ouvriers, mais ils ont bon cœur et sont bien malheureux, les trois quarts au moins n'ayant ni famille ni affections-par ici. Ils sont bien plus à plaindre que moi à qui l'on pense et l'on envoie de si charmantes lettres. »
Puis:
« Combien, hélas, de ce côté du front sont sans amis, sans personne qui s'intéresse à eux, pauvres soldats dont la vie est bien pénible et dont les ressources ne dépassent pas les quelques sous de leur solde. »
Devant ces souffrances Georges s'émeut.
Deux traits entre mille qui montreront la beauté d'âme de ce jeune soldat, nommé sergent depuis longtemps:
Un jour qu'il était de service aux tranchées, deux gros colis envoyés par ses marraines anglaises lui parviennent. Il les ouvre; et ses yeux émerveillés découvrent, soigneusement ordonnés, du chocolat, des cigarettes, des écharpes de laine, des chaussettes, etc... bref, toute une garde-robe et une bonbonnière bien garnie. Georges se réjouit.
Un peu en retrait, des hommes sont adossés à la paroi de la tranchée, l'œil triste, perdus dans une rêverie...
- Allons, venez, vous autres, c'est pour vous comme pour moi! On va partager... Vous allez voir si je vous ai trouvé de bonnes mamans en Angleterre! Que chacun choisisse son affaire! II y en a pour tous!...
Et le petit Altout étend sur la terre tous les cadeaux, les yeux en fête du bonheur de ses hommes. Ceux-ci un peu timides, craignant de trop priver leur aimable compagnon:
- Et vous, petit sergent? s'écrièrcnt-ils.
- Oh! moi je prendrai ce qui reste... s'il reste quelque chose.
Tout l'enfant apparaît dans ce trait.
Un jour encore que Georges, de permission à Paris, se promenait dans la ville avec sa maman, parvenue à le rejoindre en passant la frontière hollandaise, il s'arrêta devant le magasin d'un marchand de vins; tout pensif, il admirait les Rœderer, Hiedsieck, Veuve Clicquot, Saint-Marceau, et autres champagnes couchés dans la vitrine, et tout à coup se retournant vers sa mère:
- Une idée me vient, maman, et tu ne me refuseras pas, j'en suis sûr. Achète-moi quelques bouteilles de ce Champagne. Ce n'est pas pour moi, vois-tu... c'est pour mes hommes, là-bas, qui n'ont jamais rien, eux. Ils savent que je suis venu te voir aujourd'hui, et cela leur sera si bon, à mon retour, en souvenir de toi.
Le cœur qui s'émeut devant la misère morale ou physique, et qui tend à la calmer, accomplit ici-bas une œuvre admirable; parce que ayant une mission sociale à remplir qui fait de lui une individualité non absolue mais relative en tant qu'il existe pour les autres, l'homme contribue par l'accroissement de bien dont il est cause à agrandir le monde, à l'élever, le purifier.
Georges comprenait déjà ce devoir dicté par la raison, et par le cœur, surtout chez lui. Le cœur n'est-il pas le moteur de nos activités, si tant de nos actes ne fructifient pas, n'est-ce pas souvent, parce que, d'après une erreur psychologique commune, nous avons cru trop longtemps que l'idée seule devait régir la vie; c'est Antoine Redier, je crois, qui a dit: « Sais-tu ce qui manquait avant la guerre? Des cœurs. Trop intelligents et pas d'entrailles, ainsi tombent les grands peuples. »
Le petit Attout, soumis à la voix du devoir qui grondait en lui, s'émouvait au spectacle des souffrances que dès son arrivée au front il avait résolu d'apaiser.
- « Les hommes sont assis autour du feu. On parle du pays... Que sont devenus les êtres chers auxquels on pense toujours?... Ils n'ont aucune nouvelle de leur foyer. Ils sont moins heureux que moi qui vous sais tous bien portants. Parfois une larme coule sur un visage et s éteint dans l'épaisse moustache... Un gros soupir part de la poitrine d'un ancien. Il a trois enfants, il ne sait rien d'eux... Moi-même je chasse une larme que je sens partir et je continue d'écrire en pensant à vous tous... »
Georges était l'ennemi du mal; aussi le combattait-il sans merci.
- « Si le mal agit autour de nous, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'enrayer, et pour ramener au bien ceux qui se sont égarés. Ce doit être le but de notre vie: pour nous-mêmes, être des modèles et réaliser le bien autour de nous... Je veux faire du bien. C'est à cela que j'aspire. Mais pour y réussir, je dois d'abord m'efforcer de me perfectionner moi-même. »
Quelles épreuves ne traverse-t-il pas pour atteindre cette admirable perfection qui en fit un soldat du Bien.
- « Ce que j'ai souffert de grossièretés de la part des gradés, c'est inimaginable! On aurait dit qu'ils avaient pris le parti de me salir le cœur et l'esprit. Et il fallait subir coûte que coûte leurs conversations immondes ! »
Mais la Beauté triomphante dorait son front.
Aimé de tous ses soldats, respecté par les humbles, craint par les autres, il portait fièrement son titre de chrétien:
- « Le respect humain ne me connaît pas. Je n'ai jamais caché mes croyances à personne: tout le monde a vu mon chapelet, mon crucifix, mes médailles et je m'en fais un petit titre de gloire... »
Un de ses amis le rencontre un jour à la Panne; et voici comme il le décrit:
- « La guerre n'avait pas terni son regard ni donné un pli d'amertume à ses lèvres; il souriait du même sourire très bon que j'avais connu, et dans ses yeux on lisait une âme restée très jeune, très pure, très généreux. Le premier sentiment avait été de l'admiration pour sa mâle élégance, la fière beauté de ses traits, le timbre chaud de son accueil. »
Homme d'élite, il fut soldat d'élite.
Ses officiers l'aimaient; son major l'admirait.
« Le rude chef s'est attaché au noble enfant; il aime son ardeur juvénile, son clair regard et son dévouement » racontent les frères Tasnier, écrivains militaires, qui consacrèrent quelques pages à ce jeunes héros qu'ils appellent un Saint.
Un jour, à l'issue d'un combat où Attout fut splendide, il reçut les plus grands éloges de ses chefs. Il écrivit aux siens, avec candeur:
- « Le capitaine m'attendait près de son abri. Le lieutenant qui pendant l'action se trouvait à notre gauche et qui avait eu autant affaire que nous lui avait raconté déjà la façon dont mon poste s'était comporté, et il a bien voulu me féliciter chaleureusement. Il m'a promis une belle citation. »
Né pour la Gloire, Attout offrit dans l'immolation la plus sublime, son amour à la Patrie.
C'était en avril 1918. Dans le secteur de Merkem la bataille faisait rage. Un peu en retrait, le Chef dirige les mouvements, aidé par le petit sergent qui sous la mitraille porte les ordres.
Depuis l'aube, l'artillerie allemande martèle les tranchées, enfonçant la mort dans la terre molle. Les cadavres autour desquels le soleil a tissé un linceuil de gloire gisent pêle-mêle; et les hommes tirant, mitraillant, tiennent tête à l'ennemi qui veut parvenir à franchir les lignes; ils sont là, debouts, tenaces comme des chênes, dans leur capote de poussière et de sang, auréolés d'héroïsme, prêts à mourir pour leur drapeau.
Tout à coup un poste d'avant est menacé.
- Un coureur pour le capitaine de Champaubert, fait le major?
Des témoins oculaires ont narré l'a scène.
Deux volontaires se précipitent.
Attout vient de rentrer, il les devance et s'offre:
- Je connais très bien la situation de ce côté; laissez-moi courir à nouveau là-bas.
- Non! reposez-vous. Un autre pour cette mission.
Attout ose insister, se fait pressant:
- Soit, dit le major; allez vite et bonne chance. Quelques instants après il est de retour et rend compte, joyeux, la main au casque:
- Mon major, tout va bien, nos hommes se battent comme des lions, les Allemands rec...
Il s'effondre; une balle l'a frappé au ventre.
Alors, entre le chef et l'enfant mourant, s'engage ce dialogue:
- Major, ai-je fait mon devoir?
- Oui, brillamment, Attout, vous êtes un brave.
- Croyez-vous que cela mérite une décoration?
- Oui, et je l'attacherai moi-même sur vôtre vaillante poitrine.
Il eut un sourire doux.
- Oh! Major, moi je ne la porterai jamais ma décoration, vous la remettrez à maman, je vais mourir.
Et de sa main il montre sa blessure par où coulent son sang et sa vie.
Les obus tombent dru. On veut l'emporter, il résiste:
- Non, laissez-moi; il est plus beau pour un soldat de mourir sur le champ de bataille, face à l'ennemi.
Puis tout à coup, avec la grande liberté que permet la mort et peut-être le délire survenant, il saisit la main du chef et employant son expression favorite de reconnaissance admirative:
- Major, tu es un chic type.
Son agonie dura trois heuresj dans l'apaisement de la béatitude.
Un soldat de Namur est là. Attout l'attire:
- Embrasse-moi au nom de papa et de maman. Près de Lui un autre soldat se meurt. Il tire sa croix et s'approchant du camarade:
- Courage, encore quelques heures de patience. Tu vas mourir et moi aussi... N'est-ce pas beau, dis, de penser que ce soir même nous allons nous retrouver au ciel?
Alors, il prend dans une main le portrait de ses parents, conserve dans l'autre sa croix qui ne l'a jamais quitte et, regardant avec amour ses deux symboles de ce qu'il a tant chéri, doucement il expire.
Georges Altout fut cité à l'ordre du jour de l'armée belge, décoré de la Croix de Guerre et nommé Chevalier de l'Ordre de Léopold.
« Sous-officier de valeur, dit la citation, exemple de bravoure et d'audace pour ses camarades. Blessé et reconnu inapte au service armé; a demandé à rejoindre l'armée de campagne où depuis son retour il n'a cessé de se distinguer par son sang-froid et son mépris de la mort. Au combat du 17 avril 1918, s'est volontairement offert à diverses reprises, pour assurer la liaison à travers un terrain constamment battu pour le tir d'artillerie et les rafales de mitrailleuses. »
Et tandis que par un jour d'avril la jeunesse portait au champ des morts la dépouille du petit Namurois, dans ce matin clair où les alouettes dansaient près du ciel bleu, où les fleurs crevaient leur calice pour parfumer la route, devant le cortège recueilli, la Gloire aux grands yeux fiers s'avançait, les bras lourds de lauriers.
Charles ROBERTI
En écrivant ce nom, l'émotion m'étreint; car, par association, j'évoque le temps où, collégien, j'appris par un matin d'été la mort tragique d'un de nos aînés que j'avais vu partir en vacances plein de santé et de joie: un accident stupide avait précipité dans le fond d'un fleuve cet éphèbe, amoureux de la vie.
Ce drame s'est renouvelé pendant la guerre, avec plus de cruauté quand on songe que la victime était un enfant de dix-neuf printemps, qui, dans un élan de géïiirosité, s'était offert pour la défense du pays...
Face à face, la Mort n'avait pas voulu de lui: elle le happait traîtreusement...
Il était né à Remicourt, le 10 octobre 1896, d'une famille aisée. Eduqué et élevé avec tous les soins que pouvaient dépenser deux cœurs chrétiens, l'enfant manifesta dès son jeune âge des qualités si pures de spontanéité et de générosité que ceux-là qui le connurent regrettent plus amèrement la disparition d'une âme d'élite.
Chrétien, grand chrétien, les principes enracinés en son cœur par sa mère étaient de puissants mobiles, qui mouvaient ses énergies vers de si grandes abnégations et un si bel idéal! « Quand on a Dieu dans son cœur, on est toujours le plus fort », disait-il.
Il fit ses études à Malonne. Esprit vif, caractère indépendant, il s'ébroua souvent dans les liens de l'austère discipline et du règlement. Son biographe raconte qu'âgé de 8 ans, à peine arrivé à l'Institut, il visita la pharmacie et, après avoir jeté les yeux sur les innombrables bocaux pharmaceutiques, il lança tout a coup, sans permission cette boutade:
- Je ne veux pas être pharmacien.
- Ah! tu ne veux pas être pharmacien, et pourquoi?
- Parce que c'est trop dangereux pour les enfants: ils pourraient s'empoisonner.
Charles était farceur, et le montra plus d'une fois. Sa joie exubérante, il la manifestait avec cette spontanéité qui est le propre des enfants, des âmes claires surtout. Une droiture d'âme et une loyauté foncière inondaient son regard de tant de douceur, jointe à de la fière énergie, qu'on aimait ce petit turbulent, ce bon petit diable.
Il était si estimé qu'on le choisit pour visiter les pauvres et comme porte-drapeau des élèves, ce qui fut toujours considéré comme un honneur dans les collèges.
Ses humanités achevées, Charles entra à l'Université de Louvain, où il passa avec la grande distinction son premier examen à l'école des Mines...
Soudain les cloches pleurent, les bannières frémissent, le canon gronde.
La Patrie est en danger!
Et des enfants surgissent, qui La veulent défendre; des petits gars, poussés par l'instinct de la race qui n'a jamais voulu qu'on touchât à son sol, qui veut jouir de sa liberté, entière, farouche, ombrageuse, des petits gars qui n'ont pas marchandé les peines et qui s'en sont allés vers les grandes batailles, d'aucuns à la Belle Offrande, avec le sourire sur les lèvres.
Volontaire de guerre, Charles Roberti s'offrit pour toutes les missions. Insouciant du danger, confiant dans la victoire finale, passionné pour la lutte, il était le soldat parfait.
Au début, servant à la 19e batterie du Fort no 1, il fut déçu: l'ennemi était rare; aussi demanda-t-il, et il obtint son transfert dans le corps des auto-mitrailleuses. Là où il y avait du bon travail, il serait heureux...
Puis ce fut la retraite d'Anvers, retraite douloureuse où l'énergie belge triompha une fois de plus de la force prussienne. Ce que fut cette retraite, est inénarrable, tant il y eut de la douleur, de l'angoisse, de l'héroïsme.
Ostende-Nieuport-Calais-l'Yser...
L'âme du héros s'y révéla. « Nous nous battons dans la boue, » écrit-il. Au cours d'une corvée, il abattit un Allemand et garda son revolver comme trophée.
Après six mois de guerre, Charles Roberti, le déchaîné de combats, celui qui ne craint ni diable ni Prussien, tomba terrassé par le typhus.
Convalescence au camp de Ruchard; soudain la diphtérie...
Les balles allemandes l'épargnaient; la maladie le guettait. Ironie du sort, qui frappe avec absurdité ceux-là que la Gloire guerrière devrait emporter sur ses ailes!
La guérison avance. Madame Roberti s'inquiète cependant. - « N'aie donc pas peur, petite mère, je vais très bien maintenant, et le jour tant attendu où je pourrai reprendre mon fusil n'est pas très éloigné! »
Le brave! La voix de la bataille grondait en lui et la soif du combat lui brûlait le coeur.
- D'ici quinze jours je serai probablement au front. Je le souhaite d'ailleurs de tout cœur: je me morfonds ici à ne rien faire. Et quoique le pays soit joli, je ne désire nullement y rester.
Son père lui ayant écrit que la vie est un combat dont la palme est au ciel, et que de nos jours on ne connaît plus le devoir et qu'on veut ignorer la souffrance, Charles répondit que son père ne saurait croire combien la guerre et la mort toujours proche l'aidaient à comprendre le sens de cette belle phrase...
L'âme de l'enfant se révèle dans toute sa correspondance, bréviaire pour la jeunesse de chez nous. Quelle profondeur dans cette pensée: « A-t-il jamais existé une souffrance vaine dans son objet?... Nous sommes en train de solder dans ce temps terrible une partie de nos dettes. N'est-ce pas mieux que de faire faillite?
Encore une phrase admirable:
- Est-ce que nous pourrions être contents, si Dieu ne nous envoyait que des choses faciles et agréables, comme si nous n'étions bons à rien? La voix de notre conscience nous dit: Fais ton devoir, fais ce devoir-là qui est présent devant loi, qui est mis devant toi précisément pour que tu ne l'abandonnes pas à d'autres. Fais-le, et sois content, car c'est une occasion que Dieu te donne de ne pas te conduire comme un serviteur inutile.
La convalescence achevée, Charles Roberti quitta le camp de Ruchard, le 1er juillet 1915, et, avec son ami ,J. Van Dooren, il reçut l'hospitalité chez le docteur Pousset, à St-Avertin, près de Tours. Fêtes, soirées, thés, tout fut organisé en l'honneur des jeunes Belges. Charles y vivait heureux.
Un jour, le 12 août après le déjeuner, ils firent une partie de pêche aux bords du Cher. Au crépuscule, le fils du docteur Pousset et un ami invitèrent les deux enfants belges à une partie de canotage.
Sur l'eau profonde la nacelle glissait... soudain ils doublèrent un brusque tournant; sous le choc imprévu, Charles fit un faux mouvement et tomba dans la rivière. La barque chavira, déversa les rameurs.
Des cris. Des hurlements d'angoisse: Charles coule à pic. Les sauveteurs qui accourent sauvent Daniel Pousset et son ami, ainsi que J. Van Dooren, qui, après avoir plongé plusieurs fois dans la rivière, s'enlisait.
Après de multiples sondages, on ramena sur la berge un cadavre...
Ainsi mourait tragiquement un enfant dont l'âme, empreinte de claire vaillance et d'héroïsme, était faite pour une mort moins stupide.
Des funérailles grandioses furent faites à l'enfant; le cercueil, enfoui sous les fleurs, fut porté au cimetière par une foule admiratrice du jeune héros.
Sur la pierre tombale j'écrirais volontiers les vers du poète:
Enfants, apportez-moi de tendres violettes;
Chantez des airs berceurs avec vos voix fluettes,
Et secouez sur moi les thyrses des lilas.
Yvonne VIESLET
Vous connaissez l'histoire du petit Alsacien de sept ans que les uhlans germains abattirent d'un coup de revolver parce qu'il les mettait en joue avec son fusil de bois? On vous la raconte avec émotion quand vous interrogez les calmes habitants de Romagny.
Il y a une histoire plus tragique, là-bas, à Monceau-sur-Sambre, charmant village belge, tassé entre Fontaine-l'Evêque et Marohienne-au-Pont.
Un drame a secoué le petit bourg, si gai jadis, drame atroce de l'occupation, qu'on aurait peine à croire s'il n'avait ses témoins et si l'on ne connaissait déjà l'horreur de l'âme prussienne.
Dans la cour de l'école communale des filles, un mémorial, érigé par la commune, évoque avec intensité tout le drame. La fillette a-t-elle eu un geste de menace devant les pandours allemands? Un sentiment de révolte? Les a-t-elle mis en joue avec un inoffensif fusil de bois? Oh non! Le geste qu'elle fit fut de bonté, d'amour et de pitié...
Et ils l'ont tuée!
Le 12 octobre 1918, à Marchienne-au-Pont, la petite Yvonne Vieslet, jolie blonde aux dix printemps, recevait la couque scolaire quotidienne; et la classe finie, elle s'en retournait, rieuse et gamine, insouciante comme à cet âge. Quand, arrivée rue de Châtelet, elle aperçut dans les frissons du feuillage, à travers la grille du cercle Saint-Edouard, des visages blanchis, minés par la faim, de prisonniers français.
Ils étaient là parqués - troupeau humain abandonné de tous - sans nourriture depuis longtemps, sans pain, surveillés par des sentinelles qui repoussaient les habitants généreux offrant des victuailles aux glorieux affamés.
Et l'enfant s'émeut devant cette misère. Ses yeux vont des joues creuses et grises des soldats à la petite couque blanche qu'elle porte en main. Des sourires naissent là derrière la grille. Elle s'avance, souriante aussi. Mais le loup l'épie: « Heraus! » Il est défendu de communiquer avec les prisonniers !
Yvonne hésite! Elle ne raisonne pas. Une petite fille, pourquoi voulez-vous que ça raisonne quand son cœur la mène? Elle ne raisonne pas. Elle regarde les joues creuses et de nouveau tend son petit pain...
Cette fois le Prussien grogne et, menaces aux lèvres, il la repousse brutalement. Alors, n'écoutant plus que son cœur, Yvonne lance le petit pain au-dessus des barreaux.
Horreur! Crime terrible ébranlant la puissance teutonne, menaçant son autorité! Colère et mauvais, le Prussien épaule et vise cette héroïne de dix ans, qui maintenant rit joyeuse et qui, de sa mignonne main charitable, envoie des baisers...
Un coup froid claque... déchire la petite poitrine...
Le Moloch prussien compte une victoire de plus!
Aussi vous comprendrez pourquoi ils pleurent, les petits enfants de Monceau-sur- Sambre, quand ils regardent le mémorial! et qu'ils lisent cette phrase évocatrice et poignante « ... tuée à l'âge de 10 ans pour avoir osé offrir une couque scolaire, à travers le grillage, à des soldats français prisonniers ».
Héroïne, elle est encore martyre.
Elle n'est pas tombée dans la bataille, ni devant un peloton d'exécution - à cet âge? - mais elle est la victime pure, sanctifiée par nous, de la Force mauvaise et de la Barbarie teutonne. ElLe est la lumière de douceur et de bonté que l'ombre allemande a voulu éteindre. Mais cette flamme vibre; elle illumine le front de la Patrie, abîmé par tant de douleurs!
Aussi le Pays a fait à cette martyre des funérailles grandioses émouvantes! L'enfant repose, sous une tombelle, dans le petit cimetière de Monceau, que régulièrement les fillettes du village parent de lis et de roses, candeur des vierges, sang des martyrs.
Oscar SACRÉ
Le merveilleux épanouissement de notre fierté nationale qui brisa la domination prussienne dans la Belgique occupée, doit, certes, chercher sa cause dans la superbe cohésion de nos énergies, dans l'union muette et spontanée de tous les citoyens férus de liberté et dans leur soumission collective à l'appel mystérieux de la Patrie opprimée, point de départ d'un combat opiniâtre. Geste magnifique, qui se traduisit dans la foule par une résistance que j'appellerais passive, par opposition à celle des héros qui se jetèrent dans une lutte agressive, farouche et dangereuse.
Ceux-ci, unis dans une communion générale de foi patriotique, se sacrifiaient toujours spontanément, isolément. Je précise l'idée maîtresse qui jaillit de cet héroïsme: l'opiniâtreté du combat obscur livré par les cohortes de volontaires civils - et partant de la résistance générale du pays -- trouva son meilleur agent dans l'effort individuel de ces héros; en effet, quoi qu'on en dise, l'effort individuel restera toujours le plus puissant moteur des grands mouvements.
Aussi, qui que nous soyons, riches ou pauvres, grands ou petits, nous avons dans la vie sociale notre mission à remplir; c'est à quoi doivent tendre nos énergies. Rouage d'un énorme mécanisme, nous tenons chacun notre place et, à quelque rang social que nous appartenions, toutes nos activités, conduites par la volonté profonde du devoir à remplir, sont utiles, nécessaires, et contribuent à assurer le fonctionnement du monde.
Méditant cette pensée, on comprendra la grande responsabilité qui pèse sur chacun de nous et le devoir que nous avons de développer toutes nos facultés afin d'accomplir l'ample mission assignée au plus humble d'entre nous.
Vue sous cet aspect, la vie du plus modeste travailleur n'acquiert-elle pas un prix égal, si pas souvent supérieur, à celle du plus grand dignitaire?
Celte pensée, burinée dans l'âme, sera le plus puissant levier de notre activité. C'est pour l'avoir comprise ou, du moins, pour l'avoir sentie, que des héros, sortis des couches les plus obscures de la société, après avoir été durant leur vie des hommes complets, ont gravi allègrement le chemin de la servitude et ont parfait leur amour du Devoir par une offrande merveilleuse.
On ne pourra jamais assez admirer la grandeur du sacrifice des humbles qui, spontanément, alors que, bien souvent, l'ambiance où ils vivaient était revêche à toute idée d'immolation, ont surgi à l'appel du Pays avec une simplicité qui n'avait d'égal que leur héroïsme.
Aussi, la richesse de notre patrimoine national est incommensurable, et ceux-là - tous les Belges - qui ont reçu de nos martyrs la glorieuse mission de le conserver et de le défendre s'il le fallait, se sentent l'âme élargie par ce précieux Devoir fièrement accepté.
Lorsque les Allemands violèrent la terre belge, Oscar Sacré habitait Ougrée, coquet village du pays liégeois. Camionneur au service de M. Vandersmissen-Wacob, il était l'ouvrier modèle dont les patrons, en mainte occasion, apprécièrent le dévouement et l'esprit de discipline; beau jeune homme à la figure ouverte, aux yeux francs, ces qualités n'étaient que la manifestation modeste d'une âme généreuse; quand le commandant Wallner, chef du service de renseignements français, fit appel au patriotisme de O. Sacré, il reçut une réponse spontanée de soumission entière.
Le travail de ce jeune Belge fut ce que fut l'œuvre de tous nos espions; répétons-le, il fut sublime !
Faut-il apprécier l'héroïsme aux actes seuls, ou plutôt à l'intention qui les anime? Si nous devions juger nos héros d'après les manifestations extérieures qui les révélèrent, le classement logique des héroïsmes, en séries graduées sur ces actes, serait d'une injustice révoltante.
L'occasion n'a jamais créé le héros; ce qui le caractérise, ce sont les mobiles qui l'agitent, l'intention qui meut ses énergies.
Il est de purs martyrs dont le sublime mérite sera d'avoir seulement dévoilé au monde l'ampleur admirable de leurs vertus, qui rejaillissent ainsi sur la Patrie belge, l'auréolent, la purifient.
La lumineuse beauté qui nimbe nos fronts a pour cause les astres d'or qui brillent dans le ciel. Nous portons dans nos âmes les étincelles divines de l'ardeur de nos héros purifiée dans le sacrifice.
Oscar Sacré fut arrêté par la police allemande en septembre 1915 et gardé au dur secret jusqu'à l'heure de son exécution.
Déjà, lors d'une randonnée en Hollande, il avait été arrêté sur le chemin du retour et condamné à trois mois de forteresse en Allemagne, pour avoir transporté des lettres d'officiers belges; arrêté une seconde fois, il devina tout de suite la menace terrible qui pesait sur lui. De caractère froid, tenace et frondeur, sa défense devant les Allemands fut superbe.
On l'accusait d'espionnage pour sa Patrie; et, lorsque le sinistre verdict sonna, on le condamna pour trahison de guerre.
Elle est jolie, cette engeance de malfaiteurs qui, violant les lois les plus sacrées de la justice, s'arroge le droit de parler en son nom et qui, trop avilie par la brutalité, n'admirait plus l'âme de nos espions, qu'elle frappait d'une sentence ignominieusement motivée par les mots: trahison de guerre.
Ces héros avaient défendu nos chaumières et nos palais, nos plaines et nos campagnes, nos lois et nos institutions, notre bonheur et notre passé national, le patrimoine que nos aïeux nous avaient légué; ils avaient défendu tout cela jusque dans la mort honnêtement, loyalement; et des barbares n'ont jamais pu comprendre le mobile qui les poussait, deviner l'étincelle qui les animait!
Qu'ils les aient fusillés pour espionnage contre l'Allemagne, soit! - quoique l'on ne puisse cependant nous placer sur le terrain égal de belligérant à belligérant, étant donné le crime monstrueux dont nous étions la victime, mais pour trahison de guerre!
Le fait est à noter. Cette déformation de la mentalité allemande s'est révélée d'une façon frappante durant la grande guerre. La leçon nous aura-t-elle servi? Souhaitons-le!
Lorsque le jeune O. Sacré demandait et obtenait de correspondre avec ses parents, ses ennemis arrêtèrent joutes ses lettres: le héros partit au supplice sans aucune consolation des siens. Sa famille ignorait son arrestation; il arrivait fréquemment que Sacré, en service à Ougrée, s'absentait pendant deux mois.
On comprend la stupeur douloureuse de ses parents quand ils connurent, par les affiches rouges, l'exécution de leur enfant. Leur douleur fut tragique; l'année suivante, leur second fils, volontaire de guerre, tombait glorieusement devant Dixmude.
Avant de mourir, O. Sacré rédigea cinq lettres; écoutez la douleur déchirante de cette âme au pied du calvaire. Je souligne les phrases qui disent sa détresse devant l'absence des siens. Il les suppliait de venir lui dire adieu, et ceux-ci ne répondaient pas; on le méprisait donc! Il se sentait seul, tout seul pour mourir; et cette pensée le torturait atrocement.
O calvaire de nos martyrs, quelle douleur et quelle admiration lorsque nous vous méditons!
Dans ses deux lettres que je reproduis textuellement, on trouvera tant de simplicité, de fraîcheur, de tendres reproches et de pardon, mais dans tout cela, quelle douleur! quel héroïsme!
« Faite le mercredi 27 octobre 1915.
« Mon cher frère Joseph,
« C'est avec la plus profonde douleur que je vous fais part de ma condamnation, car c'est la peine de mort que je dois subir.
« Je regrette beaucoup de ne pouvoir vous revoir avant de mourir, c'est malheureux.
« Concernant mon argent et mes effets, j'ai donné la liste du contenu à mon frère Armand.
« Je vous avais écrit à tous, mais il n'est venu personne pour me voir, maintenant je suis à la Chartreuse, où je vais mourir dans quelques heures et où je serai enterré avec mes compagnons, alors trop tard pour me voir. Mon heure est sonnée et si vous voyez encore quelque chose, ce sera un cadavre.
« Maintenant je finis ma lettre en vous embrassant de loin de tout mon cœur et en vous disant adieu à tous.
« Recevez les derniers baisers de
« Votre frère qui vous aime,
« (S.) OSCAR. »
« Chers parents et amis,
« À mes frères et sœurs,
« C'est avec regret que je vous apprends cette triste nouvelle. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de courage, et voilà que maintenant il me faut cesser de vivre et, pourtant, je me suis toujours très dévoué pour vous, chers parents. Pendant mon service, j'ai toujours servi la patrie de mon mieux.
(Suivent alors trois lignes biffées à la censure.)
« Vive la Belgique.
« Chez mon patron, j'ai trois costumes, trois paires de souliers et une masse d'affaires dont je ne pourrais pas vous faire le détail. Tout ce qu'il y a dans la garderobes dans ma chambre, c'est pour vous tous, maintenant. Chers parents, j'ai encore 77 fr. 50 au commissariat de police allemande du Palais; veuillez les réclamer: cela vous revient également. Mon patron me doit encore 37 fr. 50 pour septembre 1915. Je vous lègue tout, chers parents. Dites bien à ma chère fiancée qu'elle conserve mon portrait et que je la souhaite bien heureuse avec un autre. C'est la servante de chez Plainevaux, Mlle Rose Coranberghs. Je vous avais écrit à tous assez tôt; vous n'avez pas daigné venir me voir; maintenant, il est trop tard, on me...
(Suivent deux lignes biffées.)
« Je vous pardonne votre ingratitude, je vais mourir et c'est à la Chartreuse que vous viendrez pleurer sur ma tombe. Adieu! tous ceux que j'aime. Je vous attendrai à bras ouverts dans l'autre monde. Ma montre et ma chaîne, frère Armand, faites-en cadeau en souvenir de moi à votre fils Charles.
« Adieu! Tous, adieu!
« Votre frère qui vous aime en mourant,
« Oscar SACRÉ. »
« Fait le 27 octobre 1915, à la prison de
Saint-Léonard, à 10 h. 1/2 du soir. »
(Suivent deux lignes biffées.)
Il fut abattu par un matin frileux d'octobre dans la cour de la Chartreuse, à Liège. Il marcha à la mort sans pleurer, d'un pas ferme et résolu. L'aumônier allemand qui l'assistait admira le courage surhumain de ce jeune Belge, qui tomba, affirma-t-il, en criant d'une voix forte: « Vive la Belgique! »
Henry DEFÈCHEREUX
C'était en 1904. H. Defèchereux, né à Esneux le 1er août 1891, accompagnait joyeusement sa mère au village, où elle vendait régulièrement de beaux fromages blancs à des clients habituels. Ils longeaient le canal. A un endroit de la route, la mère entra dans une maison, pour y déposer sa marchandise, et laissa son enfant sur le chemin. Le petit Henry flâna en attendant le retour maternel. Tout à coup, un cri déchire le vent: « Defèchereux! vite, il y a un gamin à l'eau. » Il se retourne: de l'autre côté, au delà du canal, un ouvrier carrier désespéré, lui désignait deux petits bras qui se débattaient tragiquement dans l'eau; un enfant se noyait: le courant l'entraînait rapidement et déjà la roue d'un moulin offrait ses pales pour le broyer.
Sans hésiter, Defèrecheux plonge dans le cours d'eau, et après un combat émouvant ramène l'enfant sur la berge. Il était temps; un instant plus tard, la roue du moulin les cassait tous les deux.
Defèchereux avait treize ans.
Lorsqu'au mois de juillet, à l'école communale, devant les édiles réunis, il reçut des mains du bourgmestre ses derniers prix, il eut la douce surprise d'une récompense méritée: devant une assemblée en délire, le premier magistrat d'Esneux rappela en une vibrante allocution son héroïsme et, après une émouvante péroraison, il prit l'enfant dans ses bras, l'embrassa, le souleva et le présenta à la foule comme un modèle de devoir civique; puis sur sa petite poitrine il épingla la croix de sauvetage que la Belgique lui décernait.
On devine l'émotion des spectateurs, fiers de leur jeune compatriote.
Defèchereux vécut en héros et mourut en héros.
A quatorze ans, il devint manouvrier à Liège; et le soir, le travail fini, il se rendait à l'école, où sa jeune intelligence s'enrichissait de connaissances nouvelles. Deux ans plus tard, il devint chauffeur de locomotive. Hélas! quelques mois après, dans un stupide accident de chemin de fer, il perdit son bras gauche. On le nomma garde- barrière à Waremme, d'où il revenait chaque soir pour vivre quelques heures auprès de sa mère qu'il chérissait ardemment.
Sept ans après, la guerre éclate; et tout de suite, devant la monstruosité du crime, son cœur de Belge se révolte. Il veut s'engager; manchot, il fut refusé. Il en souffrit. Lorsque, sous ses yeux émerveillés, l'armée belge soutint superbement l'assaut prussien, c'est avec les larmes dans les yeux que, devant sa mère, il laissa tomber ces mots:
- Dire que je ne peux pas m'en aller!
Puis, attiré sans doute par une vision fascinatrice:
- ... Mais je ferai toujours quelque chose!
Dès ce jour, sa conduite changea. On l'interrogeait. Il restait muet. On ne connut que plus tard l'héroïsme caché sous le voile du silence.
Habitant à Angleur proche le chemin de fer, Defèchereux fut espion, espion ardent, passionné, dans le service du commandant Wallner. Ses renseignements fournis étaient précieux.
En septembre 1915, la police allemande l'arrêta; et tout aussitôt les charges qui pesèrent sur lui ne lui laissèrent que peu d'espoir sur son sort.
Defèchereux fut brave, toutefois! Son unique souci, c'était sa fiancée, sa sœur, et sa mère surtout: il était son soutien, car elle était veuve depuis peu de temps; l'idée que peut-être il devra la quitter à tout jamais le fait frémir.
Il écrit à sa fiancée: « Si je suis fusillé, protège ma mère. Remplace-moi dans tout comme si j'étais toujours là; j'aurai du moins la consolation de savoir auprès d'elle une fille qui chérira ma mère et ma sœur Berthe comme l'a fait le fils!... »
Plus loin:
« Sois bonne pour maman et pour Berthe. Reporte l'amour que tu avais pour le fils sur la mère et la sœur chéries, et surtout dis-leur qu'elles ne pleurent pas; disleur que je reviendrai après la guerre. »
Puis, il écrit à sa mère une lettre où son cœur filial s'efforce de calmer ses douleurs et ses inquiétudes. Il la rassure sur son sort, la confie à la garde de Dieu, et lui demande de garder un fier courage.
Hélas! Le conseil de guerre allemand le condamna à mort en même temps que neuf de ses compagnons: Béguin, O. Sacré, L. François, F. Van den Snoeck, J. Legrand, L. Gillet, J. Gilot et H. Noirfalize.
Ce que Defèchereux endura dans la carcère allemande, nous le devinons dans cette phrase très laconique griffonnée sur le mur de sa cellule: « Souffert cinq semaines dans cette cellule. »
La peine de mort confirmée, Defèchereux se prépara à bien mourir. Il ne tremblait pas. « Je meurs pour Dieu, le Roi et la Patrie, » écrivit-il.
Il rédigea plusieurs longues lettres.
Le sentiment prédominant dans ces lettres, c'est le désir du pardon pour le mal fait aux aimés.
Il comprend aussi l'atroce douleur dont il est cause; il veut encore la lénifier par des mots de tendresse et de vaillance.
La résignation chrétienne à l'épreuve si terrible le fortifie et l'auréole de bravoure calme mais tenace.
A sa fiancée, qu'il honore si grandement d'une confiance magnifique et d'une estime profonde en lui confiant la garde des siens, il supplie aussi un pardon; il la délie de sa parole et lui donne le plus beau témoignage d'admiration:
« Liège, le 25-10-1915.
« Chère Fiancée bien-aimée,
« Sois courageuse, chère Adèle; quand tu recevras cette lettre, justice sera faite, le Tribunal m'a condamné pour espionnage, pour crime de haute trahison. J'ai fait mon devoir et il a fait le sien. Je lui pardonne, c'est la justice. Ma mission était là, je devais l'accomplir; oui, c'est tout mon avenir qui paye cela, mais je suis heureux de mon devoir. Je meurs content, j'accepte tout et je pardonne tout. Chère Adèle, j'avais toujours dit que tu serais ma femme, mais toujours j'eus un pressentiment que le malheur serait sur moi sous peu. Quand nous allâmes ensemble à Hamoir, mon cœur était triste, je pensais aux conséquences de ma mission, que je devais finir. Je vais mourir, mais courageusement, en honneur, en honnête homme. Je te demande comme à ma mère, ton pardon, ma chère petite Adèle bien-aimée, accorde-le aussi pour me sauver, pour aller trouver Dieu qui m'attend là-haut pour L'aimer et prier pour toi et pour toute ta famille.
« Mais prie souvent pour ton ancien ami, ton Henri, qui toujours aime sa petite Adèle. Oh oui! je t'aimais, Adèle, d'un vrai amour; tu fus toujours une brave et surtout une honnête fille.
« L'heure avance, deux heures et demie. Pardon, Adèle. Pardon aussi à toute la famille. Toi, chère amie, tu es libre de ta parole, mais sois maintenant comme une bonne amie pour ma mère chérie, car je ne puis plus dire une fillette, je n'en ai plus le droit, car je dois mourir, mais j'ai ta promesse de secourir maman dans tout.
« Sois bonne pour maman, pour ma sœur. Ton grand amour, que tu me témoignais, reporte-le sur maman et sur ma sœur chérie. Fais comme si tu étais toujours ma petite fiancée, plus tard tu seras heureuse: je prierai pour que tu aies du bonheur dans un heureux mari, mais pense souvent à ton cher ami pour sa chère maman et pour sa sœur aimée.
« Pardon, Adèle, pardon pour le grand chagrin, priez beaucoup pour moi ainsi que Léopoldine et toute ta famille.
« Amitiés à Fernande et Flore, à tous pardon. Priez, croyez en Dieu, priez beaucoup pour moi, moi je prierai beaucoup pour vous. Adieu! l'heure avance, je meurs en vous embrassant tous.
« Chère Adèle, adieu! Console maman dans tout; apprends-lui la triste nouvelle. Dis à Eugénie de rester quelque temps auprès de maman pour la consoler. Je serai exécuté, je crois, à 4 heures. J'ai fait mon devoir avec honneur. Adieu à tous. Pardon, Adèle, pardonne-moi. N'oublie pas ma mère, sois bonne pour elle. Prie beaucoup. Mes adieux chez toi, à tes bons parents, à toute leur grande famille, chez Léopoldine.
« N'oublie pas maman et ma sœur. Fais tout pour moi et chez moi comme pour toi avec Paul et Eugénie et Léopoldine...
« L'heure approche, je pars à 12 heures. Adieu! pardon, mon Adèle, Léopoldine, Paul et Eugénie, tous mes amis, adieu à tous.
« J'ai fais mon devoir pour Dieu, le Roi et ma Patrie. Ma Mère, ma Sœur, Adèle, pardon. Adieu!
« Votre fils, frère, fiancé bien-aimé,
« (S.) Henri DEFÈCHEREUX,
« Fusillé le 25-10-1915.
« Liége-Chartreuse. - Adieu Adèle. »
Ces écrits se passent de commentaires; relisons-les et méditons-les souvent, afin de nous fortifier à cette source vivifiante de Beauté.
« Honneur et Patriotisme sont mes seules espérances », écrivait ce jeune martyr. On comprend qu'avec pareille devise les cimes l'es plus hautes de l'Héroïsme aient été gravies par cet humble et jeune ouvrier.
Léon TRULIN - Un Petit Martyr de Chez Nous
Léon Trulin était un petit gars de seize ans. Du rêve et de la lumière palpitaient dans ses yeux.
Né à Ath, le 12 juin 1899, second fils d'une famille de dix enfants, bien qu'il connût dès le jeune âge les durs labeurs du manouvrier, le travail ne le rebutait pas; l'exemple de son père, plombier, de sa mère, ouvrière fourreuse, lui enseigna le prix du labeur.
On le disait chétif, mais plein de volonté. Exilé à Lille, où il perdit son père et son frère aîné, il loua ses frêles bras dans une usine; et là, petit apprenti, par son travail et sa cordialité il conquit rapidement l'estime de tous. Les écoles du soir, suivies régulièrement, complétèrent son éducation intellectuelle.
Quel rêve hantait ce petit cerveau? Nul ne le sut. Ne fut-il pas celui de toutes les belles âmes d'enfants où l'on sent vibrer une claire ardeur à l'éveil de la vie, de ces enfants au regard infini où frissonne un idéal, et que l'on meurtrit parfois par une indifférence maladroite, une brusquerie coupable, ou des conseils de maître, vides d'affection? Et lui, ne tendait-il pas à faire de soi un homme, intelligent, généreux, bardé d'une volonté tenace, qui dompterait la destinée marâtre? Une belle idée l'animait qui lui fit une âme d'élite, et qui l'aurait rangé dans le bataillon des Forts.
La guerre vint... noire, ravageuse, fille de la science et de la philosophie allemandes.
Le petit Trulin avait entendu raconter par des fuyards et des exilés les carnages atroces; son cœur avait bondi de révolte au récit de « leur » épopée sanglante.
Il avait entendu... et il souffrait; cœur délicat, il aimait tant sa Belgique! La grande blessure de cette mère aimée lui faisait mal, et voilà pourquoi quelque temps plus tard il partait. Il obéissait à l'angoissant appel de la patrie; il écoutait le ralliement sauvage des clairons guerriers et des bourdons de chez nous.
Il partit; vers quelle aventure! Cœur assoiffé de servitude, il s'immola déjà au seuil de sa course: découvrir des hangars d'aviation, des poudrières, repérer des lignes de chemin de fer et des routes militaires, dénombrer les contingents de troupes, surprendre des secrets et les transcrire, courir les routes la nuit, et se glisser aux avant-postes, tout cela est l'œuvre de ceux qui, loin des gloires militaires, subjugués par la grande loi du devoir, ignorants des honneurs et des fastes guerriers, dans l'ombre, à toute heure, nuit et jour, n'attendant comme récompense que les âpres joies d'un beau travail et les fortes émotions du métier, se sacrifiant, en service commandé ou non, à l'ordre impérieux du pays et de sa sauvegarde, pour que leur cœur, leur esprit et leur volonté immolée, la patrie soit plus grande dans la victoire assurée. C'est l'œuvre de ce qu'il y a de plus beau dans la servitude patriotique: l'espion.
Léon Trulin pérégrinant à travers le pays, fut espion, poussé par l'occasion au début, par passion plus tard; et c'est un soir que, dans une tentative de passage à la frontière, il fut arrêté par des patrouilleurs allemands. Le 12 octobre - jour tragique, où Philippe Baucq et Miss Cavell étaient fusillés à Bruxelles - Trulin fut envoyé à la Citadelle de Lille où commença le dur calvaire des instructions et du procès, Golgotha de pas mal de nos martyrs.
Le 7 novembre 1915, le tribunal de campagne le condamna à mort.
Dans son carnet, le petit Trulin écrit:
« Je meurs pour la Patrie et sans regret. Simplement. Je suie fort triste pour ma chère mère et mes frères et mes sœurs, qui subissent le sort sans être coupables. J'embrasse de tout mon cœur ma pauvre mère et j'espère que Dieu la préservera pour sauvegarder ses autres enfants qui lui sont si chers. J'embrasse aussi Emile, Edgard, Edmond, Adolphe, Eva, Célanie, René, ainsi qu'Alida et Angèle et ses enfants et mes autres parents et amis. Je pardonne aux Allemands. J'ai fait mon devoir, mais ils ont été très durs pour moi.
« Chère mère, j'espère que vous me pardonnerez avant de mourir, sans faiblesse, avec beaucoup de courage. »
Plus loin, il ajoute:
« J ai coiiiiance, et je saurai mourir couragement et, plus tard, vous pourrez dire que je suis mort en bon chrétien, en bon patriote et Belge. »
Comme l'heure avance et qu'il désire prendre un peu de repos pour bien mourir, il écrit à sa mère une lettre d'adieu:
« Ma bien chère mère,
« Je suis désolé de tout ce que j'ai fait, depuis le 30 juin, jour de mon départ.
« J'ai bien souffert pendant le mois de juillet, souvent sans feu, ni lieu, puis au mois de septembre, la vie a changé, j'ai été un peu plus heureux. Je me suis distrait en Hollande, pendant un mois en Angleterre, puis de retour en Belgique, puis, crac, voilà le malheur, je me fais prendre par malchance à une demi-minute du territoire hollandais.
« Je vous en supplie, ne désespérez pas et vivez pour René qui serait orphelin, malheureux. Vivez aussi pour mes frères et sœurs et montrez l'exemple de la résignation et marchez la tête haute, votre fils s'est dévoué pour la patrie. Vive la petite Belgique! Je vous embrasse bien fort, et courage, mère! Nous nous reverrons un jour; embrassez mes frères et sœurs pour moi et dites-leur que votre fils a su mourir en brave. Maintenant je vais me coucher (il est déjà tard) pour être prêt, frais et dispos demain, jour de l'exécution.
« Je pardonne à tout le monde, amis et ennemis. Je fais grâce parce qu'on ne me la fait pas...
« Votre fils qui vous a fait tant souffrir et qui en est peiné.
« Léon Trulin. »
II fut immolé dans l'aube blanche du 8 novembre 1915. Chrétien, il avait formulé le désir d'être assisté d'un prêtre. Un peu après 6 heures du matin, l'abbé Paullet pénétra dans la cellule où Léon Trulin, agenouillé sur le parquet, priait déjà. Au bruit des clefs dans la serrure, l'enfant, pris d'émotion, a levé la tête: il croyait voir celle pour'qui il aurait tant voulu vivre encore: sa maman. Mais le prêtre entre.
- Vous êtes seul? demande l'enfant.
Drame atroce! Sa maman! L'embrasser une dernière fois et vivre encore quelques minutes clans la bonne étreinte! Vous êtes seul? Phrase poignante!
- Non, répond doucement l'abbé; et sur sa poitrine, il a montré la blanche Hostie.
L'heure approche. L'enfant est autorisé à dire adieu à ses compagnons, échappés à la mort par une condamnation aux travaux forcés, et enfermés dans une cellule voisine. Il est grave et beau. Il leur serre la main, et leur offre des cigarettes, en silence... Un des condamnés pleure:
- Tu pleures? fait l'enfant. Tu n'es pas un homme.
Il ne pleurait pas, lui. Il voulait mourir en soldat. Maintenant il leur dit adieu affectueusement. Un des prisonniers, celui qui l'a trahi, hésite; le remords le ronge... Et l'enfant s'approche doucement, lui prend la main, inonde celte âme de sa miséricorde:
- Je vous pardonne! dit-il.
Sa dernière victoire est une conquête sur lui-même; il a compris le calme bonheur, la sérénité bienfaisante, qu'il versait dans ce cœur torturé par le sombre regret; et pour que le remords n'énerve plus ce malheureux, l'enfant, le condamné à mort, pardonne...
Grande leçon des morts aux vivants!...
Accompagné de l'aumônier qui l'encourage, comme Augusta encourageait son enfant, Symphorien, que les gardes de Marc-Aurèle conduisaient en 178 au billot: « Courage, ô mon fils! Courage! Nous ne pouvons craindre la mort lorsqu'elle nous conduit à la vie! Levez votre cœur en haut. » Encadré de deux soldats prussiens, l'enfant marche d'un pas nerveux.
- Avez-vous du courage? demande l'officier qui craint une dépression au moment fatal.
- J'en aurai, répond-il doucement.
L'aurore coule ses lumières grises dans les arbres. Des oiseaux gazouillent dans les berceaux. Une fraîcheur matinale refroidit les joues. La nature est douce, mais si triste... Dans le fond de la cour, par terre, au pied d'un mur, une planche attend le condamné.
- Voulez-vous qu'on vous bande les yeux?
- Non. Je préfère ma liberté, répond simplement l'enfant.
On lui désigne la planche; on l'invite à s'y mettre. Le jeune héros hésite.
- Est-ce que ça fait souffrir? demande-t-il tout bas à son aumônier.
Il a déjà tant souffert! Un mal bref, ce n'est rien; mais souffrir, être torturé longuement, est-ce que toi, petit corps, tu supporterais tout cela Et pourtant, sa volonté est d'être brave et de ne pas faiblir devant l'ennemi.
- Est-ce que ça fait souffrir?
- Non, c'est instantané, dit le prêtre.
Il se place aussitôt sur la planche, en face des fusils, embrasse son aumônier, découvre à nu sa poitrine où bat une grande âme et montre son cœur.
Son âme était un lis que Dieu cueillait pour parfumer le ciel de sa fraîcheur candide!
Tirez, soldats prussiens, serviteurs avilis de bourreaux sanguinaires! Tirez, rouges meurtriers! Tirez dans ce cœur de seize ans! Sous vos balles assassines, c'est un jeune héros qui tombe en martyr...
Dans la terre où on l'enfouit, on piqua une petite croix grise... L'hiver pleura sur le tertre. Quand l'été versa ses urnes d'or, une mésange égrenait ses cantilènes dans le tilleul argenté qui ombrageait la tombe...
Gabrielle Petit
Depuis la guerre, la Belgique compte des Jeanne d'Arc. A la tète de cette fière cohorte se détachent avec vigueur les admirables figures de la courageuse Mme Prudence Desmet, épouse Jacques Preney, fusillée à Gand; des deux vaillantes jeunes filles Emilie Schatteman et Léonie Rammebo, et de Elise Grandpry, cette noble et superbe martyre qui, en réponse à son geôlier, se réjouissant de voir si elle serait aussi hautaine devant le poteau où les soldats la coucheraient en joue, qu'il irait d'ailleurs s'en rendre compte, répliqua fixant sur lui ses yeux limpides: « Et bien, si vous y venez, vous verrez comment une femme belge sait mourir. » Au centre de ce groupe héroïque, la fière figure de Gabrielle Petit.
Ce nom a retenti dans le monde entier. Il est la synthèse de toutes les vertus qui animèrent nos femmes pendant la guerre, un symbole de l'honneur et du patriotisme.
Voici pour ceux de demain ce que tous ceux d'aujourd'hui connaissent déjà:
Gabrielle Petit était une modeste employée de vingt-deux ans, haute en courage autant qu'en simplicité, dont la jeunesse difficile et laborieuse avait forgé une âme d'élite.
La guerre déclarée, la petite Gaby - comme on l'appelait - s'enfuit en Angleterre, d'où elle revient avec une mission dangereuse. Elle fut espionne; lorsqu'on lui montre les dangers de pareil travail, avec simplicité, elle répond:
- Je sais, j'ai réfléchi, je persiste, car cette carrière signilie le dévouement total à la Patrie, le maximum de ce que peut faire pour son pays une femme et une fiancée de soldat.
Gabrielle était, en effet, la promise d'un petit soldat de l'Yser que, blessé à Liège, elle avait soigné pieusement, puis reconduit sous les drapeaux.
Elle opérait sur le front d'Ypres à Maubeuge. Toutes les ruses, elle les connut et les pratiqua. Tour à tour, elle se fit bonne d'enfant, pêcheuse à la ligne, voyageuse de commerce, colporteuse de journaux, réfugiée ou parente pauvre en villégiature, changeant d'attitude et de tenue, suivant l'heure, le danger, ou l'aventure. Ses adversaires les plus difficiles à dépister furent les détectives allemandes féminines qui sillonnaient sans relâche la contrée, photographiant toute figure suspecte et notant chaque allée et venue.
Si nous voulons connaître les principes d'action qui guident cette jeune patriote, les phrases suivantes nous les révèlent:
- Mon devoir de chrétienne est d'employer mon activité à la tâche patriotique la plus haute et la plus utile. Or, rien n'est plus utile que le service des renseignements: ainsi, je puis faire le plus de mal à l'ennemi, sauver le plus de soldats alliés, et peut- être contribuer à la Victoire qui doit venir... S'il me faut y perdre la vie, c'est que la Providence m'aura jugée digne de la mort la plus belle qui soit: la mort pour la Patrie et la Justice. Il n'y a pas plus magnifique emploi de vie, ni plus beau départ pour l'éternité.
Vers le mois de septembre 1915, tous ses chefs arrêtés par les Allemands, d'aucuns fusillés, Gabrielle Petit entreprend de réorganier le service; et tout aussitôt, elle lui donna une vie nouvelle, un essor plus audacieux, une ampleur plus farouche.
Chef de service, Gabrielle Petit, connue sous le nom de guerre de Mlle Legrand, trama contre l'Allemagne les plus noirs complots jusqu'au 20 janvier 1916. Elle tomba dans une souricière; on ne la relâcha plus.
Elle raconta plus tard à sa tante et marraine, Mlle H. Sigard, comment elle fut prise:
- Mon courrier ayant été arrêté, on m'envoya un Hollandais. Cet homme ne me revenait pas; c'est lui qui m'a vendue; il me dit que la veille, il avait été aux Folies- Bergère. « Oh! vous ne conviendrez pas, mes hommes sont des hommes sérieux et non de votre trempe ». Malheureusement, il avait le mot de passe; j'hésitai fort à lui remettre mes rapports. Le moment était solennel, je risquai; j'ai joué quitte ou double, marraine, et tu vois, c'était double; je suis ma foi en prison, et... au bout de ma course.
Le lendemain de la visite de ce Judas, on arrêtait Gaby à son domicile.
Dès lors commença le calvaire, qu'elle gravit le sourire aux lèvres, alerte et farouche. Les limiers espéraient un aveu sur l'organisation de son service. Héroïne, elle emporta son secret dans la tombe.
Devant le Conseil de guerre Gabrielle fut sublime.
On lui offre un avocat allemand.
- Si vous ne me donnez pas un avocat belge, je refuse d'être défendue. Après tout, pourquoi un défenseur? Ma condamnation doit être écrite d'avance. Cessez cette parade de la justice.
- Pourquoi avez-vous agi?
- Par haine contre votre régime, et surtout par amour pour mon pays et mon Roi.
- Votre Roi! fait un des juges, c'est un roi de carton, une poupée.
- Mon Roi est dans les tranchées avec ses soldats, répond-t-elle farouchement; votre Kaiser est à l'arrière avec ses courtisans.
- Pourquoi nous voulez-vous du mal, à nous qui ne vous avions rien fait?
- Comment, vous ne m'avez rien fait? C'est un comble. Vous m'apparaissez comme le mal incarné. Vous avez pillé, ravagé, brûlé notre pays; vous avez massacré et torturé non seulement nos soldats, mais des civils innocents, des femmes et jusqu'à des petits enfants.
- On vous a fait accroire ces choses!
- Non, j'ai vu; j'ai vu de mes yeux vos incendies à Maubeuge; j'ai trouvé des mains coupées d'enfants, dans les sacs de vos soldats; je vous vois encore près de Charleroi lier atrocement de pauvres femmes et les jeter dans la Sambre, avec des huées féroces. Je vous ai vu tuer le mari innocent d'une femme qui le couvrait naïvement de sa jupe pour le soustraire aux coups de vos bourreaux: c'est moi qui ensevelis le cadavre. J'ai vu...
- Taisez-vous! D'ailleurs une femme ne doit pas s'occuper de politique.
- Une Allemande, peut-être! Mais les femmes belges sont citoyennes de leur pays. Je dois défendre ma Patrie opprimée, le mieux que je le puis.
- Savez-vous que votre métier d'espionne mérite la mort?
- Je ne.suis pas une espionne comme vos espions. Je vous ai espionné dans mon pays, pour mon gouvernement, pour ma Patrie, alors que vous êtes dans mon pays contre tout droit, après avoir violé vos serments et que la justice vous défend même de me condamner. Vous n'êtes que la force. Vous me tuerez. Faites vite.
- Si on vous graciait, que feriez-vous?
- Je recommencerais.
- Si vous étiez juge que feriez-vous?
- Je ferais de vous une sentinelle et je vous apprendrais le métier.
- Vous commandiez à des centaines d'hommes; faites-nous connaître vos agents!
- Ne m'insultez pas. Vous savez bien que je suis incapable d'une infamie. Vous ne connaîtrez rien.
- Vous êtes cause de la mort de plusieurs milliers de soldats allemands.
- Vous me rendez bien heureuse. Vous êtes des lâches, oui, des lâches; je ne vous crains pas; tuez-moi; je suis remplacée; tout le service continue; c'est ce qui me fait plaisii.
- Vous aurez la vie sauve, si vous consentez à donner seulement quelques indications sur votre organisation.
- Non, non et non, répliqua-t-elle énergiquement.
Elle fut condamnée à mort. Seule devant ses juges, loin de tout regard ami, elle révéla une grandeur d'âme merveilleuse, sans pouvoir espérer l'admiration de ses compatriotes.
Afin d'augmenter encore son supplice, on la fit passer un mois durant par des alternatives de vie et de mort. On ne la tua que le 1er avril.
Le 8 mars, sa marraine obtint l'autorisation de la voir. Joyeuse et gamine, Gabrielle reçut sa tante sans émotion apparente, lui conta par le menu détail les péripéties de son arrestation, de l'instruction, du jugement, et de sa vie en prison:
- Je suis chez moi, ici, marraine; je suis gaie, je chante la Brabançonne; j'habite la cellule 37; j'amuse mes voisines; tous les jours, nous faisons une demi-heure de préau, les femmes d'abord, à trois mètres l'une de l'autre; une de mes compagnes avait de très sales bottines; je lui glissai: tu auras de quoi les frotter. Le lendemain, je lui jette un petit paquet. Vite, le gardien accourt, requis par les deux autres, ils visent le paquet, se noircissent les mains; c'était... Polish. J'ai été privée de deux jours de préau: le troisième, on me dit: « Chortez. » - Non, il y a deux jours que vous me privez, aujourd'hui je ne sors pas, cela ne me convient pas.» Encore on me dit: « Si vous êtes sage dimanche vous irez à la messe. » - « On ne m'a jamais posé de conditions, j'irai à la messe, parce que je suis catholique... »
Je suis ici devant l'ennemi; et c'est à l'ennemi que j'ai affaire. Mon droit et mon devoir est de lui donner du fil à retordre...
« Comme confort, ce n'est pas l'idéal, mais je ne me plains pas. Il faut savoir souffrir pour la Patrie. Nos soldats de l'Yser, dans leurs tranchées de boue, ont la vie plus dure. Sans doute, il y a le supplice des interrogatoires et les tentatives de corruption. Mais bah! demande-leur comme je les arrange. Sais-tu que pour leur montrer mon dédain, je me présente toujours les cheveux en désordre? Ah! que je m'amuse de leurs froissements d'amour-propre et des atteintes à leur dignité. »
Pendant tout le mois, qui précéda sa mort, elle étonne ses bourreaux par sa sérénité et son courage.
Sur son crucifix elle écrivit:
« Je refuse de faire mon recours en grâce dans le but de montrer à l'ennemi que je me fiche de lui. »
Sur le mur de sa cellule elle griffonne avec une épingle à cheveux:
"C'est avec les humbles qu'on fait les héros obscurs" .
Vers la fin de l'après-midi du 31 mars 1915, elle reçut la visite de l'auditeur militaire et de son secrétaire et de l'aumônier qui lui annoncèrent l'exécution de la sentence pour le lendemain matin.
Calme, elle répondit:
- Fort bien! J'ai le temps de prendre mes dernières dispositions.
A six heures elle reçut sa tante. En l'embrassant affectueusement elle lui dit:
- Ma carrière est terminée, marraine, je le savais. Tantôt en venant me chercher, Monsieur m'a dit: On ne rit pas aujourd'hui. - Oh! on ne rit pas? dis-je.- J'avais compris. La visite de ces messieurs ne m'a donc pas surprise. Je serai forte; mes nerfs me soutiendront jusqu'à demain. Tout eût été inutile, j'aurais fait ce que j'ai fait, je ne le regrette pas; ne te fais pas de chagrin, marraine. Ils m'ont encore offert ma grâce si je dénonçais les vaillants qui travaillaient avec moi; cela, jamais! J'ai bien fait, dis? Marraine.
Bon courage; ne te fais pas de chagrin, je pars sans regret. Je t'écrirai cette nuit et terminerai l'ouvrage que j'ai commencé pour toi... C'est un beau jour pour mourir, le dernier du mois de saint Joseph... J'ai tâché de remplir de mon mieux la plus belle mission qui soit. J'ai fait mon devoir. Si je dois mourir demain, je mourrai contente et en brave... Mes meilleures pensées à mon cher fiancé... Sois bien tranquille sur mon attiude à la minute suprême: je saurai mourir en Belge et en chrétienne. »
Lorsqu'elles se séparèrent, Gaby ne pleurait pas; elle souriait dans les baisers qu'elle envoyait à pleine main. Au moment où la porte se refermait, elle cria:
- Adieu, marraine ! Courage, comme j'en ai; et pas de bandeau, tu sais.
La nuit elle acheva son ouvrage de broderie; puis s'endormit. A cinq heures on la réveilla. Elle écrivit trois lettres, dans la dernière, sa confession; les deux autres pour sa sœur et pour sa tante et marraine, Mlle H. Segard.
« Chère Marraine,
« Un dernier mot, ce n'est pas bien long; il est « 5 h. 1/4 (belge); dans une ou deux heures, je vous enverrai mon adieu de loin.
« J'ai brodé une bande pour toi, cette nuit, et j'ai coupé les cheveux que tu aimais.
« Veux-tu bien remettre mon adieu à Hélène et à Maurice; que ma sœur suive tes bons conseils; je lui souhaite heureuse vie. Mon adieu au frère de ma mère, oncle Eugène, s'il vous plait.
« J'ai communié.
« J'ai ton St-Joseph, le scapulaire du Sacré-Cœur, et ton beau chapelet, chère marraine. Adieu. A vous trois, par le cœur. Bon courage, bons baisers.
« A toi par le cœur et l'âme.
Gabrielle Petit.
« Pas de bandeau.
« Beau jour pour mourir, le dernier jour du mois de saint Joseph. »
Peu de temps après, l'aumônier se présente pour la confesser; elle lui dit:
- Monsieur, si vous êtes un honnête homme, vous remettrez cette lettre à un prêtre belge pour qu'il m'absolve. En attendant, je me confesse à Dieu; j'ai, je crois, la contrition parfaite, car j'aime Dieu de toute mon âme, pour lui-même. Dans ces conditions, pouvez-vous me donner la Sainte Hostie?
La Sainte Communion reçue, courageuse, elle descendit de la prison et monta dans l'automobile avec l'aumônier. Pendant tout le trajet, elle récita le chapelet, insistant sur la finale: maintenant et à l'heure de notre mort...
Quand elle arriva au Tir National, belle et alerte, elle bondit devant les fusils. L'officier présente un bandeau pour voiler ses yeux; elle le refuse; on insiste:
- Respectez au moins la dernière volonté d'une femme qui va mourir.
Lecture du verdict est faite; et tout aussitôt elle se redresse farouchement, montre son cœur et s'écrie:
- Vive le Roi! Vive la...
Elle n'acheva pas. Douze balles la couchèrent sur la pelouse; et tandis que l'aube versait ses urnes blanches, elle reçut l'ardent baiser de l'Immortalité...
Georges KUGÉ
Pour bâtir un pays, il faut plus que des bras et des intelligences; il faut des cœurs. C'est pour ne pas avoir compris cette élémentaire vérité que l'Allemagne succombera éternellement sous le mépris et le dégoût des nations civilisées; cette vérité explique aussi la supériorité éclatante de l'âme belge sur l'âme prussienne.
Mme Kugé, née Justine Hanton, avait épousé un Rhénan d'Aix-la-Chapelle; mais du sang belge nourrissait son âme qui la garda pure. Si des principes juridiques la rattachaient à la nation allemande, des liens plus solides l'unissaient à sa terre natale.
De cette union naquit un fils, Georges, qui eut l'âme de sa mère. Bercé dans le parfum des fleurs et le chant de la nature de chez nous, fortifié par les tendresses et les conseils d'une femme au grand cœur, il fut immunisé contre l'intoxication germaine.
Les primes années ont presque toujours, dans l'a formation d'un cœur, une influence si forte qu'on s'étonne bien souvent de voir cet enfant plus tard sans résistance au courant de ses idées et de ses sentiments, malgré la somme, formidable parfois, d'énergie mise en activité.
L'influence d'une éducation affectueuse et saine fut sur Georges Kugé forte et décisive...
Ecolier parfait, remarquable par son esprit de travail, il conquit à la fin de son école primaire, qu'il achevait à quatorze ans, le prix d'honneur.
Bon étudiant, il fut excellent artisan. Sous la direction de son père, il apprit l'horlogerie, et pour perfectionner sa technique, Georges Kugé s'embaucha à Bruxelles; deux ans plus tard, pour acquérir la maîtrise de son art, il « s'exilait » en Allemagne.
A l'âge de vingt et un ans, il opta pour la Belgique, et servit au 9e de ligne, en fils dévoué et modèle; ses chefs témoignèrent plus d'une fois de son zèle et de sa soumission.
Le service militaire achevé, il retourna en Allemagne; mais son père tombé malade, le lils revint au foyer qu'il ne quitta plus.
Quand le cri rauque de la guerre hurla sur la Belgique, Georges était horloger à Bruxelles. Bon serviteur de son pays d'adoption, l'enfant rejoignit sa classe rappelée sous les drapeaux...
Ici commence l'épopée...
Comme du métal au feu, les âpres et glorieux combats de Liège forgèrent le cœur du jeune homme. Blessé, le baptême du sang purifiait son âme d'une tache originelle et vivifiait son énergie que des souffrances corporelles pouvaient annihiler.
Après Liège, ce fut Aerschot qui vit une lutte gigantesque où le jeune Belge épuisa ses ressources physiques. On le réforma.
De Lessines, où il se rétablit, il gagna Bruxelles; et c'est là que par l'intermédiaire d'un gendarme, Victor Remy, il entra en contact avec un service d'espionnage et de recrutement et qu'il devint un des plus fidèles complices de l'abbé de Longueville, un ardent patriote qui montra aux Allemands de quelle valeur était l'âme belge.
Vers septembre 1915, Georges Kugé décida de drainer plus spécialement tous les renseignements utiles dans la province du Hainaut, et en avril 1916 le gendarme Mus, chef de bande, arrêté, il prit la direction complète du service.
Aidé par une connaissance approfondie de la langue allemande, un aspect sympathique et un abord avenant, Georges Kugé se mêlait facilement aux groupes de soldats et à Thuin, dit-on, il poussa l'audace jusqu'à vendre aul officiers prussiens, dans un hôtel allemand, des cigares et des cigarettes portant l'effigie du kaiser.
Déguisé en ouvrier, en soldat allemand, en femme suivant les circonstances, il espionna l'armée allemande vingt-deux mois durant. De plus il avait organisé des postes de surveillance aux gares de Luxembourg, de Schaerbeek, de Laeken, de Bruxelles-Midi.
Service puissant, dont les tentacules s'étendaient dans les zones de Charleroi, Thuin, Mons, Marchiennes, Philippeville, Chimay, Tournai, Blandain, Péruwelz, Louvain, Aerschot, Malines.
Ceux-là qui ne vécurent pas les heures tragiques et l'occupation ou qui ne connurent pas les émotions de ces âpres servitudes, ignorent de combien d'énergie, de souffrances et d'héroïsme était forgée l'activité de ces héros!
Le 14 octobre 1916, Georges Kugé était arrêté, et huit mois durant, les limiers prussiens harcelèrent le corps et l'esprit du jeune héros.
Rien n'ébranla cette, volonté d'airain!
Cœur de soldat, il fut invincible dans la lutte, et cependant que ne souffrit-il pas?
« Mon cas s'aggrave, écrivait-il, étant fils d'Allemand, ayant en soldat servi ma patrie, et en plus, porteur de papiers compromettants. Je ne sais ce qui m'attend et, si je n'avais mes parents, je mourrais content; n'ai-je pas déjà-assez souffert?... »
Le procès infâme qui se déroula, dans l'hémicycle du Sénat, à Bruxelles, les 12, 13, 14 juin, eut son tragique épilogue le 18 juin quand le conseil de guerre, faisant droit aux conclusions de l'auditeur militaire Stoeber, de sinistre mémoire, condamnait Georges Kugé à la peine de mort.
Ceux-là qui assistèrent à ces débuts poignants ont noté la vaillance de ce jeune Belge, qui ne trembla pas devant ses juges et qui, loin de se dérober derrière des explications fallacieuses qui eussent pu mettre en péril la liberté ou la vie de ses compagnons de combat, prit généreusement la responsabilité de ses actes et ne dénonça personne.
Au soir de la dernière audience, il écrivait à ses proches une lettre émouvante dont j'extrais quelques lignes qui montrent qu'il connaissait la situation et que l'issue était fatale.
« Je n'espère plus du tout. Dans quelques jours tout sera fini. Je suis triste et cela me fend le cœur quand je pense à mes pauvres parents et à mon cher frère Henri. Je serai sans doute fusillé jeudi matin. Je puis commencer à compter les heures qui me restent à vivre.
« Ah! mes chers! je vous supplie d'avoir du courage et d'être forts. J'ai beaucoup de courage. Priez pour votre pauvre Georges; il vous a toujours bien aimés. »
A proportion que les jours avancent, l'étoile de l'espérance pâlit; elle s'éteint au matin du 23 juin 1917: le recours en grâce de Georges Kugé était rejeté.
Le lendemain, la mère et l'enfant se rencontrèrent à la prison de St-Gilles. La mère, elle apportait à son enfant le symbole de son amour: des roses et des pensées où éperdûment elle versa ses baisers pour que son fils qui allait mourir y puisât un cordial. L'enfant, il reçut sa mère avec affection, tendresse et pitié.
« Quel sacrifice pour vous, s'il doit m'arriver malheur; pour moi ce n'est rien: j'ai fait mon devoir jusqu'au bout. »
Nous sommes tous des condamnés à mort, chacun à son heure. J'ai communié ce matin à votre intention, pour que, si je dois mourir, vous restiez forte. »
Le condamné consolait sa maman! Et celle-ci l'âme ennoblie encore par cet ultime sacrifice, fière aussi de son œuvre, répondit doucement.
« J'ai fait de même, Georges, et j'ai demandé à Dieu de mettre fin à nos souffrances. »
Oui donc, autre qu'un Dieu pourrait apaiser des douleurs aussi fortes?
« O mère admirable, disait-il, merci de m'avoir aidé à l'heure suprême! Dites à mon père, à mon frère, à tous ceux que j'aime que, là-haut, je veillerai sur vous. Ces roses, dernier témoignage de votre affection, ne tarderont pas à se faner; mon souvenir vivra au fond de vos cœurs. Pour vous et avec vous, j'offre à Dieu et à la Vierge des douleurs le sacrifice de ma vie. Courage!
Le fils tomba dans les bras de sa mère. Leur étreinte écrasa les fleurs... des parfums soyeux baignèrent leur âme et l'inondèrent d'extase...
Quand il quitta sa mère, l'enfant souriait...
Le 24 au soir, la veille de l'exécution, ils se revirent:
« Dans quelques heures, dit-il, je serai fusillé. Je l'ai mérité. Je leur en ai fait assez, mais c'était pour ma patrie. Sois fière de ton fils. Nous nous reverrons un jour dans une patrie meilleure où rien ne pourra nous séparer.
Je mourrai avec ta photographie, celle de mon père, celle de mon frère, et ton nom, ô mère, sera le dernier qui sortira de ma bouche. »
Il remit à sa mère la bague qu'il avait reçue d'elle à l'âge de dix-huit ans.
Leur dernier adieu fut déchirant!...
La nuit, Georges se prépara à bien mourir. Il plaça sous enveloppe, pour qu'on la remît à sa mère, une boucle de ses cheveux, accrocha une rose à la boutonnière de son veston; et au matin, à l'heure où les geôliers vinrent le chercher, pressant entre ses bras les fleurs de sa maman, il sortit, la Brabançonne sur les lèvres...
Quatre heures du matin. Sous l'auvent du Tir National, le peloton d'exécution présente les armes au supplicié qui s'avance... L'aurore caresse doucement l'enfant et nimbe sa tête altière...
Le héros s'assied résolument sur la chaise, à quinze pas des fusils, refuse énergiquement le bandeau qu'on lui offre, et à l'aumônier qui l'assiste, il murmure:
« Père, je suis prêt... »
Lecture du verdict est faite: Mourir!... L'enfant écrase sur sa poitrine les fleurs qu'il n'a pas quittées, hume éperdûment leur parfum suave, et les offrant à l'aumônier:
« Remettez ces fleurs à ma mère, je vous prie. »
Une flamme illumine ses prunelles; le mot « maman » flotte sur ses lèvres...
Un ordre sec. Un crépitement. « Ils » en avaient fait un martyr...
Aux côtés de Georges Kugé, quatre autres Belges, « des hommes », sont tombés héroïquement. Leur crime fut d'avoir servi le pays: Léon Boiteux, François Vergauwen, et les frères Jules et Lucien Descamps.
Honorons ces martyrs: c'est dans le tombeau des morts que vibre l'âme de la Patrie...
Marcel Anciaux
Gustave MUS
Dans l'aurore du 11 août 1916, sur les pelouses du Tir Communal de Gand, les Allemands fusillaient pour « crime de haute trahison » (!) l'avocat Joseph Bract de Audenarde, l'abbé Declercq, Emile Gheluw, commerçant à Courtrai, AIoïs Windels de Ingooïgen, le sous-oflicier de gendarmerie A. Algoct et le gendarme Gustave Mus.
Leur mort fut splendide; et c'est dans un même sentiment d'admiration et de gratitude que nous associons leurs noms.
Vers la mi-mars de l'année 1915, Gustave Mus venant du Havre franchissait la frontière hollandaise.
Né à Duidzeele, près de Bruges, d'une famille de braves gens, ce jeune homme dont les deux frères se couvrirent de gloire dans les services de renseignements, n'avait pas hésité un seul instant lorsque ses chefs lui proposèrent la périlleuse mission de se rendre en Belgique pour y constituer un vaste organisme d'espionnage.
Soldat d'une arme d'élite, éprouvée aux plus durs services, en tout temps dévouée à la défense des Lois et des Institutions, Mus s'était offert avec toute l'ardeur de sa jeunesse, la générosité de son âme et ses brillantes qualités d'organisateur.
Les résultats furent magnifiques. Mais de culture fruste, le jeune espion comprit rapidement qu'il lui fallait un ami de confiance pour déchiffrer les multiples documents que ses sous-ordres et lui-même avaient réunis, un homme trempé de courage pour l'aider dans son audacieuse entreprise, un complice à qui confier certaines besognes qu'il ne pouvait, lui, accomplir.
Le hasard le mit en présence du M. l'abbé Declercq dont on connaît aujourd'hui l'héroïque attitude devant les Allemands - qui, enthousiasmé à l'idée d'une noble servitude unie à celle de l'autel, accepta spontanément la proposition du gendarme Mus.
L'organisation s'étendit à miracle; les espions travaillaient avec acharnement, audacieusement mais prudemment, surveillant les mouvements des troupes prussiennes, détruisant les ouvrages militaires, brisant les projets des états-majors allemands; sans répit, ils harcelaient les ennemis, à coups redoublés.
Sous le ciel noir, tapi dans un ravin, Mus assistait souvent aux accidents dont il était cause, et il goûtait alors un ineffable bonheur devant les résultats obtenus. Il était presque toujours près d' « eux » lorsque la signalisation des chemins de fer sabotée, leurs trains militaires déroutés, s'arrêtaient dans la nuit...
Ont-« ils » jamais connu l'auteur de la destruction de leur poste d'observation à la plaine St-Denis de Gand?
Mus, hélas! allait leur payer cher son rude travail pour la Patrie.
La dénonciation mit le service à Van-de-Route.
Le 29 mars 1916, la police allemande fait irruption chez l'abbé Declercq et le met en état d'arrestation; et tandis que la perquisition commence, des pandours brutalisent le prisonnier et l'accablent des vexations les plus ignobles.
Soudain, un coup de sonnette. Un policier va ouvrir.
Gustave Mus, ignorant l'arrestation de l'abbé Declercq, se rendait comme de coutume au quartier général installé chez le prêtre. On juge de son effroi quand un inconnu lui ouvrit la porte: il avait aussitôt reconnu en lui un des argousins de la police allemande.
Ne perdant pas son calme et payant d'audace:
- Pardon, Monsieur, me serais-je trompé? fait Mus, N'est-ce pas ici qu'habite M. le Vicaire.
- Que venez-vous y faire? réplique le premier.
- Demander si M. le Vicaire ne pourrait pas apporter les secours de la religion à une vieille mère qui se meurt.
- Entrez un instant.
Mus était prêt. Il fallait faire aimable accueil à cette invitation de peur d'être poursuivi par le policier. Peut-être aurait-il chance de s'enfuir, une fois dans la maison, ou de se débarrasser des papiers dangereux dont il était porteur.
Il avança.
Aussitôt entré, on l'enferma dans une pièce de l'habitation. Mais en moins d'instants qu'il n'en fallait au prussien pour avertir ses chefs, Mus ouvre la fenêtre; d'un bond il est dans la rue, et enfile la venelle.
Hélas! le lendemain, le jeune espion voulant être fidèle au rendez-vous se rend chez son courrier. Des gendarmes allemands l'y attendaient; ils le ligotèrent et le jetèrent en prison.
Les instructions commencèrent. La torture opère. Rien n'y fit. Tenace, farouche, héroïque, Gustave Mus ne prononça pas un mot. Aucun secret ne glissa de ses lèvres; et pareil aux chrétiens que dans la Rome ancienne on forçait d abjurer sous les coups de fouet, mais qui stoïquement, les yeux levés sur leur Idéal, tenaient quand même, il soutint avec gloire l'assaut cynique des cruautés allemandes.
« Ils m'ont fait rouler dans une espèce d'armoire en fer, disait-ils; mes chairs se meurtrissaient; je n'en pouvais plus. Ils ont tenté de m'extorquer mes secrets. Mais je n'ai rien dit.
Le jugement vint qui le condamna à la peine de mort.
La veille de son exécution, il écrivit à sa famille une lettre admirable de tendresse, de piété filiale et de patriotisme.
« Gand, le 10 août 1916.
« Très chers mère, frères et sœurs,
« L'heure fixée par le bon Dieu pour me rappeler à Lui, afin d'être à jamais en son royaume, étant arrivée, je vous adresse mon dernier adieu. Demain matin, 11 août, je serai passé par les armes. Courage, mère chérie. Je le sais, le coup que vous recevrez en plein cœur sera douleureux, mais consolez-vous! Ce n'est pas en criminel que je vais subir la peine de mort, c'est pour la libération de vous tous. Consolez-vous! Je serai un saint au paradis, car je meurs avec courage, pour une cause juste. C'est comme si j'allais à une fête. Ce soir, j'ai fait une excellente confession à un aumônier belge, soyez donc tranquille. Bientôt j'aurai rejoint mon cher père et mon cher frère Victor. Mère chérie, soyez forte, songez à la Vierge Marie, Notre-Dame qui, elle, a vu mourir son fils innocent. Puis, plus une vie est courte, moins le compte à rendre est chargé. Courage! Plus tard, nous aurons la joie de nous retrouver au ciel. Mère chérie, transmettez mes adieux à mes frères et sœurs, à mes amis et amies. Faites imprimer des souvenirs mortuaires, avec mon portrait en uniforme de gendarme. Distribuez-les à tous mes amis. Plus tard, vous pourrez vous adresser au corps de gendarmerie pour vous faire remettre l'arriéré de ma solde. Je vous le lègue à l'exclusion de tout autre. Il y a une somme de 1.000 à 1.200 francs à la Kommandantur de Gand. Réclamez-la, elle vous appartient également.
« Vous aurez probablement beaucoup de chagrin de n'avoir pu venir jusqu'ici. Je le leur avais demandé pourtant. Enfin, il n'y a rien à faire, et je ne puis prétendre être mieux traité que les deux ou trois autres qui sont ici dans le même cas. Je meurs avec courage. Ayez-en donc aussi. Votre fils part pour le ciel. Mère chérie, ci-joint, quelques dernières reliques: mes gants, une montre, mon plastron, mon col militaire, mes médailles de Saint Antoine et de la Sainte Vierge. Souvenez-vous de moi dans vos prières. Salut à la famille Verboden et à Mariette. Adieu, mère chérie, chers frères et sœurs.
« Votre Gustave. »
« 1er P.-S. - Remerciez les Petites Sœurs de la Charité de la rue du Moulin, à Gand, car ces bonnes âmes m'ont rendu service en me donnant si longtemps de quoi manger. »
La veillée funèbre commença, émouvante et pieuse. Un aumônier belge le visita dans la nuit et le réconforta de pensées chrétiennes.
A quatre heures du matin, le condamné ajouta un second post-scriptum à sa lettre:
« Bien chers mère, frères et sœurs,
« Il est déjà quatre heures du matin, l'heure de ma mort est proche. Moi, votre fils Gustave, mes camarades Alexandre et Aloïs, nous sommes réunis dans une même cellule. Nous avons passé la nuit à prier, chanter, deviser. La messe va commencer, puis, en route pour le Tir National, pleins de force et de courage! Allons, mère chérie, bon courage! Je vous donne de loin un dernier baiser! Adieu!
« Votre cher fils, Gustave, qui va mourir pour la Patrie. »
La Sainte Messe entendue, Mus et ses compagnons montèrent dans la voiture cellulaire.
Ils étaient calmes et fiers.
Pendant le trajet, ils chantèrent avec amour la Brabançonne qui montait de la voiture dans le ciel rose.
Arrivés au Tir Communal, ils s'agenouillèrent pieusement. L'abbé Declercq, qui avait enroulé son chapelet autour du cou, leur donna une dernière bénédiction.
Droits, sur un rang, ils écoutèrent, sans broncher, le sinistre verdict. Puis, tout à coup, alors que les fusils se levaient sur eux, Gustave Mus s'écria: « Adieu. C'est pour la Patrie! »
Une salve les culbuta...
La Belgique comptait cinq martyrs de plus.
Mathieu BODSON
En parcourant le martyrologe de la jeunesse belge, une pensée jaillit à l'esprit: Admirable pays où dans l'affreuse tourmente toutes les classes de la société ont donné!... Les enfants de la noblesse, de la bourgeoisie et du peuple se sont coudoyés quatre années durant, qui, dans les tranchées, qui, dans les bagnes, ont lutté, souffert ensemble et sont morts ensemble!
De cette réalisation parfaite de notre belle devise nationale, on cherche, à présent, dans la paix, à retirer le plus de fruits possible. La leçon a été grande; puissions- nous ne pas l'oublier!
Celui dont je raconte maintenant l'histoire est un humble ouvrier de Liège, né à Jupille en I8Q3. Trapu, la figure remplie, les yeux rieurs; un cœur ardent.
Volontaire au génie d'Anvers, une subite hernie inguinale, suite d'un effort, le fit réformer. Il l'entra à Bruxelles, la mort dans l'âme. Dure captivité! Des rumeurs sourdes apportaient jusqu'à lui l'écho des batailles, et dans les frémissements du vent errait un peu de la plainte des blessés. Oh! la bataille! Comme cette voix le fascinait!
Se battre! Servir!
« Mon inaction me pesait terriblement. J'avais toujours devant les yeux la division de mes camarades, qui là-bas sur l'Yser étaient utiles au Pays », dit-il plus tard à ses juges allemands.
Cette belle servitude le hantait. Un soir que des voix lointaines gémissaient par delà les Flandres, il décida de rejoindre l'Yser.
Il voulut être de oc bataillon sacré d'esclaves qui, conduits par une idée sur la route de la servitude, s'en vont lentement vers leur but glorieux et qui, à mesure qu'ils la gravissent, plus obstinés, s'enfoncent dans la lumière pour devenir des dieux!...
Opéré dans la clinique du docteur Rouffart, Mathieu Bodson passait la frontière et se présentait aux autorités militaires: « Si je ne suis plus bon pour l'armée, je serai toujours bon pour les fabriques de munitions », pensa-t-il. Mais, réformé, il ne pouvait servir ni au front, ni à l'arrière, « On remarqua peut-être combien grande était ma déception de ne pouvoir trouver à réemployer; car on me proposa de retourner en Belgique pour m'y occuper d'espionnage et de recrutement. Je ne demandais qu'une chose: être utile. J'acceptai donc tout de suite; et l'on m'envoya à Folkestone, où l'on me mit au courant de la technique de mon nouveau métier. En décembre 1915, je rentrai à Bruxelles. »
Rentré avec des papiers de première importance pour de hautes personnalités belges du pays occupé, Bodson installa son centre d'espionnage, de recrutement et du « Mot du Soldat », rue de la Digue, à Ixelles, dans la demeure de la famille Van Damme, tenanciers d'un débit de tabacs; et du jour où Mathieu — que l'on ne connaissait que sous le pseudonyme de Pitje, sobriquet dont il s'était affublé lui- même étant donné la petitesse de sa taille — eut comencé sa propagande patriotique, une théorie de braves se présentèrent à lui: ouvriers et bourgeois, fils du peuple et de l'aristocratie, femmes, jeunes gens, vieillards, piètres, laïques.
Son œuvre? Ce fut d'abord l'espionnage, qui fournit aux Etats-majors des plans si utiles aux opérations militaires. Ses courriers — il en avait dans toutes les directions du pays — lui parvenaient au moyen de licences de marchands de beurre ou d'oeufs. Bodson se chargeait de recueillir les précieux documents et de les porter en Hollande.
Puis vint le recrutement de toutes les forces vives pour les bataillons de l'Yser. Que de jeunes gens n'a-t-il pas conduit* en Hollande en quelques mois ? Il avoua le chiffre de 300. Dans sa tâche patriotique, il était magnifiquement secondé par M. et Mme Van Damme, Mlles Verreke et M. Van Damme et par Mme H. D'Argent.
Lors de son dernier passage de jeunes gens en Hollande, ayant reçu ordre de ne plus s'adonner qu'à l'espionnage, il revint au pays porteur de formidables explosifs!
Travail terrible, mais combien beau! Pitje d'ailleurs était volontaire. Servitude merveilleuse d'autant plus belle qu'elle était libre. Il est grand qui sert son pays les armes à la main, sur la brèche; encore est-il le défenseur obligé et choisi par la Patrie pour la sauvegarde des foyers et îles institutions, il fait son devoir; celui-là est grand, celui-là est beau.
Mais celui qui, spontanément, alors qu'aucun devoir immédiat ne le presse, se fait l'esclave de son idée, de la servitude qui se donne généreusement à la Patrie, qui parfait par un acte volontaire le sentiment d'amour, celui-.là n'est-il pas encore plus grand, n'atteint-il pas la beauté suprême; et cette beauté n est-elle pas divinisée presque du fait qu'il combat non dans les lièvres des batailles, mais dans l'ombre; non l'arme à la main, mais seul, sans défense; non devant le regard des chefs, des amis, des drapeaux, mais dans une solitude marâtre et parfois déchirante... Celui-là n'est-il pas le coryphée des phalanges héroïques?...
Bodson était cet esclave-là, et il prenait fiévreusement la route de cette belle servitude! Hélas! les limiers allemands étaient sur ses traces; ils suivaient des pistes. Devant à tout prix conjurer le malheur possible on insista auprès du jeune espion pour qu'il se réfugiât en Hollande. Pas une seconde il ne céda à ces instances. On eut beau lui montrer le danger imminent, l'importance de sa liberté, il resta inébranlable.
— Je sais, disait-il, ma place est au Tir National! Ou importe! L'essentiel est que ceux qui m'aident dans ma lâche ne soient pas connus par les Allemands.
On insiste. Il refuse.
— Je suis militaire. Je dois rester au poste quoi qu'il arrive. Je ne crains pas la mort.
Et plus tard, simple mais magnifique, il dira à ses bourreaux:
— J'agissais dans le but de servir mon pays et mon Roi; et alors on ne s'inquiète pas des conséquences.
Pitje se cacha pendant quelque temps; puis, costumé en collégien, muni d'une fausse pièce d'identité, il recommença le dur labeur... Mais les mailles du filet se resserraient!
Un jour, le 3 juin 1916, que Bodson (connu des Allemands sous le nom de Pitje) se présenta au contrôle du Meldeamt, il fut appréhendé par des policiers boches et conduit à la prison de St-Cilles. Pitje avait été dénoncé.
Alors ce fut l'instruction et toutes ses tortures.
Qu'ils ont martyrisé Mathieu Bodson!...
Lors de la suprême entrevue, le héros l'avoua à sa mère: « Mère, ne m'en fais pas un reproche; je n'ai fait aucun aveu jusqu'au jour où quatre individus armés de bâtons sont entrés dans ma cellule, m'ont jeté à terre et roué de coups pour m'obliger à parler. Alors, sous l'empire à la fois de la douleur et de la fureur, je leur ai craché à la face, que tout le mal qu'ils me faisaient ne contrebalancerait jamais celui que vaudraient aux leurs les 300 jeunes gens qui, par mes soins, étaient allés grossir les rangs de notre armée. »
Toutes ces atrocités étaient encore augmentées par un régime cellulaire scandaleux, souffrances aiguisées, entretenues cyniquement et dont s'enivraient lé sadisme germain.
Bodson se défendit magnifiquement. Jusqu'au bord de la tombe, il nia avoir fait de l'espionnage. Il ne dénonça aucun de ses complices. A l'audience finale, note un de ses collaborateurs, il fut admirable, digne, correct, le regard ferme et sans faiblesse.
Il écouta la sentence de mort, froidement.
Lorsque le président fit la traditionnelle question: — Avez-vous quelque chose à dire?
Le jeune homme répondit simplement, mais du fond du cœur où vibrait, avec l'indéfectible volonté d'être brave toujours, l'ardent amour de la vie...
— Je demande qu'on me laisse la vie...
Ses bourreaux la lui enlevèrent!
Le recours en grâce rejeté, Mathieu écrivit à sa maman cette lettre, admirable de simplicité, d'affection filiale et de courage, où se reflète une âme fraîche et claire, un cœur honnête et bon:
Le 13 septembre 1916.
Chère Maman,
Mon recours en grâce est rejeté; je serai fusillé demain matin. Je laisse ici ma montre et quelques petites choses, pour qu'on te les remette.
Chère mère, pardonne-moi la peine que cela va te causer; console-toi: il te reste mes deux frères et dis-toi que si je meurs, c'est du moins avec honneur et pour avoir fait mon devoir.
Je ne regrette rien, car, si l'on tient à la vie, il. faut aussi savoir ta quitter quand le devoir l'exige. Chère mère, fais mes compliments à tous mes amis; dis-leur que j'ai eu pour tous une pensée avant de mourir et transmets plus tard mes adieux à ceux qui reviendront de l'autre côté du front.
Ne crains rien, j'ai du courage, et ce sera du reste vite passé.
Si, après la guerre, on met ensemble tous les fusillés, laisse-moi avec les autres. Si on nous sépare, je veux retourner à Jupille.
Pauvre maman, il ne m'est plus permis de te revoir une dernière fois! Enfin, que veux-tu c'est la destinée et il n'y a rien à y faire.
Adieu, mère! Je t'embrasse, oh! combien! ainsi que tous les amis et frères. Je n'écris pas à mon frère Théodore: il saura toujours assez tôt.
Raconte à mon père comment cela s'est passé et dis-lui qu'il peut être fier de son fils.
Maman, que veux-tu que je te dise encore? C'est malheureux, mais c'est la volonté de Dieu. Prie pour moi et les amis aussi. J'espère que Dieu me tiendra compte que j'ai accompli mon devoir et qu'il; me recevra auprès de lui où je prierai pour toi, chère maman.
Rends ma montre à Agnès (sa fiancée) puisqu'elle appartenait à son père; distribue mes affaires comme souvenirs entre mes amis et remercie tous ceux qui se sont occupés de moi. Que tous ceux que j'aurais pu offenser sans le savoir me pardonnent, comme je pardonne à tous ceux qui pourraient m'avoir fait quelque mal.
Adieu, chère maman, adieu! Dis-toi que je vais être heureux et qu'un jour nous nous retrouverons au ciel. Je t'embrasse bien fort.
Ton fils,
M. Bodson.
Remets la fleur qui est dans le porte-monnaie à Agnès.
J'ai arrêté la montre: elle ne doit plus marcher.
Il gravit le calvaire du Tir National à l'aube du 14 septembre 1916. Petit chevalier sans peur et sans reproche, il est tombé avec des paroles d'amour sur les lèvres. Quand il s'affaissa dans le crépitement des balles, il chantait: Vive le Roi, Vive la Belgique!...
Sur le héros abîmé, la Gloire aux ailes blanches se pencha doucement, le couvrit de chauds baisers, et à l'heure où, tissant pour le martyr un linceul de lumière, l'aurore jaillissait des taillis, elle le porta dans l'Immortalité...
Constant CAYRON
Dans l'affreux drame de l'occupation allemande qui secoua Bruxelles en octobre 1910, et qui eut son tragique épilogue sur les glacis du Tir National — je veux parler du procès Philippe Baucq et consorts — il est une admirable figure qui orne le troisième panneau du merveilleux triptyque, où l'on peut lire dans la légende du centre le nom glorieux de Philippe Baucq, dans celle de droite celui de l'héroïque Miss Cavell, et dans celle de gauche celui d'un non moins vaillant patriote: Constant Cayron.
L'héroïsme et la gloire des uns ombrent parfois la bravoure des autres; mais ces humbles sacrifiés du devoir, comme ils sont grands dans leur obscure abnégation! Ainsi que l'écrit Maze-Sencier, ces sacrifiés-là, ignorés et tombés dans l'oubli, n'ont pas été perdus; ils grandissent une nation, ils élèvent le niveau des âmes, ils alimentent la source profonde et intarissable où tout un peuple vient se purifier et se fortifier à la fois; par eux, dans l'enseignement qui s'en dégage, se forment, à vrai dire, la véritable mentalité et le vrai caractère d'un pays.
Constant Cayron avait dix-sept ans à peine quand la guerre éclata: les yeux profonds, inondés de volonté, où flottaient du rêve et de la douceur; les lèvres fines; la taille élancée; la démarche altière; et sous cet extérieur du parfait gentleman, une âme mystique et forte, un cœur ardent et bon.
Le désir de combattre et de servir grondait en lui; aussi, lorsque l'occasion se présenta de se rendre utile à la Patrie, il s'offrit spontanément avec toutes ses forces.
Est-il besoin de rappeler sa propagande intense de la presse prohibée et sa diffusion du « Mot du Soldat »?
La guerre terminée, nous sommes portés parfois à diminuer l'importance, les dangers de ces services et, considérant l'es choses en retrait, nous aimons qu'elles apparaissent plus minuscules pour devoir honorer moins leurs héros: c'est là bien souvent un préjugé de la foule inactive ou apathique pendant la guerre, un sentiment assez mesquin parfois, de ceux qui jalousent l'honneur décerné à ces braves, ou de ceux qui cherchent à plonger dans la nuit les activités d'autrui pour placer les leurs dans la lumière.
Presse prohibée, Mot du Soldat! Dans la mesure de ses moyens, Constant Cayron se dépensa encore dans un service de recrutement.
Constant Cayron était agent de liaison; et eeux-là qui furent du « service Baucq- Cavell » connaissent la valeur de ce jeune dévouement. Acceptant tous les ordres, répondant à tous les appels, s'offrant pour toutes les missions, qu'il accomplissait avec une exactitude méticuleuse, ce jeune homme, quintessence du patriotisme de la jeunesse belge, comprenait qu'il n'y avait de véritable amour que dans le don de soi.
C'est avec des dévouements obscurs que l'on fait des héros. Dans ses notes nous trouvons cette pensée:
— Mon Roi, ma Reine, mon peuple furent héroïques; pourquoi ne le serais-je pas? Probablement, je n'aurai pas l'occasion de l'être avec éclat; mais je veux l'être dans ma petite mesure possible.
Un de ses chefs a résumé par cette phrase l'âme du jeune héros: il incarnait le type du dévouement simple et total. Style laconique, mais chaque mot est une évocation!
Le 1er août — lendemain de l'arrestation de Philippe Baucq — les poches bourrées de Mot du Soldat et de Libre Belgique, il sonna à la demeure du grand patriote, les Allemands veillaient. Cayron tombait dans la souricière!
On m'a raconté l'adresse et le sang-froid par quoi le jeune Belge, trompant la vigilanoe teutonne, parvint à faire disparaître, avec l'aide de Mme Baucq, une partie de ses papiers compromettants.
C'est, tout simplement, admirable!
Devant le conseil de guerre allemand réuni à Bruxelles, le 9 et le 11 octobre 1915, Constant Cayron fut superbe. Ses réponses méritent d'être relatées pour leur laconisme et leur sobriété.
— Aviez-vous dix-huit ans au moment des faits?
— Non.
— Qui vous remettait les numéros de la Libre Belgique?
— Je ne connaissais pas la personne qui me les remettait.
— Où imprime-t-on la Libre Belgique?
— Je ne sais pas.
— Vous vous êtes occupé également du Mot du Soldat?
— Oui.
— Cela était défendu.
— Je l'ignorais.
— On l'avait affiché.
— Je ne l'ai pas lu; il y a tant d'affiches!
— Vous avez coopéré au passage de la frontière par des soldats ou des hommes en âge de milice.
— J'ai remis une liste de jeunes gens qui désiraient rejoindre l'armée.
Si pendant la guerre tous les détenus politiques avaient eu des réponses aussi brèves que celles-ci, peut-être y aurait-il eu un peu moins de condamnations.
En raison de son jeune âge, les juges ne condamnèrent Constant Cayron qu'à deux ans et demi de préson.
Il fut envoyé à la prison de Wittlich!
Wittlich! Le bagne! Vie atroce! Vie de noires souffrances, de luttes. Ceux-là qui l'ont connue ne l'oublieront jamais, la vie du bagne où une nourriture malsaine et insignifiante, une litière immonde et une réclusion perpétuelle annihilait promptement toutes les énergies. Souffrances morales, tortures physiques, aiguisées encore par la brutalité des geôliers à proportion que leur victime était passive ou périclitait.
Ce que le jeune héros endura dans cet enfer, nul ne le sut. Afin de ne pas troubler l'âme des siens, il leur envoyait des lettres réconfortantes et rassurantes sur son sort. Cœur vaillant!
Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont martyrisé cet enfant avec une cruauté inouïe. Ils l'ont abîmé. Ils l'ont tué...
Au début de décembre 1916, exsangue et mourant, les Allemands le renvoyèrent dans sa famille. Les médecins appelés d'urgence ne purent que lénifier les douleurs du martyr... Une maladie qui ne pardonne pas le tenaillait...
Cœur généreux et grand dans la lutte, il le sera dans la mort. A un de ses professeurs, qui s'était chargé de lui faire part de l'arrêt fatal des médecins, Constant répondit doucement:
— Je suis prêt à tout.
Chrétien, la mort ne l'effrayait pas; quand il remarquait l'air attristé de ses parents, inondé de clair bonheur il murmurait :
— Je suis heureux de partir!...
Aine forte et belle, purifiée par les épreuves terrestres, qu'avait-elle a craindre sur les routes divines? Son seul chagrin, ombre pâle dans son esprit radieux, est de laisser les siens dans la douleur; et, comprenant l'immensité de l'affection qui les unissait et que la déchirure serait atroce, il prononça ces paroles profondes et magnifiques:
— Je ne vous quitte pas; mon âme reste parmi vous.
L agonie fui brève. Comme la nacelle bondit plus allègre à proportion qu'elle atteint le havre étoile, son cœur exultait de joie, et les affres de l'agonie s'amenuisaient en une extase béatifique. Dans la souffrance, au seuil du grand voyage, il consolait et réconfortait ceux-là dont il semblait devoir recevoir le viatique cordial. Il était heureux, et la mort hésitait au chevet du héros: un remords la rongeait peut-être de briser cette fleur embaumée. II semblait que l'aile blanche d'un séraphin planait sur le front émaeié de l'enfant et que déjà, elle le portait dans la Beauté immortelle.
Le 6 décembre. Le soir a tissé ses toiles sombres, et les plaintes du vent heurtent les fenêtres. L'agonie fait pleurer les choses; et les cierges fauves tremblotent auprès du moribond; soir lugubre !
Comme il fait triste pour mourir!...
Mais les prunelles du héros brillent quand on lui parle de la mort. Il la reçut comme une sœur; lorsqu'elle le baisa de sa lèvre froide, il s'éteignit dans un sourire...
Cette nuit-là, une étoile d'or scintillait au firmament...
Albert DILLIE
Si j'étais grand-père et qu'un soir, à la veillée, mes petits-enfants me demandassent de leur conter une histoire, je prendrais doucement les mioches sur mes genoux, et, les serrant contre mon cœur, je leur dirais pieusement cette histoire:
Il y avait une fois... C'était pendant les années terribles où les Allemands ont brûlé notre Belgique, tué des mamans, égorgé des enfants; il y avait un petit soldat du nom d'Albert Dillie. C'était un beau cavalier qui partit joyeusement pour la guerre.
Il se battit dans Liège, qui tombait après quinze glorieux jours d'héroïque résistance, et dans les plaines de Haelen où, pendant que les fantassins de l'arrière-garde défendaient pied à pied le terrain, la cavalerie du général De Witte se couvrait de gloire en infligeant de grosses pertes aux ennemis. Il s'était battu comme un diable; il fut blessé, et, pour récompenser sa bravoure, son général le porta à l'ordre du jour du régiment.
Après Haelen vint Anvers. C'était notre refuge national, d’où l'armée de campagne venait surprendre et harceler, par dos incursions nocturnes et soudaines, les troupes allemandes en marche sur la France.
Dans un combat aux avants-postes de Melle, le petit soldat fut blessé une deuxième fois.
Notre héroïque armée fut obligée de se replier sur l'Yser, petit fleuve inconnu qui serpente dans nos riantes plaines flamandes, et qui, à l'approche des Prussiens, colère et vengeur, bondit dans les campagnes pour submerger et détruire les hordes envahissantes.
C'est là, petits enfants belges, que, pour défendre notre pays, votre papa et votre maman, les mamans de vos petits camarades, pour vous défendre aussi, c'est là que 40.000 Belges sont tombés. La France, par la plume d'un de ses poètes, disait à nos héros:
...Que vous étiez beaux,
Quand subissant l'assaut de la rage et du nombre, Reculant pied à pied, de sillon en sillon, Vous restiez l'équipage héroïque qui sombre Sans amener son pavillon.
Comme vous étiez beaux, quand, mourant pour un rêve, N'ayant cédé le sol qu'à l'éclat du tombeau, Vos derniers bataillons, refoulés sur la grève, Tiraient encor, les pieds dans l'eau!
Devant Dixmude, le petit soldat fut blessé une troisième fois; on le nomma brigadier de cavalerie.
Ecoutez bien, mes enfants: ici commence l'épopée. Ce brave, forcé de rester à l'arrière, demanda du service dans l'espionnage, et entra à l'école d'apprentissage de Folkestone.
Le 16 septembre 1916, avec de faux passeports, il arrive sous un déguisement à Bruxelles, se rend aussitôt chez sa mère, son frère et sa sœur, et, pour tromper tout soupçon sur sa mission en Belgique occupée, le petit chevalier du Devoir n'hésite pas à se servir d'un subterfuge superbe: il se fait passer pour déserteur de l'armée belge. Trait admirable de ce cœur sublime! La honte, ra malédiction, le mépris, tout ce qu'un cœur loyal pouvait avoir d'aversion pour la félonie, il le supporta vaillamment. L'âme toujours élevée vers sa mission secrète, il puisait dans les âpres émotions du service et dans la satisfaction du travail accompli un cordial vivifiant.
Dans ses randonnées multiples à travers le pays occupé, il fit sauter le chemin de fer à Ruysbrœck, le grand pont de Bruges! Un soir, il brûla, à la gare de Tour et Taxis, un formidable lot de sacs destinés aux parapets des tranchées de l'Yser.
En vérité, le jeune espion faisait du beau travail! II avait un complice — un traître, hélas! Un soir, accompagné de six policiers, ce Judas pénétra au moyen de finisses clefs chez le frère du jeune espion, où était installé le quartier général de son service.
Le brave se sent perdu. Il veut fuir, mais en vain. Dans une des pièces de la maison, sa jeune nièce agonisait; les affres de la mort la secouaient déjà; à son chevet, le prêtre et le médecin lénifiaient ses souffrances. Les sanglots étouffés des parents coupaient, à intervalles irréguliers, le silence douloureux qui pesait sur les choses.
Ce tableau poignant n'arrêta pas les brutes allemandes. Ils mirent la maison à vau- de-route, se saisirent des principaux complices et du jeune espion. L'interrogatoire de ce dernier eut lieu dans une des chambres de l'étage inférieur; puis, après une demi-heure de vaines questions, les limiers remontèrent avec lui et, devant la mère et la famille éplorées, ils firent connaître leur décision d'emmener leur prisonnier.
Il faut partir. Mais, à l'instant que le jeune héros s'avance pour un dernier adieu, un des Prussiens l'arrache brutalement aux siens. Avec la rapidité de l'éclair, le jeune homme, d'un vigoureux coup de poing, a rejeté l'Allemand contre le mur, joignant à cet acte d'audace un geste de menace terrible qui calma la brute.
Pieusement, il embrassa sa nièce agonisante, serra bien fort contre lui sa maman en lui disant au revoir; lorsqu'il se pencha vers son frère, ce fut un adieu qu'il lui donna. Le fatal arrêt se dressait peut-être déjà devant ses yeux.
On le jeta en prison à Charleroi.
Que fut la résistance de ce brave? Toute de noble abnégation, de tenace résignation et de fîère attitude; elle révéla une fois de plus au Prussien de quelle force morale était tissée l'âme des Belges. Les tyrans ne découvrirent jamais les trames de son service d'espionnage.
Un matin, le terrible verdict sonna, qu'il reçut froidement, sans broncher: le conseil de guerre le condamnait à la peine de mort.
Lorsque le président lui demanda s'il n'avait plus rien à dire et, une dernière fois, lui intima l'ordre de dénoncer le service dont il était l'âme, il répliqua farouchement:
« Je n'ai d'ordre à recevoir que de mon gouvernement; je n'ai pas affaire avec vous. »
...Ici, les enfants inquiets et ardents se redresseraient, brusquement pour me demander : « Et qu'ont-« ils » fait de ce beau soldat? « Ils » ne l'ont pas tué? »
— Ouvrez bien large votre cœur, mes petits; burinez-y l'admirable héroïsme de ce Belge, et n'oubliez pas comment il est mort.
Quand on soumit à sa signature le recours en grâce à l'empereur d'Allemagne, il a saisi nerveusement le parchemin et l'a jeté violemment à la face de l'officier.
La veille du verdict, il reçut pour la dernière fois la visite de sa mère. Lorsque celle-ci lui demanda s'il ne serait pas condamné à mort, il eut une parole admirable qui révélait toute la beauté naïve de son âme de Belge, une parole par quoi son cœur héroïque essayait de consoler un cœur maternel:
— Ne serais-tu pas heureuse de voir demain matin mon nom sur les affiches ?...
En effet, le matin de l'exécution d'un martyr, les Allemands publiaient sur de grandes affiches rouges le nom de celui qu'ils avaient abattu, espérant ainsi calmer nos enthousiasmes patriotiques.
Ces affiches sanglantes, glorieux martyrologe dont nous étions fiers, exaltaient plus intensément encore notre foi et notre amour en la Patrie. La mort était pour les patriotes belges, comme pour les chrétiens des persécutions, l'apothéose et la gloire.
Le lendemain matin, l’aumonier allemand et un officier vinrent chercher dans sa cellule le condamné à mort.
C'était un matin froid de février. Il neigeait. Dans la cour d'une caserne de Charleroi, un peloton de soldats attendait le condamné. Soudain, accompagné de son aumônier, il parut. II fumait la cigarette, portait la tête droite et marchait d'un pas résolu. Les flocons soyeux de la neige lui câlinaient le visage. Il ne tremblait pas.
Devant les fusils, il refusa le bandeau qu'on lui offrait, et, la cigarette aux lèvres, fièrement, il reçut dans la poitrine les douze balles qui le portaient à la Gloire et dans l'Immortalité.
Voilà, mes enfants, comment pendant la guerre, un Belge savait mourir.
Ainsi finit l'histoire de ce petit chevalier sans peur et sans reproche.
Léonie RAMELOO et Emilie SCHATTEMAN - Sœurs dans la Mort
En parlant des morts, le charmant écrivain belge, M. Edouard Ned, disait: « D'âge en âge, quand sonneront au petit village les heures chrétiennes des grandes commémorations, les vivants viendront méditer sur le tombeau des morts et puiser dans leur méditation la volonté de vivre en noblesse et en beauté. »
Dans le pieux pèlerinage entrepris aux tombes des jeunes martyrs belges, je m'arrête à dire, avec plus de ferveur, la juvénile vertu d'abnégation de deux humbles filles, abattues sur les glacis du Tir National de Gand, pour que, les semences jetées, il germe des moissons dorées de vaillance et de générosité; pour que ceux qui m'entendront comprennent l'admirable grandeur de d'âme de chez nous, de l'âme des humbles surtout; et que, suivant la parole d'un autre écrivain de chez nous, M. Carton de Wiart, si les détails de leur martyre peuvent s'effacer, les vérités qu'ils nous enseignent se précisent et grandissent. Les êtres humains qu'ils ont été se transfigurent en une leçon qui se mêle désormais à la formation de notre pensée et qui s'étendra dans l'espace.
Ces vérités prennent plus d'ampleur à l'évocation du martyre de ces deux jeunes femmes.
Léonie Rammeloo naquit à Bouchaute. Emilie Schatteman, originaire d'une humble famille de Philippine, perdit son père, batelier de profession, à l'âge de treize ans.
L'aînée de cinq enfants, elle prodiguait à sa mère, à ses frères et sœurs, de si claires affections et de si douces consolations, qu'elle résolut de devenir journalière à la ville: pour gagner la subsistance de sa famille; elle mit ses jeunes énergies au service des riches. Sa vie laborieuse et résignée, tissée des vertus obscures qui forgent l'âme des héros et qui la révèlent au monde dans les circonstances les plus difficiles, fut si élevée dans l'abnégation que, lorsque le cri rauque du canon hurla sur la Belgique, la jeune fille, prête aux grandes épreuves, répondit avec ardeur à la voix fascinatrice de la Patrie.
La guerre dévoilait à la terre la beauté, la sainteté de ce cœur; car l'occasion n'a jamais créé le héros; et celui qui, par une contention d'esprit et de cœur, n'a, depuis son enfance, tendu ses énergies à la formation parfaite de son âme et la perfection de ses actes, qui en sont la manifestation, celui-là ne sera jamais l'amant passionné de la Gloire ni de l'Héroïsme; ces deux grandes amoureuses désirent des âmes claires; et la purification de celles-ci n'est que la résultante d'un labeur constant, d'un combat sublime, parce qu'obscur.
La famille Rammeloo habitait sur la frontière hollandaise, à une heure de Bouchaute, petit village enraciné dans la terre flamande et où Emilie Schatteman avait sa demeure.
La ligne de démarcation entre la Hollande et nous courait derrière la maison des Rammeloo, de telle sorte que communiquer avec la Hollande était chose aisée.
Le 6 septembre 1915, un service de renseignements demanda l'aide des bonnes patriotes, qui acceptèrent avec enthousiasme l'occasion de servir leur pays. Léonie Rammeloo et sa sœur se rendirent régulièrement trois et quatre fois par semaine au village pour y chercher les renseignements recueillis par Emilie Schatteman et les autres espions. Léonie se faisait accompagner de son neveu, âgé de quatre ans; et les Allemands ne soupçonnèrent jamais que des plis d'espionnage étaient cousus dans les ourlets du tablier du gosse trottinant joyeusement aux côtés d'une jeune fille sur la route de Bouchaute à la frontière.
En possession des documents, Léonie Rammeloo les enroulait d'un chiffon d'étoffe; et, du fond du jardin, elle les jetait en Hollande, où des complices se chargeaient de les porter au Havre. Inversement, des Mots du soldat suivaient le même chemin. Des jeunes gens même, désireux de rejoindre l'armée, se donnèrent rendez-vous dans la démeure hospitalière des bonnes patriotes.
Mais les policiers allemands épiaient... Le 21 janvier, au cours de l'hiver, la famille Rammeloo reçut ordre de quitter la frontière et de chercher logis à Bouchaute- village. Tant bien que mal, le service fut rétabli; mais, quelque temps après, une perquisition eut lieu dans leur nouvelle habitation: ils étaient donc soupçonnés d'espionnage! Perquisition infructueuse qui força cepen-dat les Belges à suspendre leur travail pendant un laps de temps: car la surveillance policière devenait tatillonne; quand elle fut un peu relâchée, l'espionnage reprit.
Mais un matin d'avril, les limiers prussiens forcèrent la maison de Léonie Rammeloo, arrêtèrent cette vaillante; et, pendant qu'elle s'habillait, se coiffait et achevait sa toilette, les rustres la frappèrent à coups de pied.
Incarcérées à la prison de Gand, Léonie Rammeloo et Emilie Schatteman endurèrent des tortures morales et physiques inénarrables. Aucune pitié ne désarma les bourreaux, acharnés sur ces deux femmes; aucun tact ne tempéra le sadisme de ces barbares.
Condamnées u mort, les Allemands laissèrent entrevoir à ces deux héroïnes une commutation de peine; mais, brusquement, le 10 septembre 1917, ils éteignirent le phare qui scintillait à leur horizon: l'exécution aurait lieu le lendemain, au petit jour...
Ce n'est pas sans émotion que j'ai lu les lettres d'adieu de ces vaillantes patriotes qui portèrent sur l'autel de la patrie le sacrifice de leur jeunesse. Elles sont écrites en flamand avec une naïve et touchante simplicité. Chrétiennes, elles se résignent à l'a mort avec tant de beauté! Patriotes, elles n'ont aucun lyrisme pour glorifier leur pays et leur sacrifice; aucun lyrisme où puiser la consolation et la force à l'heure dernière; seule la satisfaction du devoir de Belge accompli simplement les fortifie; et leur mort semble, pour leur âme, l'offrande si naturelle à la Patrie qu'elles se soumettent à cette pensée, et que notre cœur frémit devant tant de pureté, tant d'élévation! Aucune phrase pour expliquer, motiver, exalter leur action patriotique: elles ont servi leur pays comme un Belge le sert. Ames admirables!
C'est chez les humbles que se forgent les plus purs héroïsmes.
Voici des extraits — la lettre était longue — de la missive d'adieu de Léonie Rammeloo.
Chère Sœur,
Courageuse, je vous écris la dernière lettre; ne pleurez pas sur moi, ma chère sœur; c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Que sa très sainte volonté s'accomplisse!... Nous nous reverrons au ciel; je vais glorifier nos chers parents ainsi que nos chers frères, et prierai beaucoup pour vous tous. Priez aussi pour moi.
Notre consolation, c'est l'espoir de la vision de Dieu... Pardonnez-moi le mal que j'aurais pu vous faire. Faites pour moi les pèlerinages que j'avais promis d'entreprendre: un pèlerinage à Lourdes; offrez-y une tète ; un pèlerinage à Stoepe et Kleemkappel.
Je vous remercie pour les bons soins que vous m'avez prodigués. Faites agrandir la photographie de notre père ainsi que la mienne. Je garde une dernière consolation, c'est de vous avoir vue avant ma mort. Nous sommes occupées à écrire notre lettre: il est 8 heures du soir. Dieu nous fortifie; nous n'avons pas de chagrin. L'aumônier nous console: « Un chrétien ne meurt pas, dit-il; mais sa vie changera en une vie meilleure ». Nous recevrons au ciel la couronne des martyrs. Elle sera si belle! Moi et Emilie nous mourrons ensemble.
Nous avions l'espoir d'être envoyées en Allemagne; mais Dieu en a décidé autrement; Il nous appelle à Lui. Sa volonté est notre amour. Tout est vanité sur cette terre; et Dieu nous frappe à l'heure où nous y pensons le moins; c'est pourquoi, très chère coeur, aimez-Le toujours.
Veillez à votre petit garçon, qui est si sage; il était ma consolation. Je l'ai vu souvent en songe, et vous aussi: j'étais à la maison; alors, je me sentais si heureuse. Notre séparation, chère sœur, est bien douloureuse; mais ayez confiance en la consolation de Dieu. Emilie et moi, nous nous consolons mutuellement, nous disant qu'il faut mourir un jour... Demain matin, nous assisterons à la Sainte Messe et, alors, nous partirons dans l'Eternité... Nous prierons Dieu pour qu'il fasse régner la Paix.
Je meurs tranquille avec la certitude que vous vous soignerez. Vous avez beaucoup de compliments d'Emilie. Nous nous aidons jusqu'au dernier moment... Ne pleurez pas sur mon sort; mais priez beaucoup; et, j'en suis persuadée, Notre-Dame du Bon Secours vous assistera...
Je vous répète, ayez courage et confiance. Adieu, ma très chère sœur, mon cher petit ami que j'ai tant aimé, ainsi que toute la famille et amis. Au revoir près de Dieu, dans le paradis.
Bien des compliments et merci pour tous. Voilà, chère sœur et tante.
Léonie
Et, dans la même cellule, à la même heure, Emilie Schatteman adressait à sa vieille mère, à ses frères et sœurs une lettre aussi poignante dans sa simplicité et dans la pureté des pensées. Nous n'en donnons également que des extraits:
Chère mère, frère et sœurs,
Puisque, pour la dernière fois, je puis vous prouver ma reconnaissance, chère, très chère mère, frères, marraine, je vous implore profondément pardon, chère maman, du mal que je vous ai fait; car j'en suis moi-même la cause. Ne pensez jamais à mon acte: vous n'y pouvez rien. Nous partons avec courage. Je pense que Dieu l'a voulu ainsi. Nous devons quand même mourir un jour; et, plus tard, nous nous reverrons tous. Quant à moi, je vous pardonne tout.
L'aumônier est venu chez moi; je me suis bien confessée; j'ai communié; je m'en vais tranquille; nous serons heureuses. Mon cœur est plein d'espoir. Je prierai Dieu pour vous tous qui fûtes si bons pour moi; votre douleur sera grande lorsque vous recevrez cette nouvelle; eonsolez-vous; je pars tranquille.
Vous autres, mes chers frères, soignez bien notre chère mère; elle est si bonne et si brave...
- Chère maman, mes vêtements qui vous conviennent, portez-les; les autres, donnez- les à ma sœur, car elle fut toujours si bonne pour moi. Faites confectionner un costume de l'étoffe noire que j'avais, chère mère; et ne soyez pas si triste; car personne de vous n'est coupable. Je redemande pardon de vous avoir fait cela sans vous avertir...
- Nous sommes restées ensemble jusqu'à la dernière minute; c'est une grande consolation pour nous et pour vous... En vous, mes chers frères et sœurs, je mets aussi ma confiance et espère que vous consolerez ma pauvre mère... Je vais me rendre auprès de mon bien cher père; je lui raconterai tout; et je prierai pour ramener mon frère (combattant) en bonne santé auprès de vous.
- Faites faire le pèlerinage que j'ai promis de faire; et faites dire les messes promises. Un pèlerinage à Stoepe ou à Kleemkappel. Vous accomplirez mes promesses, n'est- ce pas, mes chers?
- Pendant que je vous écris, je vous revois tous! Je pars en paix: l'aumônier dit qu'un chrétien ne meurt jamais et que Dieu prendra soin de vous autres. Vous perdez en moi votre consolatrice; mais, mon cher Pierre en sera un meilleur. Chère maman; restez dans la maison pendant toute la guerre; ne payez pas de loyers, ni contributions... Mettez les lits des garçons dans une chambre pour que vous soyez tous ensemble s'il arrivait quelque chose.
- Vous autres, tâchez de rester auprès de maman; ne la quittez jamais; car elle est ma plus grande préoccupation.
- Je vous envoie, d'ici, l'argent qui me reste; dépensez-le... je vous envoie encore 175 francs.
- Consolez-vous tous. Pendant que j'écris, l'aumônier est à nos côtés et nous dit qu'il est heureux de pouvoir nous préparer à mourir.
- Gardez, comme souvenirs, mon livre de prières, ma tresse de cheveux. Consolez- vous; je serai heureuse dans l’éternité... Après la souffrance viendra le bonheur.
- Au revoir, et bien du courage! Nous prierons beaucoup pour vous. Un dernier adieu de ma part.
Emilie Schattemen.
Ce fut une consolation pour vous d'avoir ignoré la chose; ne vous en inquiétez pas. Au revoir; prenez courage, comme je l'ai eu jusqu'au dernier moment.
Le 12 septembre, vers 4 heures du matin, elles entendirent la Sainte Messe et communièrent; puis, braves, se soutenant mutuellement, elles gravirent le Golgotha... Elles arrivent au Tir National. C'est un matin froid, où la vie pleure, où la lumière grise sourit si tristement dans les larmes de la nuit... et le deuil automnal s'épand si douloureusement sur les choses;... mais un frisson lumineux nimbe le front des deux vierges que les bourreaux conduisent au martyre.
L'exécution fut atroce. Prises d'émotion, leurs forces physiques se dissolvant pour annihiler leurs énergies morales, les deux femmes, évanouies, s'écroulent...
L'officier prussien hésite. Un duel s'engage en son coeur: laissera-t-il à ces deux femmes, qu'une humaine et féminine défaillance abat, l'honneur de mourir conscientes de leur offrande? attendra-t-il que leurs lèvres aient murmuré les deux mots: Dieu et Patrie? Où les déchirera-t-il comme le loup lacère sa proie?
L'émotion pâlit le front de certains soldats; un des soudards, qui, à chaque exécution, demanda de faire partie du peloton assassin, trépignait: la brute se saoulait avec passion.
Et l'officier, l'épée haute, attendait. Soudain, Emilie Schatteman rouvre les yeux; et, dans un suprême effort, décidée à mourir devant les fusils, elle se redresse péniblement: à cet instant, avant le moindre geste, douze balles la couche dans la sauge.
Léonie Rammeloo ne se ranime pas, la mort la caresse déjà; alors, sur ce pâle corps palpitant, chose toute menue, accrochée à la terre, douze fusils se penchent, et le massacrent!...
Jérôme DOBBELAERE
J'ai conté l'émouvante odyssée de ces deux jeunes Flamandes qui gravirent le calvaire du Tir national de Gand, la main dans la main, et qui s'offrirent à la Patrie avec tant de juvénile beauté!
A leurs côtés tombèrent deux braves: un père de famille: le Gantois Pierre Stevens, et un jeune homme de vingt ans: Jérôme Dobbelaere.
L'humble héroïsme de cet admirable enfant est narré avec émotion par les rustres flamands de Bassevelde, son village natal, lorsque devant eux vous évoquez le souvenir du jeune martyr.
Issu d'une modeste famille flamande, Jérôme Dobbelaere était âgé de dix-sept ans quand éclata la guerre; le jeune homme servit son pays. Mais il le servit dans le bataillon des obscurs qui cherchent la récompense de leur servitude dans la satisfaction du devoir accompli. Dobbelaere fut espion.
Ce qui nimbe son souvenir d'une auréole plus lumineuse et splendide, c'est la juvénile allégresse, le clair enthousiasme, la généreuse abnégation avec lesquels il offrit à la Patrie la beauté de ses dix-sept printemps.
Dans le service de renseignements où il avait sa place, Dobbelaere se dépensa sans compter et fournit aux états-majors alliés des renseignements remarquables; dans son secteur, il travaillait avec un ami nommé De Pauw; ce dernier, reçu par le maréchal anglais Haig, fut congratulé en ces mots: « Mon garçon, vous ne vous rendrez jamais compte de ce que vous avez accompli pour votre Patrie et les Alliés! »
Témoignage magnifique qui honore grandement la vaillance de De Pauw et de Dobbelaere.
Dans les débuts de l'an 1917, Jérôme fut arrêté par les limiers prussiens et conduit à la prison de Gand. Son calvaire dura cent soixante jours, aiguillonné par d'atroces toitures morales et physiques. Le 12 septembre, il tombait sous les balles allemandes.
Mais quel état d'âme devant la mort! Je cueille quelques fleurs dans la gerbe magnifique de sa lettre d'adieu: « Cela me semble dur de vous quitter, vous tous que j'aime si tendrement, sans vous serrer sur mon cœur, vous embrasser fortement, et recevoir une dernière bénédiction. Mais je considère comme un honneur de pouvoir mourir pour notre Patrie! Avec confiance en Dieu, nous allons à la mort bravement et courageusement, et nous avons demandé de pouvoir être fusillés la main dans la main, les yeux non bandés, à être enterrés les uns à côté des autres; et cela nous a été accordé... Il m'est impossible de décrire ce que j'ai souffert pendant cent soixante jours, mais malgré tout, je n'ai dénoncé ou accusé personne... J'espère, mes bien chers, que je pourrai obtenir de Dieu, au prix de ma jeune vie et de mon sang, qu'il vous rende mon frère Rémi (soldat) en pleine santé, et qu'avec lui, vous ayez encore de nombreux jours heureux... »
Dans une de ses dernières lettres qu'il joignait à un colis renvoyé chez lui, il écrivait:
« Je renvoie de la prison mon beau costume de velours neuf pour mon père, parce que ma vareuse de boucher suffit bien pour être assassiné et enterré. »
Le 12 septembre 1917, à 1 heure du matin, Jérôme Dobbelaere écrivait à ses parents, frère et sœurs, une lettre admirable, où vibrent des sentiments si beaux d'affection filiale, de passion de la vie, de résignation chrétienne à la mort, de générosité pour ceux qui l'ont dénoncé.
Notons quelques extraits:
- « Je considère comme un devoir sacré de vous adresser pour la dernière fois, à vous tous qui m'êtes si chers, mes salutations et mon adieu. Je sais que je vous déchire le cœur; mais mon cœur et mon âme m'obligent à penser constamment à votre bonheur et à vous écrire pour la dernière fois de ma vie des paroles de consolation pour autant que cela m'est possible. Aussi ne puis-je assez vous remercier de tout ce que vous avez fait pour me consoler et pour adoucir mon triste sort. Ayez la bonté de remercier, à ma place, ma bonne et noble amie Maria Penny qui n'épargna ni argent ni peines pour m'aider...
- « Ah! mes très chers, il est si dur de mourir, encore si jeune et si bien portant, lorsqu'on aime ardemment et qu'on est aimé si tendrement. Maintenant au moment où je dois vous quitter pour toujours, je sens encore mieux cet amour profond et cette tendre affection que j'avais pour vous tous...
- « J'ai fait ce soir une bonne et sincère confession, et le prêtre nous a bien encouragés; ce qui nous a fort consolés. Confiants en Dieu, nous allons maintenant bravement à la mort; nous avons demandé à être fusillés la main dans la main...
- « Je vous demande à tous pardon à genoux pour tout le chagrin que je vous ai causé. Demandez aussi pardon, pour moi, à ma chère et bonne Maria Penny pour le mal et les peines que je lui ai faits. Cherchez à vous consoler dans la prière; c'est le meilleur et seul moyen; et de là-haut, dans le beau ciel, je ne cesserai de prier Dieu pour qu'il vous donne encore de nombreux jours heureux...
- « Je ne puis vous décrire ce que j'ai souffert ici dans l'incertitude et l'anxiété; mais maintenant que je suis fixé, j'ai pitié de vous autres, parce que je sais que lorsque mes souffrances seront terminées, les vôtres commenceront...
- « Si vous pouvez voir Camille... dites-lui qu'il ne peut pas se préoccuper de cela; c'est bien à cause de lui, mais il ne l'avait pas voulu ainsi. Dites-lui que nous lui pardonnons de tout cœur et que nous pensons encore beaucoup à lui...
- « Je suis ici avec toutes vos photographies devant moi. Dès maintenant, je les mets sur ma poitrine pour qu'elles ne me quittent plus; j'ai reçu une petite croix de l'aumônier, et je la mets avec vos photographies...
- « Recevez un dernier baiser et un dernier adieu de votre affectionné fils et frère; que Dieu vous bénisse!
- « Soyez tous courageux et consolez-vous mutuellement dans la prière. C'est mon vœu le plus cher. »
Jérôme.
- « P.-S. — Voici quels sont mes derniers vœux: que vous fassiez faire maintenant et après la guerre un service anniversaire; que vous fassiez faire quelques images- souvenirs avec ma photographie pour distribuer à la famille et aux bons amis; que vous fassiez dire une prière publique pour Isidore et pour moi dans les villages voisins; que vous donniez à mon père ou à Remy tout ce qu'ils désirent de moi...
- « S'il est possible de me faire transférer à Bassevelde après la guerre, c'est mon plus cher désir! S'il y a impossibilité de le faire, je vous demande de venir prier sur ma tombe avec Maria Penny et la famille. Je vous demande de consoler un peu Maria Penny et de continuer à la considérer comme une bonne amie et connaissance. Consolez-vous mutuellement autant que possible; je prierai continuellement pour vous; au revoir dans le beau ciel. J'ai fait mon possible et n'ai accusé personne.
- « Dites à Maria Penny que j'aurais de tout cœur voulu lui écrire une lettre, mais que cela ne m'a pas été autorisé. Je vous renvoie ce dont je n'ai pas absolument besoin: mon portefeuille, mon porte-monnaie, 135 marks, quelques cigares, et tout ce dont je puis me passer.
- « Nous avons encore mangé la viande et les raisins.
- « Recevez, chers parents, frères et sœurs, famille et amis, pour la dernière fois, un gros baiser, et un adieu!
- « Au revoir dans le beau ciel. Là-haut, je penserai toujours à vous et prierai pour vous tous.
- « Maintenant, nous allons encore dire un rosaire. Nous disons la première partie et les jeunes filles répondent. Souvenez-vous de moi et ne m'oubliez pas... »
Il ne trembla pas devant la mort. Les yeux non bandés, il attendit l'ordre fatal..., s'écroula... et s'éteignit avec, dans le regard, la vision sereine de la Patrie...
Aussi, j'aime à redire les paroles si vraies prononcées sur la tombe du jeune héros par le bourgmestre de Bassevelde, lors du transfert dans son village natal du corps du supplicié:
« Nous devons tâcher que son sang et celui de nos soldats n'ait pas coulé en vain; et que notre bien-aimée patrie, enfin délivrée du joug ennemi, ne soit pas minée ou divisée par des excitateurs et des querelleurs étrangers. »
Sur la tombe des morts, le peuple à genoux se recueille et puise dans leurs exemples les leçons du Devoir!...
Les Frères COLLARD
Deux saints.
Tout au fond de la Belgique, le petit village de Tintigny, où vivaient heureux près de leur père et de leurs sœurs les deux frères Louis et Antony Collard.
Quand les Allemands entrèrent chez nous, Tintigny fut saccagé, brûlé, ses habitants brutalisés ou assassinés.
La mort secouait ce nid charmant où chantait tant de bonheur. Sur les ruines, des héros allaient surgir.
Deux jeunes gens de dix-neuf et vingt ans, après avoir enduré pendant vingt-quatre mois les cruautés de la soldatesque déchaînée, les vexations d'une autorité arrogante, s'enfuirent en fraude de leur village désolé et gagnèrent Liège afin d'y chercher une route vers la frontière hollandaise; c'étaient les frères Collard.
Le hasard les mit en relation avec le service d'observations de l'Etat-Major anglais. Depuis longtemps déjà, les chefs désiraient trouver des agents de confiance et expérimentés pour la surveillance des mouvements de troupe entre Longuyon et Sedan, d'où dépendait en grande partie lé sort de l'importante ligne stratégique Lille- Thionville.
On proposa donc aux deux Collard la périlleuse mission d'organiser l'espionnage dans l'étape virtonnaise; on leur montra toutes les difficultés, l'âpreté, le danger de pareil travail. Les deux frères réfléchirent un instant; puis, certains que leur servitude d'espion serait plus utile au pays que celle à laquelle ils projetaient avec tant d'enthousiasme, depuis longtemps, de se livrer à l'Yser, ils acceptèrent avec fierté l'honneur qu'on leur faisait en les désignant pour une si belle et si dangereuse besogne.
Ignorant le métier, ils restèrent en apprentissage à Liège, où leurs chefs les mettaient à l'essai en leur demandant des renseignements divers sur l'ennemi.
Puis, l'occasion favorable survenue, ils partirent pour l'étape où ils arrivèrent sans encombre. Tout aussitôt, ils se mirent à l'œuvre, créant des moyens de communication, organisant la surveillance de toute la région, étendant le service vers le sud.
Ils embauchèrent des complices. La piété filiale leur attacha le dévouement farouche de leur père, leur générosité d'âme celui de M. le Curé de Saint- Vincent-Rossignol, de M. et Mme Bastin, de Mme Goodseels de Wandre. Les frères Collard firent du beau travail, admiré, loué, par tous leurs collègues et par les chefs.
Hélas! une méprise malheureuse les jeta sous la griffe des Allemands.
Le 8 mars 1918, arrêtés avec leurs complices qui travaillaient sous leur direction, ils furent jetés en prison. Le supplice commença; on voulut les faire parler; on les brutalisa scandaleusement, et malgré les tortures et malgré l'abandon, les frères Collard ne prononcèrent pas un mot qui put trahir l'organisation ou un de ses membres.
Le tribunal de campagne les condamna à mort, ainsi que M. Collard père, Mme Goedseels, M. le Curé de Saint-Vincent, M. et Mme Bastin. La peine de mort fut confirmée pour Louis et Antony seuls; elle les trouva prêts depuis longtemps.
Chrétiens et patriotes, leur mort fut splendide. Comment pouvait-il en être autrement pour des héros aussi grands qui, depuis leur enfance, tendaient leurs énergies à se forger un grand cœur et un noble esprit.
Voici, en exemple, ce que Louis écrivait à son père en mai 1917:
« Quel beau soir! Et demain, quelle aurore va se lever, ô mon Dieu! Et pourtant, l'angoisse est dans les cœurs. Jamais comme aujourd'hui je n'ai senti les douceurs et les beautés de ma terre natale, ô mon doux verger, berceau de mon enfance. O coin de mon pays, ô fraîcheur de mes bosquets, que je vous aime! O douces étoiles, mes amies, que je vous aime! Aurores, midis brûlants, crépuscules rmMancoliques, voix de Dieu qui passez dans les cimes des arbres, tempêtes, brises légères, que je vous aime! Routes, sentiers, vallons, montagnes, ruisseaux, collins, chapelles, églises, maisons, petits nids, petits berceaux, que je vous aime! Oiseaux, petits oiseaux, que je vous aime! Terre de mon pays, tu me chauffes le cœur. Et vous, tombeaux de mes morts, que je vous aime! Papa, petites sœurs, petits frères, c'est de toute mon âme que je vous aime, et vous aussi, ô mes amies! Et vous, tombeau de maman! Quelle consolation de prier sur sa tombe, le front penché, et de s'agenouiller les soirs, seul dans l'ombre et le silence en causant avec elle et de recevoir sa bénédiction... »
Quant à Antony, il écrivait:
« Mon Idéal?... Faire du Lien, aux petits, aux faibles, aux souffrants, aux pauvres! »
Le 17 juillet, les deux frères reçurent la visite de leur père et de leurs sœurs, l’entrevue fut émouvante.
M. Collard était fier de ses enfants qui allaient mourir. Leur calme et leur confiance le fortifiaient dans l'épreuve. S'altrislant de cette brusque séparation, il reçut cette réponse naïve qui montait d'une âme chrétienne et lière:
« Ne vous inquiétez pas: quand nous serons là-haut, nous veillerons sur vous; nous arrangerons tout avec le Bon Dieu! »
La nuit, les deux condamnés à morl écrivirent leurs dernières lettres. Ce ne ne sont pas des mots d'adieu, de tristesse, mais un cantique spirituel qui s'envolait de leur cœur.
Tout homme se sentira grandir à la lecture de ces pensées merveilleuses, son cœur s'élever vers la bonté.
Le lendemain, ils marchèrent à la mort en priant et en chantant. Une joie divine illuminait leur front; un courage surnaturel soutenait leur cœur. C'était le 18 juillet 1918. A l'heure où Foch et Mangin, dans la superbe et formidable contre-offensive de Chàteau-Thierry-Soissons, lançaient leurs troupes à la Victoire, Louis et Antony Collard offraient à la Patrie la beauté de leur vingt ans.
Dans le demi-jour, au jardin de la Chartreuse, a Liège, ils tombèrent en héros, tandis que les grondements de la bataille déferlaient dans le lointain...
Un soleil glorieux montait à l'horizon...
Louis BRIL - Un Justicier
J'étais jeune, très jeune encore, quand éclata la guerre; cependant, les épisodes tragiques qui ensanglantèrent notre pays sont restés vivaces en mon cœur, et je me rappelle encore la sainte colère qui nous secoua lorsque le 11 février 1916, on nous apprit que, dans l'aube froide de ce matin d'hiver, les Prussiens avaient abattu sur les glacis du Tir National, un de nos plus farouches patriotes qui, spontanément, s'était fait le justicier de toute une population trahie par un de ses compatriotes.
Louis Bril était son nom. Esprit aventureux, libre et combatif, cœur patriote, il s'était révolté intensément contre l'invasion allemande et ses horreurs.
La guerre déclarée, Louis, maître d'hôtel à Paris, rentra aussitôt à Bruxelles dans sa famille, décidé à s'engager à l'armée belge. Ses deux frères s'étaient déjà offerts pour la défense du drapeau. Mais aux pressantes instances des siens, de sa mère paralysée surtout, Bril, la mort dans l'âme, se résigna à rester au pays, et remplit, dès ce jour, au restaurant italien tenu par son beau-frère, M. DelBono, rue Marché- aux-Charbons, les mêmes fonctions qu'à Paris.
Le désir de servir sa Patrie le tenaillait. Jeune et honnête, il sentait combien déloyale était sa promesse de ne pas s'enrôler sous les drapeaux et que lorsqu'un pays souffre il n'est pas un de ses fils qui peut déroger.
C'est alors que, poussé par la passion du devoir, il enrôla des jeunes gens et les conduisit à la frontière; il fut agent recruteur. Quelque temps après, arrêté à Moll, Bril fut conduit à la Kommandantur de Bruxelles où les policiers allemands se basant sur les certificats délivrés par le propriétaire du restaurant parisien que Bril portait sur lui au moment de son arrestation, le prirent pour un espion français. Après onze jours de détention, faute de preuves, on le relaxa.
Il continue son actif recrutement de volontaires quand, un matin, la police secrète faisant irruption au restaurant italien, le met en état d'arrestation; mais, bâti en hercule, d'un formidable horion dans la figure, il envoie son gardien sur le parquet; d'un bond, Bril est dans la rue. Fuite par les ruelles, entrée mouvementée dans une maison ouvrière, évasion dramatique sur les toits, course périlleuse dans les corniches, descente dans un atelier de cartonnerie; nouvelle échappée par les toits et enfin, après avoir dépisté les limiers prussiens, refuge à Waternel, où il se cache plusieurs semaines dans une chambre qu'il y avait louée.
Un certain jour, sa logeuse lui demanda si, un soir ou l'autre, il ne jetterait pas dans le canal un revolver et des cartouches qu'elle n'avait pu remettre à l'autorité allemande étant tombée malade lors de la publication de l'ordonnance relative aux dépôts d'armes.
Bril accepta, prit l'arme et les cartouches, fermement résolu à en faire usage à la frontière dès la première occasion; car, plus que jamais, il était décidé à passer en Hollande.
Peu de temps après, il apprend qu'un nommé Neels de Rhode, habitant rue Clacy, à Schaerbeck, a conduit à la frontière le fils du commissaire de police de Saint-Jonc- des-Noode, M. Guillaume.
Bril se rendit chez lui.
S'il avait connu Neels, voici pourquoi il se serait méfié de lui: Maurice Neels, né le 21 février 1890, de père belge, Victor Neels, officier à l'armée du roi, et de mère allemande, Rosine Oppenheim, Rhode était depuis longtemps un triste individu; d'une conduite et d'une paresse scandaleuses, ne vivant que d'expédients, il était le type parfait de l'aventurier. La guerre déclarée, il se mit au service des Prussiens au prix de 120 marks par mois. Sa tache consistait surtout à dépister les groupes de recrutement et à les livrer à la police. Pour éblouir plus facilement les jeunes patriotes belges dont il devait capter la confiance, il ajouta à son nom le second nom de sa mère et les sépara par la particule nobiliaire de; très élégamment, il se faisait passer pour le baron Neels de Rhode.
Louis Bril ignorait tout de ce triste personnage. Cependant, l'impression qu'il garda de sa première visite chez lui fut mauvaise; Bril devinait l'anormalité de la situation de Neels. A sa sœur qui lui demandait sa pensée, il répondit:
— Je pense qu'il est trop poli et trop aimable pour être tout à fait honnête, il m'a dit qu'il avait déjà fait passer plus de 400 jeunes gens. Or, il m'a offert une bouteille de vin et des cigares, à moi qui lui était parfaitement inconnu. S'il en a agi de même avec tous les autres, ça a dû lui coûter cher.
Lorsque Bril demandait à Neels des éclaircissements sur son action patriotique, il lui avait répondu, parlant du recrutement des hommes:
— Ce n'est pas là mon seul travail. J'ai sur moi des documents qui me feraient fusiller si les Allemands m'arrètaient. Les voici:
Neels tendit un portefeuille.
C'est un instrument merveilleux, car je m'en sers aussi à photographier qui paraît. Tenez, en plaçant ainsi ce portefeuille, je prends n'importe qui...
Bril devina le manège; le traître l'avait photographié.
— Admirable, fit Bril; quoique, cependant, il faille parfois du temps pour se servir de cet appareil.
— En effet; aussi dans les cas d'urgence, j'emploie un autre moyen, dit Neels.
Et retirant de sa poche une petite boîte:
— Ceci, c'est une véritable merveille; ce minuscule appareil, caché dans la main, permet de photographier sans être aperçu.
Cette fois, Bril ne douta plus, Neels l'avait photographié, afin de mieux détailler à la Kommandantur son identité.
Les jours passèrent. Le cœur angoissé, l'esprit perplexe, Bril sentait se resserrer sournoisement de plus en plus les mailles du filet, et qu'un jour ou l'autre sur les indications de ce sinistre individu il serait arrêté; voulant être fixé sur sa moralité, il se rendit chez M. Guillaume, commissaire de police, dont le fils avait franchi la frontière par les soins de Neels, et il lui exposa la situation.
Dès les premiers mots de réponse, Bril pensa s'effondrer; il avait donc affaire à un traître; la preuve était flagrante:
« Neels s'est offert à conduire en Hollande le fils du commissaire de police; arrivé à dix kilomètres de la frontière, Neels a dit à celui qu'il convoyait:
« Nous avons franchi la frontière, écrivez un mot à vos parents pour leur annoncer la bonne issue de votre voyage; je leur remettrai ce mot qui les rendra très heureux. »
L'autre écrit, plein de reconnaissance une lettre que Neels apporta aux parents; ceux-ci le remercièrent avec effusion... Quelques jours après, un mot de la Kommandatur leur apprend que leur fils a été arrêté et est entre les mains de l'autorité militaire: le misérable l'avait livré!
Dès ce jour, l'idée s'ancra dans l'esprit de Bril, lentement d'abord, plus fortement ensuite, de faire disparaître le traître.
L'œil fou, les traits crispés, il rentra chez sa sceur. On l'interroge. Il parle de Neels.
— C'est un traître, doublé d'un espion. Il ne sera pas dit qu'il n'y aura pas eu un Belge pour lui « faire son affaire ».
— Tu parles comme un malfaiteur, reprit Mme Del-Bono.
— Un malfaiteur? Si tu pensais aux nombreuses victimes qu'il a faites, tu tiendrais un autre langage. Il affirme avoir déjà fait passer — c'est-à-dire livré — 400 des nôtres. Si la guerre dure un certain temps, combien de ces jeunes gens mourront dans les prisons d'Allemagne des suites de privations et de mauvais traitements, par sa faute! Si les Belges revenaient aujourd'hui, il serait fusillé demain. Faut-il, pour permettre à la justice régulière de le convaincre, lui laisser continuer son œuvre de trahison? Il n'y a plus actuellement de justice en Belgique. N'est-il pas juste qu'il se lève un justicier? »
— Je cherche quelqu'un qui m'aide à le supprimer, car je crains que peut-être si je suis seul le courage me manque au dernier moment.
Et plus tard, à un de ceux qui s'étaient déjà presque livrés à ce traître:
— J’ai femme et enfant, répondit X... Pouvez-vous me garantir qu'ils ne manqueront pas du nécessaire si je suis pris ?
— Une affaire, alors? fit Bril avec hauteur. Non, je ne « marche » pas dans ces conditions. Depuis trois mois que je me suis mis à la piste de ce misérable, j'ai mangé toutes mes économies et jamais je ne me suis demandé quelles pourraient être les conséquences de l'acte que je projette. Brisons ici.
— Moi, je t'aiderai, dit Maurice Leclercq, présent à l'entretien. Je suis prêt à le poignarder.
— J'aime mieux le revolver. Je ne crois pas que j'aurais le courage de mettre un couteau dans la poitrine d'un homme, si criminel fût-il.
Un matin, décidé à ne pas rentrer chez lui sans avoir fait justice, Bril, accompagné de son ami Leclercq, se lance sur les traces du malfaiteur. Jusqu'au soir, tous deux le suivirent; arrivés rue Claeys, au moment où Neels rentrait chez lui, les deux complices se concertent; Bril l'accoste, tandis que Leclercq fait le guet:
— Me reconnaissez-vous ? dit Bril..
— Non.
— Vous avez courte mémoire; vous avez cependant tout fait pour me retrouver.
— Tiens... oui... N'êtes-vous Louis Bril?
— Oui. Nous avons d'ailleurs un compte à régler. Neels tendit la main.
— De l'argent? répliqua Bril. Jamais. Entre vous, fils d'officier, et moi, fils d'ouvrier, il y a cette différence que moi je n'accepte que de l'argent propre, tandis que vous, traître et espion...
Neels mit la main dans sa poche. Bril comprit la menace:
— Haut les mains, ou vous êtes mort.
Neels n'écouta pas; Bril se sentit perdu; il sortit son browning, et d'un coup abattit le misérable.
L'œuvre de justice accomplie, Bril se rend chez son amie, et s'y cache... Mais à l'exaltation suit la dépression morale, l'abattement, l'hallucination du cadavre. Fou de remords, il décide de passer la frontière et de se livrer à la justice belge; mais avant cela, poussé par ce désir qui rouge les meurtriers de revoir les lieux de leur crime, Bril se rend chez le colonel retraité Bretaucourt qui habite à côté de Neels et où il s'est déjà rendu pour obtenir des renseignements sur la vie du goujat; il s'y rend pour lui avouer son meurtre et se décharger ainsi du poids du secret.
Hélas! Bril, photographié par Neels, dénoncé déjà par lui à la police allemande, spontanément soupçonné d'être l'assassin de son agent, est cueilli par les argousins au moment où il pénètre chez le colonel.
Des instructions et du jugement on ignore presque tout. Aucun avocat ne fut admis à la barre, et ses audiences eurent lieu à huis-clos.
Mme Kirschen, qui si vaillamment s'efforça de pénétrer dans l'auditoire, a démontré combien inique avait été ce procès, et que la mort du justicier était décidée depuis longtemps. Quand le verdict fut connu, qui condamnait Bril à la peine de mort, M. le marquis de Villalobar, Ambassadeur d'Espagne, Mme Kirschen, et M. Errera, bourgmestre d'Uccle, se dépensèrent sans compter, pour sauver la tète de ce Belge héroïque. Rien ne désarma la colère et la brutalité du Prussien von Sauberweig.
Si l'on veut connaître la méthode d'instruction — qui rappelle l'époque lugubre de la question — dont se servaient les Prussiens, voici ce que raconta Louis Bril à sa famille lors de la dernière entrevue:
— Ils m'ont interrogé, j'ai refusé de répondre; ils sont revenus à la charge trois fois, quatre fois, j'ai nié. Le juge d'instuction est venu dans ma cellule pour me « cuisiner » plus à l'aise: je ne disais toujours rien. Alors, ils doivent avoir versé je ne sais quelle drogue dans mes aliments. Je ne sais ce qui s'est passé, mais je suis tombé dans un sommeil fiévreux, rempli de cauchemars et d'hallucinations. Je dois, je m'en doute, avoir parlé pendant ce délire — et de quoi puis-je avoir parlé sinon de ce dont mon esprit est rempli? — car à mon réveil, lorsque les magistrats m'ont interrogé une fois de plus, ils connaissaient nombre de choses que jamais je ne leur aurais dites de sang-froid.
Bril était calme devant les siens en larmes.
— Calme-toi, père, dit-il. Je suis calme, moi, tu le vois, mais j'ai besoin de tout mon courage. J'ai mis ordre à mes petites affaires aussi bien temporelles que spirituelles; je me suis confessé tout à l'heure et demain je communierai, car je veux mourir en chrétien.
C'était le 11 février 1916. II s’avança à la mort, vaillamment, la tête haute; et dans ce matin frileux et gris de février, avec bravoure, comme dans son œuvre de justicier, il présenta aux fusils son cœur de héros.
Les Frères FARCY
Le martyrologe de l'armée de civils qui, pendant la guerre, a tenu tête à l'envahisseur, est immense et émouvant! Les pages écrites par la jeunesse belge restée au pays ne sont pas des moins belles; bien au contraire. Ils sont légion ceux qui tentèrent de traverser la mort pour s'engager dans la carrière où leurs aînés les avaient devancés.
Pas mal y succombèrent. Héros obscurs, le sang de leur sacrifice en a fait des martyrs. Nous ne comprenons pas assez, ce me semble, le prix de l'offrande de ces immolés qui ont accru noire patrimoine de trésors inestimables.
Ces frères Farcy étaient trois: Henry, Jules et Charles. L'enthousiasme dorait leur front; leur âme était pareille à celle des héros légendaires; et leur mère, qui avait su forger ces trois coeurs de preux, pouvait répondre avec orgueil, comme la mère des Gracques: « Voici mes bijoux et mes ornements. »
Jules, à l'insu de ses parents, collaborateur assidu de la presse clandestine, dut bien des fois trouver refuge à l'Institut Saint-Louis ou chez l'abbé Nève pour dépister les limiers allemands. La propagation de la Libre Belgique sur une haute échelle et ses initiatives patriotiques le forcèrent un soir à s'enfuir dans la forêt de Soignes où il vagabonda pendant plus de huit jours, ne se hasardant dans les clairières qu'entre chien et loup; et parfois la nuit était si sombre qu'il ne voyait plus même les doigts de sa main. Il trouva hospitalité à l'Hôtel de la Sapinière au Kerrenberg, à Groenendael. Quelque temps après, il se glissait de nouveau dans l'a capitale pour reprendre sa propagande acharnée et mûrir de multiples projets d'évasion vers la Hollande. D'échec renouvelé ne le découragea jamais.
Un soir, dans la chambre du frère cadet, on trouva un billet laconique où l'enfant annonçait sa fuite vers la frontière, demandant pardon à ses pareùnts du mal qu'il pouvait leur causer. Le brave cœur!
Il était parti avec un ami: son chien. Hélas! proche la frontière, un Allemand les arrêta. Proie anodine pour des loups, les Prussiens les relaxèrent après trois semaines de captivité à Anvers où ils avaient rencontré une théorie de jeunes détenus politiques, des collégiens pour la plupart...
Alors fut tramée la grande tentative. Recrutant des volontaires et stimulant leur courage pendant deux mois, ils ourdirent leur expédition; et dans l'aurore rose d'un jour d'été— le 23 août 1017 — ils partirent...
Ils étaient dix-huit qui s'enfonçaient dans l'inconnu mystérieux parmi lesquels les trois Farcy, G. Chaland, J. Dendael, les yeux inondés d'une vision enchanteresse et d'un rêve cher. Le cœur content, tendu vers l'horizon poudré de bleu, comprenant la gravité de leur geste, mais aussi toute sa noblesse; attirés par l'irrésistible voix de la Patrie, ces jeunes gars — phalange perdue de l'innombrable armée des héros de seize ans — se glissaient d’un pas résolu sur les routes tragiques de la servitude. Chemins sinueux et cruels, mais qui les conduisaient tous à l'Honneur, d'aucuns à l'Immortalité!...
A Malines, une partie de la troupe arrêtée est incarcérée, les rescapés continuèrent leur route; et vers midi, au village de Koningshoycht ils rencontraient, accompagné d'un ardent patriote, le jeune collégien Pedro de Boeck, l'abbé Coutelier, qui leur inspira grande sympathie et qui ne les quitta plus jusqu'au moment tragique...
Au sortir d'Hérenthout, le guide principal se lit payer 600 francs par tête demandés pour le passage; et vers 10 heures du soir, silencieux et mornes, en file indienne, a la suite des deux guides, ils se glissaient jusqu'au cœur d une sapinière. Caravane lugubre, sous un ciel sans étoiles, dans le silence! A quoi pensaient-ils, tous ces gars? Qui connaît le drame de ces cœurs résolus?...
Ils dormaient à même le terreau, et le vent emportait leur lève vers la grande bataille dont la voix gémissait dans les lointains... Vers une heure, la pluie froide susurre dans les pins. D'aucuns se réveillent et s'adossent l'un à l'autre pour se réchauffer. Les Farcy ont dormi jusqu'au matin; on eut peine à les réveiller.
Conduite par des femmes, venues à su rencontre, la troupe, rampant sous les fenêtres d'un corps de garde, traverse un pont éclaboussé des lumières de lampes à arc; et après de multiples aventures, ils échouèrent couverts de boue et de fatigue, mais auréolés d'ardeur et de volonté dans une nouvelle sapinière. Le passage serait tenté la nuit prochaine. Ils partirent de nouveau, franchirent un canal et vers 6 heures, clans un bois à une lieue de la frontière, ils attendaient la nuit...
Les guides les confièrent à deux passeurs, des braconniers, armés l'un d'un cadre isolateur et de gants caoutchoutés, l'autre d'un fusil. De l'orée du bois à la frontière, sur une profondeur d'un kilomètre, s'étalait la plaine déboisée par les Allemands, où, vers 10 heures, la nuit lissa ses toiles sombres et enveloppa les choses dans son étreinte moite. Les braconniers plongèrent dans l'obscurité et, comme des chiens de chasse, relevèrent la tête pour écouter; ...puis, sur un ordre, suivis de la troupe en file indienne, ils s'enfoncèrent dans le mystère fait de noir et de silence. Ils retenaient leur souffle; les cœurs battaient avec violence.
Le sol était marécageux et coupé de ruisseaux. Les poules d'eau et les sarcelles les firent tressaillir souvent... Les passeurs collaient leur oreille au sol pour écouter le pas des sentinelles ou le passage de patrouilles.
A cinquante mètres de la ligne gardée, ils rampent. Un des passeurs arme son fusil et serre deux cartouches de réserve entre les dents. Le second pose l'isolateur, traverse la mort, et soudain une ombre surgit. Un cri: « Vas ist das! » Des balles déchirent le silence. Un coup sec répond; le Prussien s'écroule. Le passeur avait fait justice.
Des lumières, des hurlements, des coups de feu... Des chiens rôdent autour des proies; les brutes empalent avec fureur sur leurs lames sanglantes les enfants rivés au sol, les projecteurs lancent sur la plajne tours regards étincelants, et les loups prussiens s'acharnent sur les victimes avec une sauvagerie effroyable... Le crime est consommé.
La brise murmure une mélopée lugubre sur la harpe tragique du réseau meurtrier. Le silence dans l'horreur de cette nuit recouvre deux cadavres et des blessés. Henry Farcy et un compagnon sont cloués au sol. Charles, rouge de sang, le flanc ouvert par une baïonnette, transporté sous une tente voisine, agonise dans les bras de son frère Jules, blessé atrocement lui aussi. « Il a assisté son cadet avec l'adresse et la tendresse d'une mère, m'a dit l'abbé Coutelier. Parents si éprouvés, soyez fiers de vos fils. »
Scène poignante, au milieu des morts et des blessés où tombent tristement lés paroles : Domine salva nos, perimus. Le prêtre est là qui les absout...
Quelques jours après, des mains pieuses les ont transportés au couvent de Hoogstraeten. Les religieuses les ont ensevelis dévotement, comme on le ferait pour son enfant. Elles les ont couverts de linges blancs et de baisers; puis leurs lèvres douces de femme ont murmuré les prières des morts pendant la veillée funèbre où tout le village, ému au récit de ce drame atroce, a défilé religieusement... Les femmes pleuraient. Les hommes crispaient les poings; leurs paupières brûlaient... L'âme de la Patrie vibrait dans la poitrine de ces rustres...
Le lendemain, baignés dans la pourpre du soleil, trois cercueils, couverte de nos couleurs nationales, étaient portés à l'église du village par les élèves silencieux du collège voisin; et lorsqu'avec le gémissement, des cordes, les cercueils glissèrent dans la fosse, un officier prussien vint à passer, qui ricanait... Les hommes, eux, s'agenouillèrent...
Trois croix blanches, offertes par les villageois, furent posées sur les tertres, dans les fleurs parsemées...
Max GOFFIN
Les yeux vifs, inondés de franchise, le front large, la démarche souple, les lèvres fines où brille de la joie, l'esprit ardent, aventureux et libre, le cœur généreux et grave: tel est l'enfant.
Il a douze ans quand la guerre éclate. Tout de suite, à l'appel du tocsin, son Ame frémit; ses jeunes énergies décuplées par la vision douloureuse de sa patrie bafouée, l'enfant veut servir. A-t-il chance de réussite, à cet âge? Qu'importe! « Le succès n'est rien; le devoir est tout », disait le comte de Mun; Max le pensait, et, sous le refus d'autorisation paternelle, il est terrassé. Il ne comprend pas, dans son juvénile enthousiasme, les raisons qui militent en faveur de son père. L'enfant ne veut pas qu'on doute de son courage et qu'il aime son pays.
La résignation fut cruelle. Les mois passèrent, apportant la conquête odieuse de nos plaines, les vexations, les meurtres, les dévastations, puis les combats farouches de l'Yser. Et l'âme de l'enfant bondit d'orgueil aux récits des journées glorieuses de la Flandre; les abois lointains de l'épopée belge éveillent en lui des désirs effrénés; la volupté sainte du combat frémit dans sa chair; il se seul homme.
L'héroïsme n'est d'aucun âge; mais, si sa manifestation dépend d'un certain niveau physique, intellectuel et moral, la gloire qu'il porte sur le jeune Goffin en est d'autant plus resplendissante: Max avait quinze ans quand il partit pour la frontière hollandaise.
On connaît le calvaire des jeunes gens qui s'en allaient vers l'inconnu mystérieux, d'aucuns vers un destin tragique. L'enfant l'endura; sur la brune, rôdant au cœur des sapinières, s'enfonçant dans les plaines enveloppées de la royale beauté des soirs d'août, il traînait sur le sol traître son corps tenace. Ni blessures, ni fatigue, ni toitures n'éteignirent ses énergies. Quand, arrivé à Stekene, village flamand qui s'étend, le long du canal, au-dessus de Saint-Nicolas, il dut rebrousser chemin, sous peine d'être pris, ce ne fui qu'à contre-cœur qu'il rentra chez lui. Il pleurait: l'amertume et la douleur de l'échec le secouaient. Déguenillé, le costume en lambeaux, il ne songeait même pas à ses souffrances physiques. L'objet de son désir, à peine entrevu, avait jeté en lui un tel amour que la chute de son rêve déchirait son cœur.
Obsédé de ce désir incessant, il médite de nouveaux projets; et, trois mois après, par un matin frileux d'octobre, Max repartait...
Il franchit avec succès les multiples obstacles dressés sur sa route, et, un soir, rencontrant un groupe de fraudeurs, prêts au passage de la frontière, il se glisse parmi eux avec son ami.
Hélas! à Mouland, riant village wallon accroupi sur un coteau près de Visé, les gendarmes allemands les cernèrent et capturèrent la moitié de la petite troupe. Max et son ami sont parmi les captifs; et, devant leurs yeux humides de douleur, les boches, les barbares, fusillèrent un jeune fraudeur, enfant de treize ans, qui n'obtempérait pas assez vite à leurs ordres. Exécution poignante, dont la vision devait peut-être étreindre l'âme de deux enfants, annihiler leur volonté? Ce meurtre, au contraire, aiguisa leur ardeur.
Les deux jeunes prisonniers furent enfermés sous bonne gardé, dans un petit pavillon; mais l'ingéniosité et l'audace de Max Goffin eurent raison des rustres prussiens. Quelle ne fut pas la stupeur de ceux-ci quand ils virent le pavillon vide! Comment cela s'était-il passé? .Te n'en connais rien. En tous cas, les colombes avaient délaissé leur gîte hospitalier. Max revint au logis.
Vous, qui me lisez, vous rappelez-vous encore cette belle nuit argentée de Noël de l'an 1917? Pendant qu'elle frémissait aux échos argentins des hymnes égrenés aux offices de minuit et qu'elle apportait ê nos cœurs ulcérés une lénifiante espérance, un enfant se confiait à son mystère pour gagner la Hollande...
Cette troisième tentative fut un nouvel échec.
Vaillance sublime au cœur du jeune patriote, il décida de tenter une quatrième fois le passage...
Hélas! Une dénonciation odieuse brisa son beau rêve!...
Arrêté en janvier 1918, Goffin fut conduit à la Kommandantur, à Saint-Gilles, à Vilvorde, pour y purger une peine de quatre mois. Mais avant que d'être déporté en Allemagne, il fut convaincu d'avoir caché chez lui une pince qui servirait à couper les fils à la frontière.
On l'amena à sa demeure pour y perquisitionner; sous le regard éploré de sa mère, les Prussiens recherchèrent l'objet dangereux; et, lorsque le moment poignant du départ sonna, la maman, mue par un sentiment d'affection déchirant, demanda au policier:
— Vous n'allez pas envoyer cet enfant en Allemagne? Il est si jeune...
Alors, le petit Max, se redressant nerveusement, lança celte noble phrase:
;— Il ne faut pas leur demander de faveurs pour moi, maman.
Duel atroce en ce cœur, où l'expectative d'une séparation cruelle ne brisait cependant pas la volonté farouche d'être brave.
Ironique, l'Allemand répliqua:
— Vous êtes très fier, petit.
-— On est tous comme ça, en Belgique!
Réponse cinglante qui fit se cabrer les Prussiens. Brutalement, ils emmenèrent leur prisonnier.
La mère ne revit plus son enfant.
De prison, il écrivit — quand il le put — quelques lettres à ses parents. Pieusement, j'ai parcouru cette correspondance. Elle révèle tant de nobles sentiments qu'un indicible orgueil national nous invite à reproduire certaines pensées.
L'amour filial qui parfume le cœur de cet enfant se découvre avec une lumineuse pureté dans l'ombre, de la solitude; et il écrit:
— Je vous remercie du fond du cœur de tous les sacrifices que vous faites pour moi, chers parents; je ne serai pas ingrat; soyez-en sûrs. Je me souviendrai toujours de votre inépuisable dévouement, et je commence seulement à comprendre l'abîme d'amour et de bonté pure qu'est le cœur d'un père ou d'une mère; plus on le sonde, plus on s'aperçoit de sa profondeur. Plus loin:
— Si vous saviez toute la joie que j'ai à vous dire que je vous aime et que je voudrais être à mon cher foyer pour vous le prouver! Tous les jours, je contemple vos chères petites photos que vous m'avez envoyées; cela me fait tant de plaisir; je vous embrasse tous.
Emu par les marques d'affection que lui témoignent ses parents et certains de ses amis, il avoue:
— Quand je reviendrai, comme j'aurai beaucoup de monde à aimer!
Les heures de captivité sont terribles pour une âme délicate, affectueuse; et l'on devine toute la sensibilité de ce cœur, en lisant ces pharses:
— Ah! Que les câlineries me manquent! Mais, suffit; les épreuves, ainsi que je vous l'ai déjà dit, m'ont cuirassé contre la sensibilité. C'est malheureux que, dans toutes les cuirasses, il y ait un défaut!
Le souvenir des êtres chers palpite toujours en lui, et trahit la douceur de son cœur:
— Je vous demande, chers parents, de porter, de ma part, un petit bouquet de fleurs sur la tombe de ma pauvre tante, pour le 7 du mois, jour de mon anniversaire. Malheureusement, celle-ci (cette carte) arrivera trop tard. Faites-le tout de même; celui qui a été son grand « gâté » ne l'oublie pas, même en exil.
Lors de la libération des prisonniers, son ami de captivité fut relaxé avant lui; Max lui confie une lettre pour ses parents, où je détache cette phrase qui dénote toute sa bonté:
— Le camarade est un pauvre orphelin qui m'était très dévoué; aussi, je vous prie de bien le restaurer et de faire pour lui tout ce que vous pourrez. Vous me ferez plaisir.
Jamais une ombre d'amertume ne glissa dans son âme; et, avec enthousiasme, il écrivait aux siens:
— Nous ne regrettons rien de ce que nous avons fait. Nous savons maintenant que l'adversité seule forge les vrais hommes!
Pensée profonde, reflet radieux d'une âme forte, d'un cœur généreux!
Sa peine expirée au bagne de Vilvorde, Max fut envoyé en Allemagne. Mme Goffin, ayant appris que son fils serait conduit à la gare du Nord par le tramway électrique Vilvorde-Forest, se rendit place Liedts, où elle eut le bonheur de voir son enfant et de lui dire adieu.
Lorsqu'il se séparèrent, l'enfant dit ces mots:
— Je te remercie, maman, d'avoir été courageuse; tu n'as pas pleuré; je suis fier de toi.
Quel noble orgueil dut palpiter dans le cœur de cette mère lorsque ces paroles — digne récompense de son sacrifice — vibrèrent à ses oreilles! Elle était comprise et son fils la comprenait ! Union admirable de deux âmes!
Max fut déporté an camp de Senne, où il connut la vie monotone et déprimante des prisonniers. Mais son cœur était tendu vers un autre horizon. Un jour, il écrivit chez lui cette phrase laconique: « Je vais bientôt changer d'adresse; en attendant, je vous embrasse comme je vous aime. »
Quelques semaines plus tard, il demandait, avec insistance, de lui envoyer le plus d'argent possible, « parce que je suis ici, disait-il, très près de la maison où loge le fils de M. Billet: on y est très bien; et, quand mes moyens me le permettront, j'attendrai Fernand qui doit venir me rejoindre et nous irons y loger ensemble. »
Ce logement, c'était la Hollande. La lettre était datée de Dusseldorf. Afin de méditer plus à l'aise ses projets, de jouir d'une liberté relative, qu'il comptait d'ailleurs mettre à profit, Max s'était engagé au camp des travailleurs.
Quelque temps après, le jeune héros s'évadait Le petit Goffin jouait au malheur; alors qu'il allait atteindre le but désiré, il fut arrêté dans les bois de Schwanenberg par un civil allemand qui y chassait.
Max paya dur cette escapade. Son jeune âge et son patriotisme ne désarmèrent pas la brutalité des Prussiens.
L'armistice sonna qui libéra le jeune patriote.
Au mois de janvier 1920, pris du désir d'aventures, Max Goffin s'engage dans l'aviation militaire; et à l'école d'Assche, il obtient bientôt son brevet civil. Pilote d'une prudence extrême et d'un sang-froid remarquable, il gagne rapidement son premier galon.
Le jour où il gagna son brevet, il écrivit à ses parents, sur un chiffon de papier arraché de son blocnotes, la belle lettre qui suit:
« 23-2-21.
« Mes bien chers Parents,
- « Ça y est ! Je viens de passer après un tas d'aventures. Le 21-2: 1e Je grimpe pour la première fois à 3.000 mètres, et y reste 119 minutes. On s'aperçoit à la descente que l'enregistreur n'a pas fonctionné. Le 31-3: 2e Je grimpe pour la deuxième fois à 3.500 mètres, et je me perds au-dessus de la Hollande; à mon troisième quart d'heure mon compte-tours s'arrête brusquement: il était décalé. Je m’arrange pour atterrir le plus vite possible et atterris derrière les Usines de métaux d'Overfell. J'y ai été épatamment reçu et invité à dîner avec les directeurs et ingénieurs, presque tous officiers démobilisés dont un ancien aviateur. Ils ont mis une équipe de mécaniciens à ma disposition, et, l'accident réparé, je suis revenu au champ. Là j'ai attrapé une réprimande de mon chef d'escadrille pour mètre tellement éloigné du champ et avoir manqué d'atterrir en Hollande: de fait j'avais pris ferre à 34 kilomètres du champ. Il voulait faire une demande pour me renvoyer de l'école; mais, grâce à mon moniteur, tout est arrangé.
- « Le 23-3: Aujourd'hui, j'ai passé 150 minutes, soit deux heures et demie à 2.600 mètres et ai atterri à 60 mètres du but, moteur coupé; on avait 150 mètres; donc c'était bien.
- « J'en suis quitte pour mon petit voyage à 8 jours d'arrêt; il est plus que probable que je ne pourrai pas revenir dimanche; je ne sais encore rien.
- « Excusez le décousu... je suis très fatigué. J'ai volé une heure avec les fils cassés dans le haubannage de la queue; à tout moment, une heure durant, j'ai surveillé les attaches caudales, craignant de perdre tout l'empennage.
- « J'aurais préféré dégringoler de 3.000 mètres, plutôt que de redescendre sans être breveté.
- « Je vous \011s aime, vous embrasse, et serai sauvé dans trois mois.
- « Votre MAX. »
- « Mes amitiés à Mariette et à tout le monde; une caresse à Nénette (son chien). »
Le 1er août 1921, après avoir obtenu son brevet militaire, il était nommé à Evere, au pilotage des gros appareils de la 6e escadrille royale.
Le 9 août, il reçoit d'ordre de monter son avion. Sur l'aire de l'aérodrome, l'oiseau frémit... bondit dans l'espace et plonge vers Neder-over-Humbeek.
Tout à coup, une panne de moteur. L'oiseau tangue, chancelle et, avec la rapidité de l'éclair, se casse sur le sol.
Des débris ensanglantés, on retira la dépouille du caporal-aviateur.
Mort tragique! Mort glorieuse!
Max Goflin avait dix-neuf ans!
Sur sa poitrine, où ne battait plus son grand cœur, ses chefs déposèrent la croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold II; et ses parents éplorés purent encore s'agenouiller par deux fois nu pied du petit lit d'hôpital où reposait leur cher enfant, abîmé par la chute.
Celui qui fut un héros, qui demain eut été un conquérant, n'était plus: son àme seule palpitait dans la triste chambrette...
Des funérailles grandioses furent faites au héros; et sa mère eut une parole sublime qui révèle la force, la fierté et la générosité de son cœur maternel:
— Il est tombé en service commandé; ce qui apaise un peu ma douleur atroce, c'est de savoir que mon enfant est mort glorieusement!...
André LINNEMAN
J'ai narré maintes fois fa bravoure de ces jeunes héros qui s'en allaient par les chemins cruels de l'exil pour chercher par delà la frontière l'objet désiré de leur ardeur. D'aucuns de ces braves — et ils sont nombreux — trouvèrent sur ces routes du Devoir une mort splendide!
Révélant le caractère superbe de notre peuple féru de liberté et fort d'abnégation, l'expression de leur héroïsme paraît être chez tous à peu près semblable; et, cependant, chaque fois que j'ai relu les péripéties de leur vie et de leur mort, j'ai senti mon cœur, tourmenté par une orgueilleuse émotion, battre plus violemment.
Car, si les années semblent calmer les enthousiasmes qui nous soulevaient pendant la guerre, elles burinent cependant plus profondément dans les cœurs belges le souvenir de ceux qui s'immolèrent pour nous, le souvenir de ces jeunes héros qui portèrent sur l'autel de la Patrie la moisson de leurs vertus et l'offrande spontanée de tout leur être. Aussi, à proportion que le recul du temps intensifie les lignes de ces héroïsmes, les cœurs reconnaissants adressent avec plus de ferveur à la mémoire des martyrs l'hymne de la gratitude nationale.
Au sujet d'un jeune martyr de la frontière, je produis un extrait de son dossier qu'aimablement on a bien voulu me permettre de consulter:
« Linneman André-Nestor, télégraphiste, né à Mons, le 27 novembre 1894, apprit d'abord le métier d'ajusteur; mais plusieurs de ses amis étant télégraphistes, il eut l'ambition de devenir bientôt leur collègue. Une intelligence très ouverte, une rare ardeur au travail, lui ouvrirent en effet les portes de l'administration des télégraphes.
Au début des hostilités, Linneman voulut s'engager dans l'année belge. Mais ses chefs, comme d'ailleurs la majorité des Belges, ne prévoyaient guère l'affreux et long désastre dont nous allions souffrir. Ils engagèrent donc Linneman à attendre les ordres de l'administration, qui ne pouvait tarder à réorganiser le service et à rappeler ses employés.
Linneman obéit. Pour servir sa patrie dans les étroites limites qui lui étaient imposées, il offrit sa collaboration à l'Agence belge de renseignements pour prisonniers de guerre et internés, rue Lamir, à Mons. Travailleur d'élite, sa vive intelligence, son activité jamais lassée, son complet dévouement, lui avaient acquis l'entière confiance et l'admiration de ses chefs. Une extrême facilité d'assimilation lui permettait d'entreprendre n'importe quelle tâche et de remplir les emplois les plus divers; la seule chose qu'il ne pût supporter, c'était d'attendre la besogne.
La multiplicité des ordres et contre-ordres qui caractérise l'administration allemande, qu'avant la guerre on admirait de confiance et qui, depuis, nous égayait ou nous vexait selon les jours, nécessitait, de la part d'une. Agence pour prisonniers, continuellement en butte aux soupçons de l'ennemi, un véritable talent d'équilibriste: à chaque moment, il fallait « réorganiser les services ».
Dans cette préoccupation constante d'assurer le réconfort moral et matériel des nombreux prisonniers dont elle s'occupait, la « rue Lamir » fut à la hauteur de la tâche; elle pouvait demander à tous ses collaborateurs l'effort et la souplesse nécessaires. André Linneman y joignait une bonne humeur inaltérable; aussi, que de fois l'on entendit les chefs de service dire: « Linneman s'en chargera; nous demanderons à Linneman de faire cela; envoyez-nous M. Linneman. » Et, naturellement, Linneman l'entreprenait, réussissait... et, huit jours après parfois, s'attelait à une tâche presque opposée: les règlements étaient changés!
Mais cette ardeur au travail cachait une fièvre intense de patriotisme. Linneman, voyant la guerre se prolonger, souhaitait rejoindre l'armée et en cherchait les moyens; le manque de ressources l'en empêcha longtemps.
L inique déportation commença; Linneman déclara qu'ayant prêté serment de fidélité au Gouvernement belge, il ne se soumettrait jamais à la déportation et se ferait tuer plutôt que d'accomplir le moindre travail pour l'ennemi.
Cette déclaration, l'accent passionné dont il la faisait, avaient une beauté tragique. Les juges allemands eux-mêmes l'accueillirent avec un silence respectueux, lorsqu'elle fut rapportée lors d'un procès de recrutement à Bruxelles, le 12 septembre 1917.
Certains chefs de service de l'Agence pour prisonniers s'occupaient de recrutement; ils eurent la confidence de cette douleur patriotique, et offrirent à Linneman de supporter eux-mêmes les frais du passage, très difficile à cette époque. »
Accompagné de M. Houdez, télégraphiste, et de M. B. Courtoy, récidiviste farouche — que j'ai eu le plaisir de connaître au bagne de Vilvorde, où il purgeait une nouvelle peine pour avoir recruté des jeunes gens — André Linneman arriva à Bruxelles, où il se cacha pendant cinq semaines; et, soudain, dans un coup de filet formidable, la police allemande arrêtait à Mons et à Bruxelles les principaux chefs de l'organisation; les autres prirent la fuite. M. B. Courtoy fut arrêté; et les jeunes gens, abandonnés à eux-mêmes, se décidèrent à reprendre le chemin de Mons.
Mais la voix de la Patrie grondait en eux, voix fascinatrice qui les hypnotisait si fort que leur désir torturait leur chair; el, un jour, mus par cet appel farouche du Pays, ils reparlent vers Bruxelles, où M. Poncelet, chef de bureau aux télégraphes, leur offrit une généreuse hospitalité.
Sous la conduite de Mme Cortvriend, ardente patriote qui dirigeait un service de recrutement, nos deux jeunes Belges tentèrent à plusieurs reprises le passage de la frontière hollandaise. Chaque échec aiguisait leur ardeur et, lorsque le 18 juillet 1917, ils repartirent vers Calmpthout pour une nouvelle tentative, ce fut avec un clair enthousiasme qu'ils s'engagèrent sur la route à Cappellen.
Ils humaient avec volupté l'exquise odeur du crépuscule; des effluves de bonheur baignaient leur âme, et la joie de vivre les transfigurait. Tout à coup, l'orage gronda. Le ciel se déchira et les éclairs craquèrent. Sur la route en déclive, la pluie bouillonnait et la bourrasque sifflait; la lumière froide du tonnerre illuminait l'immensité lugubre, et découvrait des ombres qui se traînaient péniblement sur le chemin...
Après une longue marche, brisés de fatigue, trempés de pluie, mais nimbés de volonté, tous les jeunes gens arrivèrent en vue de la frontière, qui se devinait dans l'ombre: le vent bourdonnait sur les fils un refrain sinistre.
Suivant le plan projeté, Mme Cortvriendt couperait les fils, tandis qu'un wattman des « Tramways bruxellois » les écarterait pour le passage des jeunes gens. Mais, dans la fièvre du moment, Linneman s'avance, enfonce ses mains dans les gants de caoutchouc, saisit la pince; un coup sec; une étincelle; la tension du fil brusquement rompue, le câble saute et frappe Linneman, qui s'abat dans l'herbe; un spasme horrible le secoue violemment. Il mourut dans un râle.
L'orage s'apaisa. La nuit s'éclaircit; dans les herbes l'eau bruissait légèrement, et dans les ravines en déclive, elle chantait avec mélancolie. Une fraîcheur parfumée monta de la terre et enveloppa la dépouille du petit Montois abîmé qui souriait à l'étoile du firmament.
Raymond MUSEU
Lorsque les Allemands envahirent notre territoire, Raymond Museu avait douze ans, ses sentiments patriotiques portèrent son âme au sommet des grandes abnégations où il fit stoïquement à la Belgique l'offrande de son martyre.
Dès le jeune âge, M. et Mme Museu, qui devaient être pendant la Tourmente de véritables héros, avaient versé dans le cœur de leur enfant un tel amour du Devoir, de l'Honneur et du Pays, que l'éclosion des grandes vertus y fut resplendissante.
Il avait sept ans et demi, lorsqu'à la Noël de l'année 1910 il adressa aux Princes Léopold et Charles de Belgique une lettre signée par sa soeurette Suzanne et par lui, d'une écriture enfantine et malhabile. Simplement, naïvement, ils disaient à Leurs Altesses qu'ils les aimaient beaucoup, qu'ils leur souhaitaient un heureux Noël, et qu'en témoignage d'amitié ils Leur envoyaient les plus beaux timbres de leur collection. Raymond ajoutait qu'il serait fier, plus tard d'être militaire, mais qu'il serait si heureux s'il pouvait être maintenant déjà leur petit soldat; aussi Leurs Altesses ne devaient pas se fâcher s'il osait Leur demander un modeste uniforme, certain que sa prière serait exaucée. En échange, il promettait de penser beaucoup à eux.
Quelle ne fut pas l'émotion des enfants royaux à la lecture d'une pareille missive!
La réponse ne se fit pas attendre. La Comtesse Fr. Vanden Steen de Jehay écrivit aux bambins:
« A Suzanne et Raymond Musen,
« Les Princes Leopold et Charles-Théodore et la Princesse Marie-José ont été très touchés de la gentille lettre que vous leur avez envoyée et dans laquelle vous leur exprimez de si bons sentiments à l'adresse de leur chère Maman. Ils vous remercient beaucoup aussi des timbres de collection qui étaient joints à votre lettre. Les princes ont eu la permission de vous offrir, à titre tout à fait exceptionnel les jouets que vous aviez demandés. Ils sont bien heureux de vous faire ce plaisir. Veuillez recevoir mes meilleurs compliments. »
Il fut fier, le petit Raymond, lorsqu'il reçut celte lettre, plus fier encore quand il endossa le martial uniforme de soldat.
Altesses, une fois de plus, vous avez fait ce jour-là un heureux, mais aussi un héros.
Sous cet uniforme, grandit l'amour de son Roi et de la Patrie; il paraît que dans ses jeux, à la tête d'une troupe de compagnons, Raymond Museu remplissait à merveille le rôle d'officier.
Dès les premiers jours de l'invasion, Raymond voulut être soldat; comme bien on le pense, on le dissuada de ce grand projet.
Lorsque la forteresse de Namur succomba, M. Museu, officier à l'année belge, dut abandonner sa ville avec ses soldats, tandis que sa femme, engagée à la Croix- Rouge, suivait l'armée, ayant confié, au préalable, ses enfants à la garde de leur grand'mère qui résidait près de Louvain. C'est de là que les bambins, enthousiasmés par le récit des prouesses guerrières de nos soldats, assistèrent au sinistre incendie de la ville universitaire, au martyre et à l'exode douloureux des populations.
Anvers succomba. Mme Museu reprit ses enfants et rentra chez elle, à Namur.
Il serait superfétatoire, je pense, de montrer combien le spectacle des horreurs et des cruautés allemandes avait élargi le cœur des enfants et jeter en eux, en même temps qu'une aversion farouche pour les ennemis, un amour plus obstiné de la Patrie meurtrie.
Mme Museu, épouse dévouée, mère admirable, pendant que son mari se battait à l’Yser pour la défense du sol natal, voulut aussi coopérer à la victoire; tout aussitôt, elle se jeta dans la servitude la plus dangereuse mais la plus noble: elle fut espionne. L'Allemand la guettait; elle tomba dans ses griffes et fut envoyée en Allemagne.
Et Raymond qui n'a pas oublié sa promesse aux princes royaux, qui de jour en jour sent gronder en lui plus intensément le désir de se battre, écrit à son. père:
« J'apprends bien la Brabançonne, et je suis bien triste d'apprendre que les enfants français peuvent donner quelque chose pour le cadeau qu'on va offrir au Roi et que les enfants belges ne peuvent y prendre part!... Que je voudrais être grand, papa, pour être à tes côtés. Nos prières sont pour nos petits soldats et notre esprit est toujours près d'eux. Vivent notre chère Relgique, notre Loi, et tous nos petits soldats! »
Celui qui écrivait ces phrases n'avait que douze ans!
Après une pénible captivité, Mme Museu, abîmée par la maladie, fut rendue à ses enfants, mais gardée prisonnière dans la ville de Namur.
Raymond devint chef de ménage. Il s'acquitta de sa nouvelle charge à la perfection; et pendant des mois et des mois on le vit suivre les cours au collège Notre-Dame de la Paix, battre la semelle aux comptoirs du Ravitaillement, tromper la surveillance allemande pour se procurer dans lés villages avoisinants la nourriture nécessaire; préparer, avec sa sœur, les repas, et se lever à cinq heures du matin pour achever ses devoirs d'écolier interrompus la veille par la besogne domestique.
Et les mois passèrent... Son amour du Pays ne faiblit pas; son désir de combat grandit. Du dossier qu'on a bien voulu me communiquer, j'extrais ces quelques phrases adressées par Raymond à son père:
« J'espère que ta santé est bonne; sois toujours courageux. Nous prions Dieu chaque jour qu'il te donne la force et qu'il te protège tous les instants dans les combats. Nous sommes certains que tu fais ton devoir jusqu'au bout, et nous sommes fiers de te sentir sur les champs de bataille. »
Plus loin:
« Dieu et Patrie seuls nous intéressent en ce moment.
Cher papa, courage. Si j'avais seize ans! Je ne peux pas y songer, je n'en ai que treize encore. » En mai 1918, il écrit:
« Moi aussi, cher papa, je voudrais partir; songe donc, j'ai 15 ans et 5 mois, encore sept mois et je puis faire mon devoir de non citoyen...
« Que Dieu vous donne à tous, et principalement à toi, la force, le courage et la volonté nécessaires pour mener à bonne fin l'héroïque cause qui vous assemble tous comme des frères sous le drapeau. Que ne donnerais-je pour pouvoir y être, moi!
« Que Dieu entende ma prière et que mon cher père daigne bien vouloir m'aider le plus tôt possible. Encore une fois, vaillant père et braves soldats, que la bénédiction du Très-Haut retombe sur vos têtes couronnées déjà des lauriers de la. bravoure et de la vaillance.
« Les braves Belges qui restent ici soupirent après le jour où l'étendard victorieux de notre chère Belgique se promènera dans les rues fleuries de nos villes, libres alors. En attendant, bien cher papa, de pouvoir me réfugier dans tes bras paternels (et j'espère avoir ce bonheur avant les autres), reçois de bien loin, du fond de cet exil, de l'autre côté de l'infranchissable barrière d'airain, les meilleurs baisers de celui qui t'aime de tout son cœur.
« A bientôt (j'espère).
« RAYMOND. »
C'était en mai 1918. Un soir qu'il rentrait chez lui, Raymond décida de partir avec deux de ses amis qui venaient le chercher. Ni les objections de sa mère, ni la vision évoquée des dangers multiples de la frontière n'arrêtèrent son ardeur. Le 29 mai, Raymond et ses camarades quittèrent Namur.
Voici, décrit par une main amie, le voyage périlleux du jeune héros:
« Raymond qui n'avait pas seize ans pouvait circuler sans passeport; ainsi remplit-il pour ses amis le rôle d'éclaireur: lorsqu'il se trouvait sur leur route une sentinelle demandant les passeports, ses amis, à l'arrière, pouvait lé voir et éviter par des détours les postes allemands. Il remplit ainsi ce rôle jusqu'au nord de Hasselt; mais, là, fatigué, les pieds meurtris, ses compagnons durent l'aider pour continuer leur marche en avant et l'un d'eux voulut remplir la tâche de Raymond; malheureusement, il fut bientôt arrêté; et ses amis le virent entre deux Boches, conduit vers la gare. Celui qui était resté avec Raymond trouva les difficultés trop grandes et il déclara qu'il voulait rentrer dans son école à Bruxelles, ce qu'il fit. Raymond restait seul. Mais il résolut de poursuivre quand même sa route. Sa maman lui avait donné deux adresses de dames qu'elle avait connues dans le camp en Allemagne et qui pouvaient peut-être l'aider dans son entreprise. Raymond arriva ainsi chez Mme Stevens, à Hamont (Limbourg) pour se diriger de là chez Mme Jonet-Bergmans, à Brée. Cette dame déclara n'avoir jamais rencontré chez les hommes de tout âge qu'elle avait aidés à franchir la frontière autant de courage et un sentiment de patriotisme aussi élevé. Comme il était impossible de passer les fils à cet endroit, Raymond se mit à voyager le long de la frontière, cherchant une place plus favorable. C'est alors privé de nourriture, il dormit deux nuits au bord d'un lac, dans un grand bois.
Du Limbourg, il descendit dans la province de Liège, prit le train à Liège pour Melreux, et de là se rendit à pied à Laroche, pour aboutir enfin à Bois-de-Saint-Jean, où il arriva à une ferme, dans un état lamentable. On convint qu'il resterait là. Après trois semaines, le 20 juin 1918, il revint chez lui, pour repartir le même jour, Mme Museu ayant convenu avec les personnes de Bois-de-Saint-Jean qui l'avaient hostipalisé de le renvoyer là pour passer les vacances afin de lui rendre des forces dont il avait grandement besoin. Raymond était heureux de cet arrangement; mais, le 26 juin, après six jours de séjour à la ferme, il partit et réussit à franchir la frontière belgo-allemande. »
.En Allemagne, Raymond ne courut pas longtemps; après quarante-huit heures de route vers la frontière hollandaise, il était appréhendé à Aix-la-Chapelle, et conduit à la Kommandantur où il resta deux jours, sans boire ni manger.
C'était le seuil d'un supplice infernal. A la prison où on le transféra, il fut condamné, sur faux rapport d'un Calfachs, au cachot et dut se coucher plusieurs jours sur une grille de fer au-dessus d'une eau glacée.
Ce douloureux régime aiguillonné par une maigre ration de nourriture mauvaise détruisit promptement la santé robuste du jeune patriote; et lorsque, le 15 juillet, ses bourreaux le conduisirent à la prison de Verviers, il n'était plus qu'un squelette.
Menottes aux poings, on le véhicula ensuite au Palais de Justice de Liège; pendant tout le trajet, ses gardiens eurent le malin plaisir de lui déchirer les poignets avec les chaînettes. Lorsqu'il eut séjourné huit jours dans une salle malsaine du Palais, au milieu d'une foule de repris de justice, Raymond arriva à la prison de la Chartreuse épuisé, exsangue et déchiré. On dut le porter dans sa cellule; le petit héros n'était plus qu'une loque humaine.
Aux prisonniers compatissante qui demandaient le transfert de cet enfant à l'hôpital, le commandant de la prison répondait brutalement: « Cela ne vous regarde pas; occupez-vous de vos affaires ». Et le petit Musen, secoué par la fièvre, se dressait péniblement sur son sac de copeaux; dans un murmure douloureux, il appelait désespérément: « Maman, maman! »
Ce martyre atroce ne désarma jamais la cruauté des Allemands.
Au Tribunal, lorsqu'on lui avait demandé s'il regrettait ce qu'il avait fait, Raymond avait crânement répondu:
— Non, Messieurs! Je ne regrette qu'une chose: n'avoir pas eu l'âge pour partir avec mon père afin de vous battre!
Fière et cuisante réplique dont la Prusse devait se venger.
Vengeance cauteleuse et cynique, qui démontre, en même temps que l'incompréhension des vertus civiques, un affaiblissement du sens moral de l'Allemagne.
Rayond Museu était condamné à quatre mois de prison et à la déportation pour tentative de passage de la frontière.
Un policier, ému cependant par la grandeur d'âme de ce jeune Relge, appela Mme Museu et lui dit:
— Madame, si j'avais un fils comme le vôtre, j'en serais fier; pendant quatre ans de guerre, je n'ai pas rencontré son pareil. Ne soyez pas inquiète, je vous rendrai votre fils.
Mme Museu avait supplié qu'on lui accordât l'autorisation de voir son fils; on la lui refusa sous le spécieux prétexte qu'ancienne prisonnière, elle était sous contrôle à Namur.
La vérité, c'est qu'il ne fallait pas qu'un témoin pût assister au martyre du jeune patriote; l'œuvre sinistre devait s'accomplir dans l'ombre, afin de cacher la réalité; de plus, il fallait encore attiser les douleurs du jeune détenu en lui refusant la visite de sa mère et que rien ne lénifiât son calvaire.
Pourquoi insistait-elle tant, Mme Museu, puisqu'on lui rendrait son fils?
Or, un matin — c'était un vendredi, je crois, — un sous-officier prussien se présente:
— Madame, votre fils est malade... très malade... c'est regrettable... il est mort...
Elle reçut le coup sans trembler. Forte, elle ne pleura pas. Désignant une photographie sur la table:
— Voilà l'enfant que vous m'avez tué... Puis-je aller le voir?
— Vous le verrez, Madame.
Et avec sa fille elle entreprit le douloureux pèlerinage. A Liège on les conduisit à l'Université; sur une table, elles reconnurent le tricot et la casquette, le livre de prières et le chapelet, et les vêtements de Raymond.
Guidées par deux Prussiens, elles descendent dans une cave où repose le petit cadavre, émacié et tordu par la souffrance.
Devant cet enfant aimé qu'elle ne verra plus, la maman s'émeut; mue par une piété maternelle, elle se penche ardemment sur les lèvres de son fils; mais à cet instant un des Prussiens l'arrache du cadavre:
—- Votre fils a eu le typhus, Madame.
Le barbare mentait.
Raymond Museu, petit héros du Devoir, amant passionné de la Gloire, était mort sous les coups et les mauvais traitements des Prussiens.
Il fut inhumé provisoirement au cimetière de Robermont. Des mains amies entretinrent pieusement sa tombe jusqu'au jour où, dans un ciel d'apothéose, la Belgique reconnaissante lui fit des funérailles splendides.
Il repose à présent dans le mélancolique cimetière de Saint-Servais, près de Namur, où souvent deux parents éplorés viennent s'agenouiller en une méditation chrétienne, tandis que dans les frissons embaumés de la brise tremblé le souvenir ému de la Patrie.
Fin